Journées professionnelles 2017
Les 15, 16 et 17 novembre 2017, Cinémas 93 organisait la cinquième édition de ses Journées professionnelles, au Ciné 104 à Pantin. Les thématiques abordées lors de cette édition :
La culture, un terrain de jeu (2-6 ans) ?
LA PARTICIPATION DES JEUNES ENFANTS AUX PRATIQUES CULTURELLES
Conférence par Gilles Brougère, professeur de sciences de l’éducation à l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité et membre d’EXPERICE, « Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelles Education ».
À l’occasion de cette conférence inaugurale, Gilles Brougère a choisi d’aborder la notion de jeu sans l’isoler des autres activités du petit enfant. Dans cette perspective, il propose de développer l’idée directrice selon laquelle il y aurait une spécificité propre à la façon dont l’enfant participe aux pratiques culturelles par rapport à d’autres pratiques. On peut ainsi avancer que, dans le cadre des pratiques culturelles, l’enfant est totalement participant, et ce au même titre que les adultes quand ils sont mis dans une situation équivalente. Et, comme pour les adultes, les pratiques culturelles ne sont pas envisagées dans un but éducatif, ni dans un but d’éveil, ce qui évidemment n’implique pas que l’on n’apprenne rien.

Quelles sont les spécificités des pratiques culturelles ?
1) Elles n’ont pas comme sens premier de préparer une pratique future, mais elles permettent à l’enfant d’être un réel pratiquant. Autrement dit, elles ont un sens immédiat, contrairement à certaines disciplines scolaires.
2) Elles impliquent la notion de participation : cette participation peut être guidée et tenir compte des compétences des enfants.
3) Elles peuvent être spécifiques à l’enfance ou bien partagées entre enfants et adultes. En aucun cas elles ne délimitent un monde des enfants d’un monde des adultes comme peut le faire par exemple le monde du travail dont les enfants sont totalement exclus. Le champ des pratiques culturelles autorise les partages.
Quels types d’activités ?
Le jeu
En tant que tel, le jeu n’est pas spécifique à l’enfance, mais il y a des formes de jeu spécifiques à l’enfance, comme les jeux d’imitation, ceux où l’on joue à faire « comme si ». Même si quelques activités d’adultes y ressemblent, ces formes appartiennent bien à l’enfance : elles ont à voir avec le fait que l’enfant est exclu de certains domaines d’activités, il joue alors à faire semblant. On a constaté par exemple que les enfants qui s’occupent d’enfants plus jeunes jouaient moins à la poupée.
Les jeux d’exercices collectifs sont traditionnellement associés au monde de l’enfance mais ils sont transmis par les adultes.
Il existe aussi des jeux qui se développent entre enfants, comme dans les cours d’école. Ces jeux peuvent se nourrir de sources extérieures : par exemple, certains enfants regardent des vidéos de jeux de mains sur YouTube pour les importer ensuite dans la cour de récréation.
Dans le jeu enfantin, on va retrouver du second degré (le « pour de faux »), mais aussi la nécessité de suivre des règles, deux dimensions qui existent chez les adultes, même si elles y sont moins centrales : elles sont par exemple présentes dans les jeux vidéo ou les jeux de société.
Quels sont les points communs entre le jeu et les autres pratiques culturelles ?
Le jeu associe pratique et apprentissage : on apprend en pratiquant, on apprend à jouer en jouant.
Le jeu évoque d’autres réalités pratiques que lui-même : quand on joue, il est question d’autre chose que le jeu (tout comme lorsqu’on lit un livre ou qu’on regarde un film, il est question d’autre chose que le support).
Il faut en outre noter que les apprentissages sont liés aussi bien à la pratique qu’à la participation. Or une des caractéristiques des pratiques culturelles est qu’elles font de l’enfant un participant : c’est le cas de la lecture, du cinéma, des arts plastiques, du chant et de la musique, du sport…
Il faut aussi se demander si, dans le cas de chacune de ces pratiques, on met l’accent sur le futur ou bien sur le présent de celui qui les investit.
La lecture
Les incompétences de l’enfant en la matière impliquent que l’on crée des outils pour faire de lui un futur lecteur (des manuels par exemple). Pour autant, on peut considérer l’enfant lecteur comme le « réceptacle d’objets légitimes ». Ainsi les albums jeunesse ne sont pas des outils pédagogiques élaborés pour le futur lecteur que l’enfant sera plus tard. L’enfant en est lecteur tout de suite. Il est lecteur d’images et, s’il peut être guidé par des adultes, cette pratique est vécue au présent. La pratique participative s’inscrit dans une pure logique de plaisir et de divertissement et pas d’apprentissage.
À titre d’exemple, on peut penser à la série de bande-dessinée muette Petit poilu : il s’agissait avec cette série de concevoir non pas une initiation à la BD, mais une bande-dessinée accessible aux enfants : il s’agit d’un objet totalement légitime pour les enfants même s’il peut aussi s’adresser aux adultes.
En savoir + : La série de bande-dessinée muette Petit poilu
La réception de films et de productions audiovisuelles
Il s’agit d’une pratique partagée par toutes les générations : les enfants ne se contentent pas des programmes pour enfants et, inversement, les programmes pour enfants ne sont pas vus que par les enfants. L’œuvre a une valeur en elle-même, il n’y a pas de cloisonnement des publics. Derrière cette accessibilité, il faut prendre en considération la notion d’apprentissage qui peut se faire là encore par participation, éventuellement en étant guidé, sans intérêt particulier pour le futur.
Il faut noter que les goûts et les intérêts de l’enfant ont des effets sur la production audiovisuelle. Petit Poilu est ainsi devenu une série télévisée. Mais on relève que, davantage que dans les albums, une dimension éducative seconde existe derrière la logique de divertissement.
Si on inscrit les enfants dans des pratiques créatives, on peut penser l’enfant comme un pratiquant légitime. C’est dans cette perspective que l’on a assisté à la valorisation culturelle du dessin d’enfant au début du vingtième siècle. Là non plus le dessin d’enfant n’est pas envisagé dans la perspective d’une future création. Aujourd’hui, certaines pratiques comme la photographie ou la vidéo deviennent plus accessibles aux petits car les obstacles techniques disparaissent.
Le chant et la musique
On constate la force du chant et l’implication des enfants dans les écoles maternelles. Dans certaines d’entre elles, une étude a été menée sur l’apprentissage de l’allemand grâce à des outils mis à disposition dans une mallette pédagogique : on a constaté le point fort que représentait la pratique du chant en allemand (ou toute langue étrangère) car il donnait l’impression aux enfants de réellement pratiquer la langue.
Les chorales d’enfants n’impliquent pas que leurs participants aient une relation particulière avec la musique. L’apprentissage se fait à partir de la participation dans le présent et, si les chorales peuvent créer des ressources pour des pratiques musicales futures, elles ne se limitent pas à cela. On pourrait développer le même type d’argumentation pour le spectacle vivant, de même que pour les activités sportives qui répondent aux mêmes logiques. Les enfants participent, c’est là leur grande richesse. Quelle place leur accorder ? Le futur doit-il être une donnée à prendre en considération ?

Apprendre en participant
Il existe plusieurs traditions d’apprentissage par participation, en particulier :
1) Les logiques de participation délibérée à une communauté (et non par hasard) : les enfants sont tout à fait capables de s’engager dans ce type de participation. La psychologue américaine Barbara Rogoff a travaillé sur l’importance des modalités d’apprentissage par participation, notamment en étudiant l’apprentissage du tissage par des enfants avec des adultes dans des communautés indiennes.
2) Les logiques de répétition guidée. On peut dans ce contexte distinguer deux temps, mais qui restent fortement associés : les nouveaux participants sont d’abord isolés pour observer les pratiques, puis ils sont intégrés pour y participer. Dans ce cas, on est pratiquant, tout en étant soutenu par des spécialistes de la pratique même (une configuration qui se distingue nettement de l’apprentissage scolaire). Jean Lave et Etienne Wenger ont développé la notion de « participation légitime périphérique » : avant d’avoir la maîtrise totale d’une pratique, les enfants commencent par observer, en marge, avant de jouer un rôle simple, puis plus complexe.
Dans les pratiques culturelles, on ne distingue pas deux temps distincts, l’un qui serait consacré à l’apprentissage et l’autre à la participation.
La spécificité du domaine culturel
D’abord, le monde de la culture est partageable entre générations et il s’agit de donner une place à l’enfant dans la continuité des pratiques adultes. Ensuite, en même temps que l’enfant apprend la complexité de la culture, il en est contributeur : quand l’enfant ou l’adolescent met en ligne ses propres créations sur Internet, il n’est plus seulement en situation d’apprentissage, mais revendique d’être un véritable pratiquant.
En conclusion, il est important de prendre de la distance avec les idées d’éducation ou d’éveil orientées uniquement vers le futur. Il ne faut pas effacer le présent et l’enfant est aussi un participant ! Cela implique par conséquent de relativiser la notion d’éveil culturel.
Questions du public
Pouvez-vous développer la notion de jeu libre chez les enfants qui, dans ce cas, ont la capacité de se mobiliser eux-mêmes ?
Gilles Brougère : Je préfère la notion de décision, plus opérationnelle, à celle de liberté. Ce type de jeu est caractérisé par la décision que prend l’enfant. Là aussi on constate que le jeu comporte un second degré car il parle d’autre chose que de lui-même. La prise de décision y est centrale, contrairement à la lecture où à des activités où l’enfant est spectateur. Dans les activités de création, on constate également une prise de décision mais pas nécessairement de second degré : l’enjeu est de produire quelque chose, de laisser une trace.
L’intérêt pour l’enfant est d’avoir accès à une palette importante : être récepteur, créateur, joueur. Ce sont des postures que je ne confondrais pas. Les enfants sont tous participants à des pratiques différentes où ils font semblant ou bien prennent des décisions. Le jeu articule les deux : l’enfant décide de faire pour de faux, sans conséquences. S’il décide de voler par exemple, la décision est énorme mais sera sans effet.
Quand l’enfant est en posture de réception, il entre dans un monde de fiction, de faux-semblants, et il peut l’interpréter d’une certaine façon. Lorsqu’il est en posture de production, la décision est mise en avant pour créer quelque chose qui aura des conséquences. Il pourra par ailleurs échanger et montrer sa création à d’autres. Ces pratiques culturelles ne sont pas des jeux, un artiste n’est pas un joueur. Le joueur, une fois le jeu terminé, peut recommencer, c’est une activité plus frivole. A l’inverse, on peut être jugé sur le résultat d’une production.
Xavier Grizon : Dans le cadre d’un atelier « Faire un film » on peut considérer que l’on est à cheval entre le « faire semblant » d’être réalisateur et la création. Il y a bien ce plaisir du faire « comme si », mais avec une prise de décision qui concerne la réalisation d’un film.
Gilles Brougère : Cela touche à la question du plaisir : c’est ce qui fera que l’on est vraiment un participant. Ce plaisir provient de l’intérêt que l’on ressent pour ce que l’on fait et non pas de l’idée que l’on pourra en tirer profit plus tard. Il faut bien distinguer deux façons d’envisager les choses : soit on met l’enfant dans le présent, soit on le prépare à sa vie future.
TROIS EXPÉRIENCES INNOVANTES
Présentation par Ludovic Blanchard, coordinateur pour l’association 1.9.3 Soleil!, Cécile Martino, éducatrice à la nouvelle crèche Maryse Bastié de Romainville, Laurent Duret, producteur de l’application La grande histoire d’un petit trait, Peggy Hartmann est réalisatrice et médiatrice culturelle, Christelle Regnier est intervenante pour l’association Et si les images…

L’accompagnement des professionnels par l’association 1.9.3 Soleil! : un pôle ressource en matière de spectacle vivant pour les tout-petits
Ludovic Blanchard présente l’association 1.9.3 Soleil! qui organise depuis 10 ans un festival dans des théâtres, parcs et crèches. 1.9.3 Soleil! propose également un parcours de sensibilisation des professionnels de la petite enfance à l’accompagnement des tout-petits au spectacle vivant. Enfin, elle conseille et accompagne des spectacles de qualité dans des crèches (départementales et autres) sous la forme d’un dispositif en trois temps : sensibilisation des équipes en amont, présence lors de la représentation et bilan quelques jours après la représentation.
L’un des enjeux du festival est de sensibiliser le personnel des crèches à l’accueil des jeunes enfants lors d’un spectacle. Lors de la dernière édition, une journée professionnelle autour de « l’enfant, l’art et la nature » a été organisée pour pointer du doigt le déficit de nature dans l’environnement immédiat des plus jeunes. En 2016, c’est le thème du jeu avec les éléments naturels qui a été proposé à partir des propositions de différents artistes.
Ces spectacles sont conçus pour la tranche d’âge 0-4 ans mais aussi pour les adultes qui doivent se sentir concernés, sur le plan sensoriel et non pas intellectuel. Dans un second temps, c’est la dimension de participation qui est recherchée à travers un parcours ludique et sensoriel dans le décor du spectacle ou dans un espace attenant. Dans le cas de Sococoon, le spectacle est totalement immersif : on entre véritablement dans la proposition artistique avec la mise en scène d’un espace ludique.
En savoir + : Le spectacle Sococoon
Xavier Grizon : Cette dimension de participation paraît davantage exploitée aujourd’hui. Existe-t-elle depuis toujours ?
Pour Ludovic Blanchard, le manque de recul empêche d’envisager cette question sur une période longue. Mais les expérimentations évoquées sont menées avant les représentations dans les théâtres : elles répondent au besoin des artistes d’être au contact des enfants et de ce qu’ils peuvent leur proposer. Les parents qui font suivre leurs enfants en PMI ou qui fréquentent les centres sociaux n’ont pas l’habitude d’aller au spectacle. Il arrive même que le simple fait de présenter ces propositions précisément comme des spectacles crée une barrière, et ce sont les enfants qui vont la briser.
En savoir + : 1,9,3 Soleil !
Cécile Martino travaille au sein de la crèche Maryse Bastié qui remplace l’ancienne crèche Youri Gagarine. Lorsque le nouveau projet de la crèche a été défini, un véritable projet sensoriel y a été intégré. Inspirée par une intervention proposée par 1.9.3. Soleil! autour du spectacle Sococoon, l’équipe a orienté l’aménagement de différents lieux selon des principes de stimulation et de repos, entre apaisement et éveil.

© Sococoon – 1,9,3 Soleil !
L’espace de vie des bébés comporte plusieurs espaces aménagés autour de différentes matières, couleurs et contrastes (certains accessoires comme les coussins sensoriels ont même été fabriqués par le personnel de la crèche). Un chemin conduit à un « espace cocooning » matérialisé par une tente.
En crèche, les enfants sont confrontés à de fortes stimulations émotionnelles produites par la séparation autant que par l’éclairage artificiel, le bruit, le mouvement. La crèche Maryse Barbier accueille 70 enfants : cette réalité est source de tensions, de conflits, de gestes agressifs…
Pour les plus grands, l’équipe a pensé l’aménagement de l’espace dans un lien avec l’image, dans la continuité de l’approche Snoezelen développée aux Pays-Bas dans les années soixante-dix. L’objectif initial de cette méthode était de faire entrer les personnes en situation de handicap en contact avec les autres à travers le prisme du « sensoriel ». Plus généralement on a constaté les effets d’apaisement procurés par cette approche.
En savoir + : L’approche Snoezelen
Au sein de la crèche, un espace a été aménagé à l’extérieur des salles de vie pour accueillir ponctuellement un ou deux enfants accompagnés d’un adulte. L’espace, plongé dans le noir, permet des stimulations visuelles et sensorielles : une tente noire y a été installée avec un projecteur à huile, un projecteur d’aurore boréale, une colonne à bulles, des jeux en bois, différentes matières à toucher (sable, eau, paillettes, grelots…), un tableau lumineux à intensité variable, des balles lumineuses… L’enfant y est acteur car il peut manipuler les objets.
Un budget spécifique a été alloué par le Département de la Seine-Saint-Denis à cet aménagement car le matériel est assez onéreux.
L’application Grande histoire d’un petit trait : un conte poétique et interactif où vous dessinez pour donner vie au récit

© La grande histoire d’un petit trait
La grande histoire d’un petit trait raconte comment un petit garçon devient dessinateur grâce à son ami : un petit morceau de trait rouge qu’il trouve un jour au bord d’un chemin. L’application a été imaginée par Bachibouzouk et l’histoire écrite par Serge Bloch, aujourd’hui célèbre dessinateur. Le scénario interactif explore le récit de Serge Bloch et propose en 20 chapitres un récit vivant et plein de magie. Dans ce conte, l’enfant est à la fois lecteur ET dessinateur. En donnant vie aux dessins, il donne vie à l’histoire !
En savoir + : La grande histoire d’un petit trait
La création de l’application La grande histoire d’un petit trait a été conçue à partir du court métrage Moi j’attends produit par les Films d’ici, lui-même adapté de l’ouvrage de Davide Cali et Serge Bloch (Éditions Sarbacane). L’enjeu était d’intégrer des couches d’interaction à partir du court métrage : il fallait concevoir une application où les choix soient multiples et où le dessin fait par l’utilisateur soit pleinement intégré dans l’histoire.
Avec les enfants, il est inutile d’expliquer comment utiliser l’application, en revanche cela devient indispensable avec les parents et plus encore avec les grands-parents ! Dans le mode tutoriel, on traverse simplement plusieurs étapes où le dessin devient de plus en plus compliqué et où chacune d’elles va engendrer de la narration (sachant qu’il est toujours possible de gommer : cela fait partie de l’acte de dessiner). C’est précisément l’animation du dessin tracé par l’animateur qui est source de plaisir. Au fil de la narration, le personnage de l’enfant grandit et il se passe de plus en plus de choses à l’écran.
L’application implique et éveille l’enfant qui s’en empare parce que le dessin évolue. On peut aussi l’utiliser sans modèle de dessin, en mode totalement libre. C’est un hymne au dessin qui réfléchit à de nouveaux modes de narration. Or il faut réfléchir autrement si l’on veut raconter des histoires au plus grand nombre.
Les sources de financements sont publiques : le CNC et France Télévision qui a acheté le court métrage. L’enjeu le plus important est de réussir à se faire connaître. Cela passe par un travail de community management mais aussi par un appel à financement participatif. L’application est largement utilisée en bibliothèques. Aujourd’hui plus personne n’achète d’application : on fonctionne désormais sur le modèle de la gratuité. Il faut donc réfléchir à des modèles alternatifs. En Allemagne, une marque de fournitures de dessin a décidé d’offrir l’application à ses clients.
L’application Grande histoire d’un petit trait est gratuite et disponible en sept langues sur App Store et Google Play.
L’incertain destin d’Amélie Pranltrin : un jeu de plateau grandeur nature imaginé par l’association Et si les images…
L’incertain destin d’Amélie Pranltrin permet de prendre conscience de l’importance du montage dans la structure narrative. Le principe du jeu est simple : il s’agit de faire un montage aléatoire à partir de plans déjà tournés. Chaque plan correspond à un chiffre qui est déterminé par le lancer d’un dé. On ajoute donc un nouveau plan à chaque nouveau lancer jusqu’au plan final où le personnage principal, Amélie, prend le train (dernier plan du film). Une fois le montage image effectué, il s’agit pour les participants de créer une bande-son à partir d’une mallette à bruitage remplie d’accessoires. La bande son est intégrée aux images et le film prêt à être visionné. C’est un véritable travail d’équipe !
En savoir + : Et si les images…
Xavier Grizon : Comment êtes-vous arrivées à concevoir un atelier plutôt ludique où la création en tant que telle n’est pas si importante ?
Peggy Hartmann relate l’envie initiale de revenir sur un aspect technique du cinéma (le montage, le son, le bruitage, le rôle du clap) en passant par le jeu. Par ailleurs il fallait que cette approche soit collective et s’inscrive dans le cadre d’une activité d’éveil. En introduction à l’atelier, Peggy Hartmann projette son « propre » film sur le personnage d’Amélie, réalisé de façon totalement amateure. Cela lui permet de désamorcer l’appréhension des participants qui pensent qu’ils pourront toujours faire mieux qu’elle ! La décision de participer au jeu est laissée à l’appréciation des spectateurs qui peuvent rester observateurs s’ils le souhaitent.
Regarder un extrait L’incertain destin d’Amélie Pranltrin
À LA RECHERCHE DES POINTS DE VUE DES JEUNES ENFANTS
Conférence par Sylvie Rayna, psychologue et maître de conférences en sciences de l’éducation, responsable du programme transversal « petite enfance » d’EXPERICE de l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité.
Cette intervention envisage la relation entre le ludique et le culturel et s’articule autour de la notion d’attention. L’approche envisagée par Sylvie Rayna est principalement psychologique, mais pas seulement. Elle travaille en effet au sein de plusieurs équipes pluridisciplinaires : le Cresas (Centre de recherche de l’éducation spécialisée et de l’adaptation scolaire de l’Institut de recherche et de documentation pédagogique), Experice (Centre de recherche interuniversitaire expérience ressources culturelles éducation de Paris 13), mais aussi dans le cadre de réseaux internationaux.

Repères chronologiques
Les premiers travaux auxquels elle a participé au début des années 70 portaient sur le jeu libre (sans consigne). C’est à cette époque que les premières explorations sur les tout petits ont débuté. On étudiait les relations entre les bébés et la logique, les bébés et la physique. On a constaté que les tout petits introduisent de l’ordre : ils classent, ils font des séries, ils mettent ensemble ce qui va ensemble, sans que cette contrainte leur soit imposée. Des études en Iran et aux Etats-Unis allaient dans le même sens et il semble que cela soit une pratique propre à l’espèce humaine (les grands singes ne se comportent pas de la sorte).
Or on n’imaginait pas que les bébés pouvaient se concentrer (ils peuvent en fait passer une demi-heure, voire une heure à manipuler du matériel), ni qu’ils pouvaient communiquer entre eux (on a constaté que des bébés inscrits en crèche chez les moyens pouvaient se regrouper par deux ou trois, voire quatre, et instaurer des jeux de courses et de poursuites spontanés).
Il a donc été décidé de proposer du matériel à manipuler à des petits groupes et non plus seulement à des enfants pris isolément. Dans les trois-quarts des cas, les séquences de jeu ont été partagées spontanément. Cela a permis de forger des arguments de poids pour la mise en place de structures d’accueil collectif : l’adulte n’est pas le seul éducateur !
Jean Piaget a cherché à mettre au jour le cheminement de la pensée des enfants à partir de ces observations. Un enfant va reprendre des idées à un camarade et les modifier. Ce principe d’homologie se retrouve également chez les adultes chez lesquels on observe des phénomènes de reprises d’idées qui ne se réduisent pas à de simples copier-coller.
Dans le cas d’expériences ludiques, on constate des différences d’un pays à l’autre. En effet, l’ancrage culturel des pratiques ludiques est très important et il faut bien distinguer les mécanismes psychologiques universels des constructions qui passent par l’expérience.
En 1979, on a proposé à des enfants accueillis en crèche à Paris, en sections mélangées, d’assister à un spectacle de marionnettes. On a constaté que, dans la foulée, ils improvisaient eux-mêmes des spectacles : à l’heure du déjeuner, ils jouaient des petites scènes avec des aliments au bout des doigts et le même phénomène se reproduisait à la maison ou dans les transports. Les enfants-spectateurs attentifs étaient passés « de l’autre côté », en particulier ceux âgés de deux à trois ans. À travers ces reprises, ils tentaient de maîtriser ce qu’ils avaient pu voir.
Si l’on étudie le langage employé dans le cadre de ces petits spectacles spontanés construits à partir de séquences vécues, observées ou inventées, on remarque les formes suivantes :
- Le « Si… alors » : une forme de raisonnement.
- Une façon de tenir l’attention du public à travers le langage.
- Des constructions sociales communes qui mettent en scène les relations enfants/adultes, enfants/éducateurs, avec toute une palette dans ces relations.
Ils expriment un point de vue sur le monde social avec beaucoup d’humour. Une des premières éducatrices à avoir introduit les spectacles de marionnettes en crèche a fondé un club. Celui-ci s’est développé et des relations inter-crèches sont nées de ce projet. Depuis, des professionnels se transmettent les pratiques.
En 1989, un protocole d’accord sur l’éveil culturel a été signé pour une politique interministérielle incitative pour la petite enfance. Les parents y ont été associés et un volet formation y figurait. Une enquête nationale a été lancée pour évaluer la politique de démocratisation de la culture envers les tout petits. En dominantes de ce protocole d’accord figuraient la lecture et la musique.
À cette époque, en crèche et en maternelle, la lecture n’était que très peu envisagée sous l’angle du plaisir. On publiait d’ailleurs peu de beaux albums jeunesse. A la maternelle, une tradition artistique existait, héritée des années soixante-dix, période « expressive », mais elle a peu évolué dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Depuis, on assiste à une forme de reprise à la hausse de ces problématiques. Lors d’une première enquête effectuée entre 1990 et 1995, les acteurs du secteur ont pris la mesure du fait que les arts vivants n’étaient pas financés. Sylvie Rayna et ses collègues ont alors eu connaissance d’une expérimentation menée dans les Pays de la Loire par Brigitte Lallier-Maisonneuve qui a présenté le spectacle multivocal Archipel de Laurent Dupont, véritable chef-d’œuvre, conçu pour les tout-petits à partir de 10 mois.
En savoir + : Le spectacle multivocal Archipel de Laurent Dupont
La lecture, pratique participative
Depuis 1999, Sylvie Rayna parraine l’association L.I.R.E (Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion) à Paris qui s’inscrit dans la pratique d’A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations). La lecture est pensée comme individualisée mais partagée : elle vise la participation de tous, professionnels, parents, enfants. Des lectrices ont observé, à l’occasion d’une expérience menée dans des salles d’attente de PMI, que les enfants repèrent très rapidement ceux qui leur plaisent, dans un choix d’albums placés et mis en scène. Ils sont attentifs à la charte graphique, mais aussi à la qualité du texte et des illustrations.
Les albums de comptines et de pratique du lire-chanter sont appréciés : le chant est premier, les enfants sont sensibles à la musicalité des mots, à la musicalité de la communication préverbale, voire intra-utérine. Un des albums privilégié est Pomme de reinette illustré par Julia Chausson. Il a même été utilisé pour un bébé né à 1,7 kg auquel on a fait écouter beaucoup de comptines. La lecture et le chant permettent une humanisation culturelle dans un univers médical. Chez lui, le papa a poursuivi cette pratique.
Autre exemple d’album jeunesse qui met en avant la beauté artistique et des images : Bateau sur l’eau illustré par Martine Bourre (éd. Didier Jeunesse). On constate que la participation des enfants sera d’autant plus grande que les images seront complexes et variées.
Parmi les albums les plus recherchés par les enfants, on retrouve les albums de comptines, mais aussi les albums découverts à l’école, traités de façon pédagogique qui seront repris autrement.
Sylvie Rayna a été lectrice dans un square du 19e arrondissement de Paris, dans le cadre des Bibliothèques hors les murs. Elle précise que les enfants peuvent adopter soit une participation centrale soit une participation périphérique. L’essentiel est de mettre en place une attention conjointe avec eux. Le regard est une forme de participation et de réflexion intenses.

Le point de vue des enfants
Pour interroger directement le point de vue des enfants, il peut être intéressant de se référer aux travaux d’Alison Clark qui a permis à de jeunes enfants de participer à ses recherches. Dans cette lignée, on peut proposer aux petits la pratique du dessin, du modelage, de la photographie, envisager des interviews ou encore des visites guidées menées par des enfants. En Suède, on a mené des recherches sur la qualité des jardins des structures suédoises en s’appuyant sur l’idée que l’enfant était un expert de sa propre vie. On a ainsi positionné l’enfant comme influent pour évaluer sa qualité de vie, y compris des enfants de niveau préscolaire.
Chez Experice, les chercheurs ont commencé à travailler sur le point de vue de l’enfant à partir de quatre ans et des études ont été menées dans plusieurs pays. On a montré aux enfants un film d’une vingtaine de minutes où ils découvrent d’autres enfants à l’école. Les petits spectateurs avaient la possibilité de commenter ces vidéos et de faire des arrêts sur image. Il en ressort que les moments de jeu avec consignes sont désignés par les enfants comme du « travail » : la consigne fonctionne comme un indice aux yeux des petits pour repérer s’il s’agit d’un moment de jeu ou non.
Le véritable « jeu », du point de vue des enfants, correspond au jeu libre auquel ils peuvent s’adonner lorsqu’ils ont terminé les ateliers. L’espace de jeu préféré est la cour, surtout celle des autres pays qui représente un vrai terrain d’aventures ! Le point de vue des enfants correspond donc à notre point de vue de chercheur : ils ont une expertise.
Dans le cadre d’une autre étude, on a fourni à des enfants de deux ans (en maternelle, en classe passerelle, en crèche ou jardin d’enfant) des appareils photo. On leur a demandé de photographier ce qu’ils aimaient et ce qui les intéressait le plus. On ne photographie jamais le monde, mais un monde particulier, celui qui fait sens pour nous. Les enfants ont manifesté une forte participation.
Ils ont en majorité photographié des « agents socialisateurs » :
1) Les copains, pris individuellement ou en groupes, sous toutes leurs formes représentent la majorité des clichés.
2) Les adultes.
3) Le cadre matériel. On a constaté un intérêt particulier pour le sable, la terre, le naturel, le végétal.
Les enfants explorent consciencieusement l’ordinaire. On observe un goût pour la beauté des déchets, ils regardent ce qui nous semble insipide. Ils traquent les lumières, les ombres, les reflets. Il s’agit là d’une expérience créatrice qui montre l’invu, les objets abandonnés, l’absence. Des photographies se concentraient sur les formes du paysage : les escaliers, des barreaux, des bancs, des rayures, certaines sur des couleurs pures, visibles sur des jouets par exemple, ou bien des flaques.
On peut dans cette perspective se référer aux réflexions de Serge Tisseron sur la pensée et les actes. Ici les enfants documentent leur vie, ils deviennent tout autant reporters qu’artistes. S’agit-il d’un jeu ? On se trouve à une frontière mais aussi sur un terrain d’inclusion qui permet de prévenir les discriminations.
Quant au cinéma, ces réflexions ouvrent sur les questions suivantes : quelle offre ? Quelles pratiques d’accompagnement ? Quelles pratiques de spectateurs ? Qu’en pensent les enfants ?
Questions du public
Y a-t-il des choses que les enfants n’ont pas photographiées ?
Gilles Brougère : Les lieux interdits ! Certains ont photographié les portes menant à des lieux interdits. Les enfants ont par ailleurs profité de cette action pour faire des choses qu’ils n’avaient pas le droit de faire en temps normal : aller voir d’autres classes par exemple. Ils se sont émancipés par le pouvoir d’agir.
Que faire des émotions du spectateur dans les dispositifs scolaires d’éducation au cinéma (6-13 ans) ?
Cet après-midi a été consacré à la question des émotions. De cette thématique très vaste découlent plusieurs sous-thèmes, comme celui du choix des films dans les dispositifs et le questionnement sur « ce que les films pourraient provoquer ».
PEUT-ON ENSEIGNER LE PLAISIR DU CINÉMA ? RÉFLEXIONS SUR LES DISPOSITIFS NATIONAUX D’ÉDUCATION À L’IMAGE
Conférence par Léo Souillés-Débats, maître de conférences en études cinématographiques à l’Université de Lorraine.
Léo Souillés-Débats a travaillé sur « les films qui inquiètent » dans les dispositifs d’éducation à l’image. Une version augmentée du texte qu’il a produit à ce sujet, « Sur quelques « films à problèmes » dans les dispositifs nationaux d’éducation à l’image », est en ligne sur le site de la revue Esprit. Son propos est centré cette fois-ci sur les goûts et les pratiques cinématographiques des élèves français et plus particulièrement sur la notion de plaisir au cinéma. En s’appuyant sur l’observation de Collège au cinéma, dans la continuité de l’étude qu’il a réalisée sur les 203 films programmés dans le cadre du dispositif entre 1989 et 2015, Léo Souillés-Débats s’est interrogé sur la place et le rôle du plaisir dans la constitution d’une culture cinématographique au sein du cadre scolaire.
En ouverture de son intervention, Léo Souillés-Débats précise que, s’il est aujourd’hui maître de conférences en cinéma à l’Université de Metz, il parle aussi en tant que rédacteur en chef de livrets pédagogiques pour Collège au cinéma (responsabilité qu’il a exercée pendant quatre ans), en tant que « digital native » et en tant qu’ancien élève ayant participé aux dispositifs Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma. Il précise par ailleurs, qu’il n’a jamais enseigné pour l’éducation nationale.

« Les jeunes » et le cinéma
Léo Souillés-Débats ouvre sa conférence en rappelant que de nombreux fantasmes, idées reçues et représentations diverses influent sur la définition que l’on peut proposer du « jeune ». Il faut prendre le temps d’observer cette tranche d’âge pour confirmer ou contester ces lieux communs.
Regarder un extrait du reportage « Les jeunes et le cinéma » programmé sur l’ORTF en 1962
Dans ce reportage, distinction est faite par la voix-off entre le cinéma comme distraction et le cinéma comme enseignement ou pédagogie. Certains « jeunes » interrogés font de la mise en scène un critère d’évaluation des films.
Pour préciser cette perspective historique (les jeunes d’hier, les jeunes d’aujourd’hui), il est intéressant de se pencher sur le cycle de vie du spectacle cinématographique en salle. On constate que :
- 1947 est la meilleure année en termes de fréquentation.
- 1957 est la meilleure année en termes de recettes.
- À partir de 1957 on observe une chute de la fréquentation avec une année noire en 1992.
- En 1994 on assiste à une légère hausse de la fréquentation, tendance qui s’accentue dans les années qui suivent.
- Aujourd’hui, on est revenu à des taux de fréquentation comparables aux années soixante. Les jeunes contribuent massivement à cette reprise.
Parallèlement, il faut rappeler que la VHS a fait son apparition dans les foyers dans les années quatre-vingt. Canal+ est lancée en 1984, La Cinq en 1986, TF1 est privatisée en 1986-1987. À la télévision, le nombre de films diffusés augmente sensiblement. En 1988, le premier multiplexe ouvre ses portes en Europe. En 1990, le « World Wide Web » (le web) fait son apparition, ouvrant la voie à des sites comme Napster qui utilisent le peer to peer. En 2004, le web 2.0 est lancé, avec la possibilité de télécharger des films illégalement. En 2005, la TNT s’invite sur le petit écran, suivie en 2012 par la TNT HD.
On pourrait donc penser que nous avons de nombreuses raisons de ne pas aller au cinéma. Et pourtant nous y allons. À commencer par les jeunes, dans les multiplexes. Certes, dans une enquête publiée par le CNC en 2009, les jeunes sont présentés comme privilégiant les petits écrans et le téléchargement. Mais il s’avère a contrario que les personnes qui vont le plus sur Internet sont celles qui vont le plus au cinéma, au musée, au théâtre et sont les plus gros lecteurs. Certes, en 2009, YouTube n’existait pas encore…
En 2014, Benoît Danard (CNC) a réalisé une étude, Les jeunes et le cinéma, où il montre que, chez les 15-24 ans, le cinéma est une pratique collective plus spontanée que pour les autres tranches d’âge. Ils fréquentent en outre plus souvent les salles le week-end de la sortie d’un film. En revanche, si nous sommes tous plus allés au cinéma en 2013 qu’en 1993, il n’en allait pas de même pour les seuls 15-24 ans.
L’exemple des films de Collège au cinéma
Le dispositif Collège au cinéma a été conçu en 1987 alors que les chiffres de fréquentation des salles étaient au plus bas. La FNCF a proposé au CNC et au ministère de l’éducation national un projet d’initiation à l’art cinématographique afin de « réapprendre aux jeunes à voir des films dans leur format d’origine ». A-t-on désappris à voir les films ou bien a-t-on été mal formé ? Pourquoi faudrait-il réapprendre et non pas simplement apprendre ? En tout état de cause, le point de départ du dispositif consiste à sensibiliser les collégiens à la salle de cinéma et le projet est officialisé en 1989.
Léo Souillés-Débats est l’auteur d’une étude sur le corpus des 203 films qui ont fait partie de la liste nationale Collège au cinéma entre 1989 et 2015. Il s’est livré à quelques calculs qui sont toutefois à prendre avec précaution : un film issu de cette liste obtient en moyenne sur Allociné une note de 4,1/5 de la part des critiques de cinéma et une note de 3,6/5 de la part des spectateurs, a réalisé 1,6 millions d’entrées, obtenu deux récompenses et dure 99 minutes.
Il a également constaté qu’Agnès Varda était la seule réalisatrice de la liste. En termes de nationalités, si les Etats-Unis restent dominants (27,1% des films), les autres films sont d’origine assez éclectique : la plupart des continents sont présents, avec une plus faible représentation de l’Asie. Les films sont en majorité récents, certains très récents.
Léo Souillés-Débats a tenté de poser un regard plus personnel sur cette liste et s’est interrogé sur la présence, dans ces films, d’enfants incarnant les rôles principaux : il s’est avéré que les deux tiers des protagonistes sont effectivement des enfants. Léo Souillés-Débats s’est alors remémoré ses premiers « chocs » cinématographique et a constaté qu’il n’y avait pas d’enfants dans les films qui l’avaient profondément marqué. Pour comprendre le plaisir qu’éprouvent les jeunes au cinéma, mais aussi le nôtre, il faut comprendre quelles sont leurs références par rapport aux nôtres. En particulier, on peut se demander si un film pour enfant est nécessairement un film avec des enfants.
En observant la liste des films de Collège au cinéma un peu plus précisément, on constate que les films de patrimoine comportent moins de rôles d’enfants : le statut d’œuvre patrimoniale permettrait d’aborder certains sujets sans le recours à un personnage enfantin. Cela pose donc la question de l’identification des enfants face à des films récents, plus proches d’eux. Pour cela, il faut se demander ce que regardent les jeunes aujourd’hui, indépendamment des films de Collège au cinéma, sachant que, parmi les films les mieux classés au box-office, peu nombreux sont ceux qui ont des enfants ou des adolescents pour personnages principaux
Mieux connaître le plaisir des adolescents au cinéma peut être un point d’entrée pour les amener à considérer les films proposés par Collège au cinéma. Cela peut aider à trouver des connexions. Or on constate une réelle réticence, dans les commissions de sélection du dispositif, à aborder les films dits « non nobles », ceux qui manifestent une volonté commerciale. « Blockbuster » est un terme connoté péjorativement, qui renvoie à un plaisir coupable, qu’on n’ose pas aborder dans le cadre scolaire.
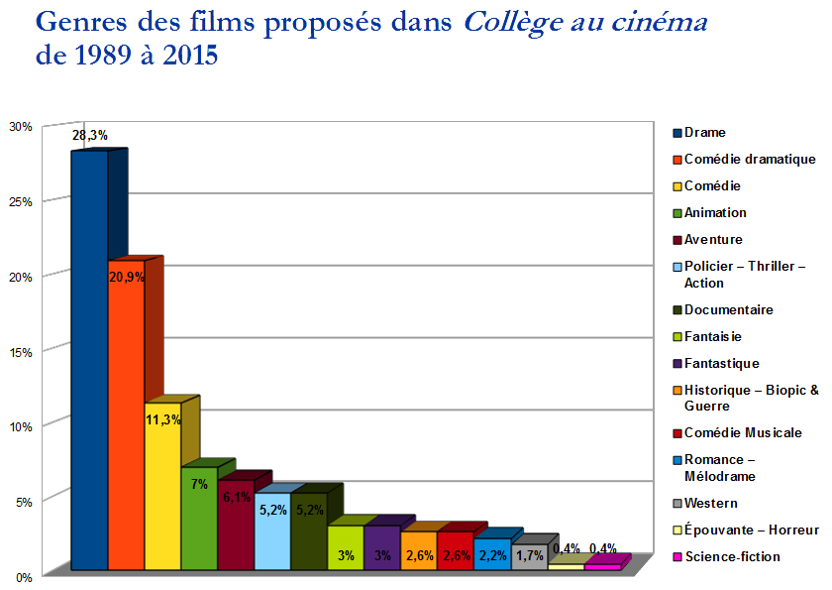
Parmi les films de la liste de Collège au cinéma, 28,3 % sont des drames, puis viennent les comédies dramatiques (20,9%), suivies des comédies (11,3) et des films d’animation (7%). Les thèmes abordés appartiennent aux registres suivants : adolescence, famille, guerre, conte, immigration, père, fils… Ces thématiques sont éloignées de la consommation des jeunes !

Marion Guillaume, une étudiante travaillant sous la direction de Léo Souillés-Débats, a interrogé quatre-vingts élèves ayant participé au dispositif Collège au cinéma en Ile-de-France : ils sont 25% à avoir apprécié les films du dispositif, 25% à ne pas les avoir aimés et 40% ont répondu « Bof ». Ce qu’ils ont préféré dans le dispositif est la possibilité de découvrir de nouveaux films. L’envie, la curiosité sont donc bien là. 50% des élèves se rendaient régulièrement au cinéma avant de participer à Collège au cinéma, 50% s’y rendaient rarement. Dans 72% des cas, ils déclarent que cette expérience ne va pas les inciter à s’y rendre plus souvent.
On constate toutefois que la fréquentation des 25-34 ans a augmenté entre 1993 et 2013 et cette tranche d’âge correspond à la première vague de spectateurs ayant participé à Collège au cinéma depuis sa création. On peut donc légitimement se demander si Collège au cinéma n’a pas contribué à inciter ces spectateurs à fréquenter davantage les salles de cinéma. Le dispositif pourrait avoir joué un rôle. Les collégiens d’aujourd’hui confirmeront-ils cette tendance ?
Penser une nouvelle cinéphilie ?
Dans son article intitulé Malentendus et désaccords sur le plaisir cinématographique, rédigé à partir d’une étude sur des lycéens de la région Rhône-Alpes, le sociologue Tomas Legon remarque qu’on attend des élèves qu’ils prennent du plaisir à voir des films. Or ceux-ci ne le savent pas ! Ils ne savent pas qu’ils ont le droit de ressentir du plaisir lors d’une séance dans le cadre d’un dispositif scolaire. Ce qu’ils préfèrent précisément dans ce dispositif, c’est sortir du cadre scolaire. Comment dès lors dédramatiser ce rapport à l’institution scolaire en dehors de l’établissement ? Le cadre scolaire est-il condamné à demeurer un handicap ou peut-on dépasser ce paradoxe ?
Consulter l’article Malentendus et désaccords sur le plaisir cinématographique de Tomas Legon
Par ailleurs, il faut envisager l’évolution de la culture cinématographique en fonction des générations. En 2012, le British Films Institute a publié la liste des cent meilleurs films de l’histoire du cinéma d’après des critiques reconnus : entre 1962 et 2012, les titres ont très peu changé et le poids des classiques est impressionnant Peut-être faudrait-il laisser une place à une nouvelle culture cinématographique, qui viendrait bousculer quelque peu un certain panthéon cinéphilique ? Adopter une autre posture que la bonne volonté culturelle selon laquelle « il faut aimer tel film » ? Un film comme Citizen Kane peut être très intéressant à analyser sans pour autant procurer du plaisir au spectateur.
Comprendre la consommation du jeune public est déterminant pour trouver un point de connexion avec lui Cette rencontre est-elle impossible dans le cadre scolaire ? Malgré la faiblesse de l’échantillon (seulement 80 élèves sondés), l’étude réalisée par Marion Guillaume tente de cerner ce qu’impliquerait la prise en compte du goût d’une génération dans la sélection des films. D’abord, les collégiens d’Ile-de-France interrogés sont 60% à déclarer être intéressés à l’idée de pouvoir choisir les films du dispositif. S’ils en avaient la possibilité, ils le feraient d’abord « selon leurs goûts » (21 %), mais aussi « en respectant les différents genres » (11 %). Le goût est une capacité de classement qui renvoie au plaisir et aux émotions. Quant aux genres, ils sont fortement identifiés par cette génération.
Mais le plaisir peut-il être enseigné ? On distingue traditionnellement le plaisir de la pédagogie, la distraction de l’apprentissage, comme si plaisir et distraction impliquaient une attitude passive. Les jeunes de la Nouvelle vague ont été mis sur un piédestal en raison de leur passion pour le cinéma : c’est leur amour du cinéma que l’on a retenu. De nombreux jeunes sont aujourd’hui passionnés par des films. Pourquoi se méfie-t-on aujourd’hui de ce rapport aux films alors qu’il était loué hier ? Par ailleurs il est évident qu’il existe un réel plaisir du raisonnement. L’émotion et la réflexion ne sont pas antinomiques.

Questions du public
Pourquoi ne pas parler des autres lieux de diffusion que sont par exemple les médiathèques ?
Léo Souillés-Débats : Les dispositifs d’éducation à l’image ont été conçus pour les salles de cinéma. Et la salle de cinéma est le meilleur endroit pour voir un film, mais ce n’est pas le seul. Mes chocs enfantins de cinéma ont, pour la moitié d’entre eux, été vécus lors du visionnage de films sur VHS. Le rôle des médiathèques est aujourd’hui sous-évalué car les enjeux économiques liés à la diffusion des films sont très forts.
Les blockbusters pourraient-ils avoir une place dans les dispositifs ?
Léo Souillés-Débats : Il faut assumer de faire des passerelles entre les films. C’est au médiateur de faire entrer sa culture dans le cadre du dispositif. Au niveau du terrain, Collège au cinéma est très souple et permet des expériences magnifiques. C’est en amont que les choses sont verrouillées.
Les enseignants ont eux aussi du mal avec l’idée de prendre du plaisir dans un cadre scolaire. Et faire découvrir le plaisir d’une œuvre est parfois difficile à concilier avec les impératifs des programmes.
Léo Souillés-Débats : Le public enseignant est tiraillé : si le cinéma a pu rentrer à l’école, c’est parce qu’il a su montrer patte blanche. On a pu considérer que « le cinéma c’est du sérieux ». Mais maintenant le cinéma est là. Pourquoi ne pas changer les règles ? Il est vrai que la pression des programmes est très forte et que des parents d’élèves peuvent aussi se plaindre si on s’en éloigne trop. Il faut aussi se demander si l’on peut mener une action de transmission sur un film que l’on n’aime pas.
CES FILMS QUI NOUS BOULEVERSENT ONT-ILS UNE PLACE DANS L’ÉDUCATION À L’IMAGE ?
Table ronde avec avec Joël Danet, programmateur-responsable d’enseignements de l’association Vidéo Les Beaux Jours, Laurent Pierronnet, responsable Jeune Public au cinéma Jacques Tati, Léo Souillés-Débats, maître de conférences en études cinématographiques à l’Université de Lorraine et Brigitte Sztulcman, conseillère pédagogique arts visuels et coordinatrice d’École et cinéma en Seine-Saint-Denis pendant 9 ans
Animée par Raphaëlle Pireyre, rédactrice en chef adjointe de Critikat.com.

Un jeu est proposé aux participants de la table ronde : ils doivent tirer au sort une question et y répondre.
Joël Danet : Mon premier souvenir de peur ? Superman 2. Lorsque Superman est en rivalité avec des méchants kryptoniens. Pour sauver Loïs, il doit entrer dans une cabine qui anéantira ses super-pouvoirs ! J’ai eu tellement peur que mon frère m’a conseillé de me cacher derrière les fauteuils.
Brigitte Sztulcman : Mon premier souvenir de colère ? J’ai été très en colère contre quelqu’un qui m’a emmené voir Frankenstein Junior, un film qui m’a fait très peur ! En le revoyant, je me dis que c’est incroyable d’avoir eu peur de ce film.
Laurent Pierronnet : Mon premier souvenir de joie ? Je vivais dans un petit village de Seine-et-Marne, j’allais rarement au cinéma. Le soir, je n’avais pas le droit de regarder la télévision. Je me cachais dans l’escalier pour regarder La dernière séance et j’ai un souvenir fabuleux de Robin des bois.
Léo Souillés-Débats : Mon premier souvenir de tristesse ? La deuxième séquence de Il était une fois dans l’Ouest, quand Jack tue toute la famille et que le pistolet se transforme en train. Sinon E.T. : pourquoi est-ce qu’il s’en va ? J’ai été inconsolable.
Raphaëlle Pireyre : Mon premier souvenir de dégoût ? Notre Dame des hormones, vu à Clermont-Ferrand. Je l’ai revu en tant que jurée dans le cadre du Festival Côté Court et on lui a remis une mention, comme quoi les émotions peuvent évoluer.
Raphaëlle Pireyre introduit la table ronde en rappelant que le cahier des charges des dispositifs pose comme objectif de reprendre le chemin des salles, mais met en place également une coopération entre le ministère de la culture et l’éducation nationale. Il s’agit de montrer des œuvres de cinéma en salle mais aussi de former une culture commune et de développer le goût et la sensibilité des élèves. Dans le cas d’École et cinéma, la liste est conçue pour proposer des films de qualité et porteurs d’émotions.
Mais l’émotion a-t-elle sa place à l’école ?
Brigitte Sztulcman rappelle qu’il faut envisager cette question à deux niveaux : celui des instances du CNC et en tant qu’enseignant. Les instances du CNC veillent à la qualité des films et envisagent la façon dont ils vont résonner avec l’intimité des élèves. Ces films sont souvent perçus comme difficiles par les enseignants et les encadrants : ils traitent de sujets rarement abordés à l’école qui touchent le « moi profond » des individus. Dès lors, comment les enseignants vont-ils pouvoir accompagner les enfants dans cette réception ? Les enseignants ne choisissent pas les films, mais ils en acceptent les conditions d’accompagnement.
Se pose la question de ce cadre par rapport à une œuvre d’art. On touche là à quelque chose de complexe, sachant l’articulation entre le temps alloué au dispositif et les obligations liées au suivi des programmes. De nombreux enseignants perçoivent les dispositifs comme « quelque chose que l’institution me propose ». C’est une erreur de jugement. Il s’agirait plutôt de considérer qu’« un objet culturel m’est proposé ».
Il faut aussi songer au fait que le film renvoie aux enseignants l’image qu’ils ont de ce qu’est l’enfance. Un enfant ne se réduit pas à l’élève. Et les enfants vont aussi avoir leurs propres émotions et leur propre réception par rapport aux films. Alice peut être un bon exemple à envisager à ce sujet : il y a eu une levée de boucliers contre le film qu’on accusait de faire peur. Rassurer les enseignants en leur expliquant que le film avait été montré maintes et maintes fois n’a pas suffi. On se heurte à un phénomène de transposition des émotions des adultes aux enfants. Il y a enfin le problème actuel de la culture cinématographique des jeunes enseignants qui vont très peu au cinéma et visionnent en revanche beaucoup de séries télé.
Raphaëlle Pireyre : Pour École et cinéma, les enseignants n’ont pas du tout le choix des films. Pour Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma, il arrive souvent qu’il y ait des films optionnels. Qui sont les membres des commissions nationales qui établissent les listes de films ?
Joël Danet détaille le profil des membres des commissions parmi lesquels on retrouve des membres de l’inspection académique, des exploitants art et essai, des représentants des Enfants de cinéma (pour École et cinéma), des Drac, de la DGESCO et, plus largement, du ministère de l’Éducation nationale…
Raphaëlle Pireyre : dans ces commissions, la question des émotions est-elle centrale ? Est-elle agitée comme un épouvantail ?
Joël Danet répond que les émotions sont évoquées, ainsi que leur gestion. Par exemple, avec L’Incompris de Luigi Comencini, on met le jeune spectateur à l’épreuve de lui-même. Le film est magnifique et montre que les émotions font partie de la vie, le personnage cherche à être « plus grand que soi ». On peut traiter cette question par la mise en scène et il faut bien sûr un discours pour accompagner ce choix.
Raphaëlle Pireyre : Comment se déroule l’accompagnement en amont, dans la salle ?
Laurent Pierronnet : Certains exploitants ou animateurs jeune public font partie des comités de pilotage et, dans ce cas, ils participent au choix des films programmés au niveau départemental ou régional. C’est le cas au cinéma Jacques Tati de Tremblay-en-France. « On est donc face à nos propres choix ». Par ailleurs, l’enfant ne vient pas seul dans la salle : il faut convaincre les adultes de l’intérêt de venir se confronter à l’œuvre qu’on a choisie pour lui. D’année en année, on observe davantage d’inquiétudes, un manque de confiance de la part des enseignants et des directeurs de centres de loisirs au sujet des films de patrimoine, de la violence, de la sexualité, de la religion… Il faut sans cesse faire un travail d’explication, de mise en confiance.
Actuellement, on a tendance à énormément se mettre à la place des enfants. En particulier, on leur refuse la possibilité de s’ennuyer, c’est très grave. Les adultes vont privilégier des films au montage agressif, des films d’action. C’est le cas par exemple de Tous en scène qui est sur les écrans actuellement. C’est un « shaker à émotions », on n’a pas le temps de se poser face à ce que l’on voit. Et des parents y emmènent des enfants de trois ou quatre ans !
Raphaëlle Pireyre : Considérons les films « qui posent problème » au niveau des émotions. à qui posent-ils problème ?
Laurent Pierronnet : Parmi les plaintes qui sont remontées par les coordinateurs, on compte des plaintes formulées par les parents, par les chefs d’établissements (plus rarement) et le rectorat (encore plus rarement). Ce sont les parents qui sont les plus inquiets. On ressent une réelle méfiance et une inquiétude envers les émotions. Elles vont être les garantes de la qualité d’un film, mais peuvent aussi le condamner. Il y a de bonnes et de mauvaises émotions. Or il est très difficile de se mettre à la place des enfants.
Il faut bien envisager cette prise de risque, cette responsabilité que nous avons. Nous essayons de reproduire ce choc cinématographique initial tout en étant responsables de ce qui peut se passer. On fait des suppositions, et on est souvent plus durs avec ses enfants qu’avec soi-même : nous sommes tous des censeurs en puissance ! « En tant que spécialistes, on nous demande de faire des choix objectifs, mais le cinéma, ça touche à l’affectif, à l’intime. »
Si l’émotion est constitutive d’un bon film, Léo Souillés-Débats considère qu’à l’inverse, l’ennui n’est pas une qualité : un bon film est un film où on ne s’ennuie pas. De plus, il n’est pas convaincu par l’idée selon laquelle un montage rapide et agressif empêcherait le spectateur de réfléchir.
Joël Danet estime que le plaisir ne doit pas devenir un diktat et défend l’idée qu’il y a plusieurs formes d’ennui. L’ennui peut ouvrir un moment où le spectateur fait retour sur lui-même, où il n’est plus en position d’éprouver un pur plaisir de spectateur. A la vision du Guépard, Joël Danet se souvient avoir ressenti de l’ennui et, en même temps, avoir perçu qu’il se passait quelque chose. L’ennui permet aussi le trouble, qui relève peut-être d’une certaine manière de l’émotion.
Laurent Pierronnet considère que, dans ce cas, l’ennui serait plutôt à comprendre comme une forme de méditation.
Regarder l’épisode Burlesque de Valérie Mréjen
Raphaëlle Pireyre : Comment redonner la parole aux enfants après la projection ? Comment envisager ce moment de retour sur les films ? Il est difficile de recueillir leur ressenti quand ils sont en groupe.
Laurent Pierronnet revient sur l’inquiétude des enseignants de ne pas maîtriser ce qui va se passer. « Les enfants viennent avec leur vécu, mais aussi leur classe et le regard des autres ». En maternelle, tout l’enjeu est de maîtriser le flot de paroles. En élémentaire, les enfants ont envie de s’exprimer et de comprendre ce qu’ils n’ont pas compris. Au collège, c’est la zone rouge, l’inhibition ! Au lycée, on retrouve une forme d’interaction.
L’animateur a souvent la crainte du blanc, du trop-plein d’émotions, des paroles difficiles à recevoir. Comment faire pour créer des interactions ? Pour valoriser la parole ? Il faut savoir créer une zone pour que la parole d’un élève soit respectée par les autres. L’objectif est bien de faire intervenir les spectateurs et que les enfants se répondent.
Pour Joël Danet, il est intéressant de reprendre le principe proposé par le film de Valérie Mréjen, à savoir commencer par décrire ce qu’on a vu. Toutes les classes d’âge ont cette aptitude. Décrire ce qu’on a vu permet d’exprimer les émotions. C’est une expérience qu’il a lui-même menée à partir de films d’Alain cavalier ou d’Agnès Varda et qui a donné lieu à de très belles analyses.
Brigitte Sztulcman approuve : on peut partir de ce qu’on a vu pour exprimer un accord ou un désaccord et aboutir à ce qu’on a éprouvé. Cela peut se faire en classe. Car il arrive que des enfants ne disent rien en salle sur ce qu’ils ont ressenti pendant la projection. Il faut savoir s’accorder un peu de temps pour cela.
Dans le cadre scolaire, dès l’élémentaire, on s’interdit un certain nombre de choses en tant qu’élève parce qu’on est sous le regard d’un enseignant : on répond à la demande de l’institution d’être précisément des élèves. On ne parle des émotions à l’école que depuis peu de temps, et cela se fait surtout en maternelle. Le fait de revenir au « je » et aux émotions est un processus très récent. Pour Brigitte Sztulcman, il existe une corrélation entre la prise en considération des émotions et la mise en place de parcours artistiques. On est passé d’une culture générale un peu élitiste à la prise en compte de la façon dont l’enfant se construit dans sa pratique artistique et culturelle.
Raphaëlle Pireyre : Comment recevoir les plaintes selon lesquelles les enfants seraient démunis face aux émotions ?
Selon Léo Souillés-Débats, ces plaintes impliqueraient qu’il faille protéger les enfants des images. Mais jusqu’où ? Cela pose la question de la confiance que l’on accorde non seulement aux institutions, mais également aux enfants eux-mêmes. C’est un sujet dont on prend tout juste conscience. Léo Souillés-Débats a étudié l’animation des ciné-clubs après la guerre. En 1946, Jean Michel, animateur de ciné-club à Valence, donnait les clés de la salle aux enfants qui se chargeaient de tout : la programmation, la copie, la caisse et éventuellement l’animation des débats. Le ciné-club a rencontré un immense succès. Face au public dit ouvrier et paysan, on n’allait pas aussi loin. L’infantilisation était plus marquée envers ces publics qu’envers les enfants !
Brigitte Sztulcman : Après la guerre, on a assisté à de nombreuses expériences avec des enfants. Ils étaient partie prenante de leur éducation. Le pays avait besoin de se relever. Plus on s’éloigne de cette période, plus on cherche à les protéger. On leur a retiré toute forme de décision en considérant que les adultes sont de meilleurs être pensants pour eux. Le rapport à l’image est très lié à cela.
Léo Souillés-Débats : La programmation est un acte éminemment actif. Aujourd’hui, on est obligé d’être son propre programmateur : quel film choisir sur Netflix ? Quel DVD acheter ? A-t-on vraiment envie de choisir ? Ne préfère-t-on pas regarder un film quand il passe à la télé ? L’un des enjeux actuels de l’éducation à l’image se joue au niveau de la programmation et de la posture que cela implique.
Joël Danet insiste sur l’importance de montrer des films classiques aux jeunes générations. C’est une question qui invite à interroger le rôle de la culture et de l’éducation. S’agit-il de partager une culture ou de s’inscrire dans une interactivité permanente où l’on chercherait à décrypter le jeune public ? Proposer un film est un geste responsable, c’est une rencontre. La jeune génération est étonnamment disponible. Il s’agit là de questionner la transmission, de poser la question des repères classiques. Citizen Kane : il faut l’avoir vu, mais à partir de quels critères ? Une réponse valable serait de dire que c’est « parce que l’on pense que cela vaut le coup ».

Questions du public
Que faire quand des enfants nous disent regarder des films qui ne sont pas du tout « adaptés » ? Dans ce cas, sont-ils démunis face à leurs propres émotions ?
Joël Danet : L’enfant ne peut pas ne pas regarder, mais il sait maintenant que ça existe. Il est affranchi. C’est précisément cela qu’il faut accompagner.
Léo Souillés-Débats : La réponse des instances est de dire qu’il vaut mieux regarder cela avec des professionnels. Mais les enfants regardent des films chez eux et l’institution ne peut pas tout.
Quant à la question des émotions, le fait qu’un enseignant s’accorde le droit de les exprimer signifie qu’il donne quelque chose de lui-même. Cela peut être ressenti comme une violence ou comme un sentiment de partage. Ce qui m’a permis de me constituer une culture est précisément que mon père ait exprimé ses émotions pendant un film.
Brigitte Sztulcman : Quand on va voir Ponette, les enfants me demandent : « Mais tu as pleuré toi, maîtresse ? ». Je réponds oui, et on parle beaucoup. On n’est plus un professeur et des élèves, on devient alors un groupe de spectateurs. Nous devenons des individus égaux qui se font face, dans le temps présent. Le film n’est pas vu « pour plus tard », quand on prendra conscience qu’il était intéressant, mais pour maintenant.
Les adolescents à l’épreuve de l’imaginaire : inventer des mondes pour parler de soi
En partenariat avec Cinéma Public (association de salles de cinéma municipales et associatives du Val-de-Marne)
Matinée animée par Anne-Sophie Lepicard, responsable des actions éducatives au sein de l’association Cinéma Public et coordinatrice Collège au cinéma en Val-de-Marne.
TROIS ATELIERS D’ÉDUCATION À L’IMAGE
Présentation avec avec Irvin Anneix, auteur multimédia, Marc Blanchard, artiste protéiforme (designer graphique, plasticien et musicien), Léandre Bernard-Brunel, réalisateur, Céline Fouqueray, enseignante d’arts plastiques et Naïma Touil, enseignante de français.
A quelques mois des élections présidentielles de 2017 et dans le cadre d’ateliers d’éducation à l’image, trois artistes d’horizons différents ont proposé à des élèves de créer des pays imaginaires : leur histoire, leurs lois, leurs habitants… De quoi l’imagination des adolescents est-elle nourrie ? Quelle démarche et quels outils pour les aider à la mobiliser ? Quel rôle peuvent jouer les pratiques artistiques ?

Solaria et Proxima : deux projets jumeaux d’Irvin Anneix en partenariat avec la Gaîté Lyrique
Solaria est le résultat d’un parcours La Culture et l’Art au Collège au collège Lavoisier de Pantin, initié par le Département de la Seine-Saint-Denis et coordonné par Cinémas 93.
Proxima a été réalisé avec les élèves du lycée Saint Exupéry de Créteil dans le cadre d’un projet financé par la DAAC de Créteil.
En 2017, à la suite d’une guerre, un pays se fracture en deux. Chaque nouveau territoire indépendant, représenté par une classe, doit alors écrire son histoire.

© Solaria et Proxima – Irvin Anneix
Divisés en ministères, les élèves ont inventé les codes politiques, économiques, géographiques et culturels de ces nouveaux pays. De la création d’un drapeau et d’une monnaie, jusqu’à l’invention d’un costume et d’une langue traditionnelle, les élèves ont réfléchi à toutes les facettes de ce qui compose un pays, leur permettant d’explorer de nombreux champs de la création.
Deux sites Internet ont été créés, conçus comme des outils de restitution de la production des élèves. Ils se présentent sous une forme qui rappelle celle des sites d’offices du tourisme de certaines régions.
En savoir + : Voir le site de Solaria // Voir le site de Proxima
Chaque classe a travaillé indépendamment l’une de l’autre. Irvin Anneix a fait le lien entre les deux établissements en faisant découvrir régulièrement aux élèves leurs productions respectives. Une rencontre a été organisée à l’occasion de la restitution du projet à la Gaîté Lyrique, mais l’artiste regrette que la connexion entre les deux classes n’ait pas vraiment eu lieu. Sans doute aurait-il fallu prévoir que les élèves se croisent aussi pendant l’année.
Les deux classes étaient divisées en ministères (mode, gastronomie, sport, langue, histoire, géographie, communication…) et les ministres et équipes choisis à partir des propres centres d’intérêt des élèves.
En termes d’organisation et de prises de décision, le tirage au sort a été privilégié (pour choisir un drapeau parmi les différentes propositions des élèves par exemple, mais aussi un nom ou tout autre emblème…). Ce mode de décision, imposé par Irvin Anneix, à la fois démocratique et sans appel, a eu pour effet d’induire des conflits et des réactions vives chez les élèves, un type de réaction qui a été repris pour mettre en scène la création de Solaria et Proxima lors des « sommets mondiaux pour la création » des deux états mis en ligne sur les deux site Internet. Ce mode de prise de décision leur a permis de questionner sa légitimité et d’envisager comment les prises de décisions peuvent s’effectuer au sein d’une société.
Chacune des deux classes avait ses propres références pour créer son état :
- Le Japon et le shintoïsme pour Proxima, état conçu sous la forme d’un archipel de sept îles où les habitants, un peuple pacifiste, ne pratiquent aucune religion monothéiste mais croient en des divinités animales. L’Islande a également été une source d’inspiration, avec ses paysages où ont été tournés de nombreuses scènes de la série Game of Thrones.
- Le Moyen-Orient et le Qatar pour Solaris, avec une religion monothéiste (pensée comme le point de rupture avec Proxima). La langue nationale, sorte de conglomérat créé à partir du turc, du kabyle et du créole, a fait l’objet d’un travail très poussé avec le professeur d’espagnol, allant jusqu’à l’invention d’une véritable grammaire.
D’autres événements ont été organisés pour faire vivre ces deux états au sein de leurs établissements respectifs : des événements sportifs, des pratiques rituelles en costumes, etc. Le réalisme a été poussé jusqu’à créer une monnaie (fabriquée avec une machine à imprimer des tickets de caisse).
Utopies/ Îlanimées : un projet de Marc Blanchard
Coordonné par Cinémas 93 en partenariat avec L’Armada Productions
Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un Projet d’éducation aux regards du Département de la Seine -Saint-Denis. Il s’est déroulé avec une classe de 4ème du collège Pablo Neruda d’Aulnay-sous-Bois qui a expérimenté le vidéo mapping afin de produire une installation audiovisuelle.

© Utopies/ Îlanimées – Marc Blanchard
L’objectif de ce projet était de créer un archipel utopique en utilisant le vidéo-mapping (projections vidéo sur des objets en volume) et une bande-son créée par les élèves. L’archipel était composé de huit îles, conçues par des groupes de deux à cinq élèves. Chaque groupe avait pour consigne de donner un nom à son « mini monde », d’imaginer ses habitants et de décrire le fonctionnement de la société. Un travail particulier a été effectué sur la cartographie et chaque groupe a été invité à concevoir l’équivalent d’un guide touristique ou d’une page du type Wikipédia pour présenter son île. Finalement les élèves ont été mis en situation de devoir trouver des compromis : chacun avait ses idées, ses envies, fallait-il les départager ou bien les fusionner ?
Chaque île créée (« Le sang », « L’île de la night », « L’île du jugement » … toutes avaient des noms surprenants) s’enracine dans les origines et les cultures diverses des collégiens, avec des conflits potentiels entre les peuples. Marc Blanchard et Emilie Diallo ont également constaté que l’univers urbain, dans lequel évoluent quotidiennement les élèves, était très présent dans leurs créations. Les préoccupations politiques, identitaires ont cohabité finalement de façon très brute avec des lieux qu’ils fréquentent régulièrement : KFC, un restaurant de tacos…
Le projet a fait l’objet d’une exposition / restitution ouverte à tous au Hasard ludique, dans le 18e arrondissement de Paris, du 15 au 18 juin 2017, sous le titre Îlanimées.
Voir la vidéo de projet Îlanimée
Tous ces pays qu’Ubu n’aura pas vus : un court métrage tourné par Léandre Bernard-Brunel
Coordonné par La Fabrique du Regard / LE BAL, l’ADAGP et la Source
Ce projet a été réalisé avec les élèves du collège Jean Lurçat de Villejuif dans le cadre du dispositif Culture(s) de demain. Le réalisateur a travaillé avec des 6èmes sur le portrait d’un pays peuplé de leurs mots et où leurs visages seraient les territoires mouvants de cette contrée étrange.
Le projet de court métrage, coordonné par le BAL, s’est inséré dans un parcours culturel plus vaste au cours duquel des conférenciers se sont rendus dans l’établissement pour présenter des œuvres d’artistes aux élèves avant la venue du cinéaste. Ceux-ci avaient donc déjà bénéficié d’une première sensibilisation à l’expression artistique. Léandre Bernard-Brunel les a ensuite impliqués dans la réalisation d’un film autour de la notion de « pays rêvé ».
Après une première séance consacrée à la présentation du projet, la seconde séance a permis de recueillir la parole des élèves. Les séances suivantes ont été consacrées au tournage, qui a eu lieu le plus souvent dans le noir avec une trentaine d’élèves qui tournaient aux différents postes techniques.
A l’occasion d’un de leurs rendez-vous, Léandre Bernard-Brunel a apporté des épices pour créer des paysages colorés sur la paume des mains. Cet exercice a donné lieu à un lâcher-prise total de la part des adolescents. Il a également fallu créer des drapeaux à partir de bestiaires du Moyen-âge et de la Renaissance qui ont été retravaillés collectivement pour donner lieu à des chimères. Le travail visuel a aussi porté sur le maquillage, conçu d’après des reproductions d’œuvres d’art moderne. Enfin, les scènes de « check » ont été le fruit d’une étude des formes de salutations à travers le monde et les noms de pays ont été déterminés à partir d’un travail sur le langage et l’invention de mots. La bande-son, un rythme musical obtenu par des claquements de doigts, a été composée avec le professeur de musique.
Le montage n’a pas pu être effectué par les élèves : Léandre Bernard-Brunel s’est inspiré des propos de certains d’entre eux qui imaginaient pouvoir « changer de corps en un claquement de doigts » pour donner sa rythmique au film.

Utopie et politique
Anne-Sophie Lepicard inaugure la rencontre en rappelant que chacun des artistes présents a encadré un projet en lien avec les notions d’imaginaire et d’utopie. Comment ont-ils envisagé leur travail avec les élèves et comment a-t-il été reçu ? Comment ont-ils présenté la problématique de l’imaginaire, centrale dans la production artistique de chacun d’eux ?
Léandre Bernard-Brunel explique que la contrainte de départ de l’atelier, présenter un pays imaginaire en une phrase, a fonctionné comme un écrin, un espace de liberté pour ces enfants. Ce rapport à l’imaginaire s’est construit collectivement, dans une énergie très concentrée, fruit du nombre, somme toute limité, d’heures allouées au projet. De son côté, Marc Blanchard précise qu’il a travaillé la notion d’utopie avec le professeur de français. Celui-ci a abordé le thème sous l’angle littéraire. L’atelier, d’une durée de trente heures au total, a consisté à créer un monde sous la forme d’un archipel. Les élèves avaient plus ou moins de difficultés à trouver des idées : il fallait en effet qu’ils parviennent à se donner le droit de « faire ce que qu’ils voulaient ». Pour cela, Marc Blanchard a considéré chacun d’eux en tant qu’artiste, en essayant de tous les responsabiliser et de leur faire prendre conscience qu’il s’agissait de « leur » projet. Pour Irvin Anneix, le réel n’entre pas en opposition avec l’imaginaire. Il a conçu son projet comme un prétexte à la création de photos, de vidéos, et surtout il a très tôt considéré qu’il représentait pour les élèves une occasion de s’amuser autour de leur production.
Anne-Sophie Lepicard interroge les participants sur la dimension politique présente dans les trois projets, tous réalisés en 2016-2017, l’année des élections présidentielles.
Dans le cas de l’atelier mené par Marc Blanchard, l’aspect politique ne rentrait pas véritablement en ligne de compte, il n’en était pas le sujet central même s’il est évident que parler d’utopie implique nécessairement de questionner l’organisation de la société. Léandre Bernard-Brunel fait le même constat : il n’a pas abordé frontalement la question de la politique. Elle est de toute façon sous-jacente quand il s’agit de réfléchir à des problématiques de société ou qui font polémique, sachant par ailleurs que les élections ne lui semblent pas représenter le moment le plus intéressant du fonctionnement démocratique. Le champ de la politique a été envisagé plus frontalement par les élèves de Naïma Touil qui ont participé à Solaria avec Irvin Anneix : certains d’entre eux ont créé affiches de candidats détournées pour une élection imaginaire. Pour autant, les élections présidentielles françaises semblaient loin des préoccupations des élèves qui ont davantage évoqué Donald Trump.
Parler de soi
L’expression de soi constitue le second volet de ces trois projets. Pour autant, cette dimension est traitée différemment dans chacun d’eux. Anne-Sophie Lepicard interroge les intervenants sur les procédés qu’ils ont employés pour faire surgir les imaginaires des adolescents dans les projets : se sont-ils exprimés spontanément ou bien a-t-il fallu les encourager ?
De façon générale, cela s’est fait assez naturellement ; de l’avis de Marc Blanchard il a surtout fallu encourager les élèves à croiser, mélanger leurs influences. Comment faire cohabiter des univers hétéroclites était une question récurrente. C’est d’ailleurs ce processus même de création qui l’intéressait, davantage que le résultat fini. Il est d’ailleurs frappant de constater que, dans les îles, ce sont les éléments de séparation qui dominent souvent alors qu’on aurait pu imaginer l’inverse à la faveur de leur réflexion sur l’utopie.
Irvin Anneix a beaucoup poussé les collégiens et lycéens à s’exprimer dans des domaines dans lesquels ils se sentaient déjà à l’aise, ce qui ne l’a pas empêché de leur faire découvrir d’autres références artistiques. Il a rencontré davantage de diversité dans les passions et centres d’intérêt chez les lycéens que chez les collégiens où les univers sont moins variés. Céline Fouqueray ajoute que les élèves ont l’habitude de cloisonner entre ce qui relève de leur vie scolaire et ce qui appartient à leur vie privée. Or, à l’occasion du projet, ils se sont autorisés à aborder des sujets très personnels auxquels les enseignants ont accès extrêmement rarement. Naïma Touil abonde en ajoutant que le système éducatif ne laisse pas les élèves complètement libres dans l’expression de leur identité. En ce sens, ces propositions artistiques et culturelles s’avèrent très libératrices. Sachant par ailleurs que, parmi les vingt-cinq élèves de sa classe qui ont participé au projet d’Irvin Anneix, seuls trois ou quatre avaient une origine géographique commune. Cette diversité de langues maternelles est une véritable richesse qui est peu exploitée à l’école.
Plus généralement, ces projets ont été l’occasion pour les adolescents de se libérer de leur posture d’élève. Ils sont devenus plus réceptifs en cours, plus détendus. Le protocole de tournage dans le noir du film de Léandre Bernard-Brunel a sans aucun doute permis aux participants de se considérer mutuellement avec davantage de bienveillance. Maquiller son camarade et se demander comment éclairer son visage va dans le sens d’une attention plus empathique à l’autre. Le travail artistique du cinéaste s’inscrit précisément dans cette démarche. Le fonctionnement avec un groupe classe a provoqué une « dynamique étrange, entre intimité et effervescence ». L’ambiance était électrique, « une boule d’énergie circulait » et entrait en écho avec le désir de Léandre Bernard-Brunel que ce pays rêvé soit extrêmement multiple et toujours en mouvement.
Marc Blanchard évoque quant à lui le temps de restitution conçu sous la forme d’une exposition à l’occasion de laquelle les élèves ont présenté avec une grande fierté leur travail aux visiteurs.
GAGARINE DE FANNY LIATARD ET JÉRÉMY TROUILH
Projection avec avec Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, scénaristes et réalisateurs.
Youri a 20 ans, il vit avec sa mère à Ivry, dans la cité qui l’a vu grandir. Mais la démolition approche : le décor de ses rêves d’enfant va disparaître. Comment prendre son envol quand on n’a plus de vaisseau spatial ?

Le projet de Gagarine a vu le jour à l’occasion d’un concours de scénario lancé par l’Union sociale pour l’habitat et la Maison du film court auquel Fanny Liatard et Jérémy Trouilh ont répondu. Ni l’un ni l’autre n’avait réalisé de film auparavant, mais chacun avait étudié l’urbanisme ou travaillé sur des projets artistiques en lien avec ces questions. D’un commun accord, ils ont cherché à décaler le regard que l’on porte communément sur les cités. Le recours à un univers inspiré de la science-fiction les a aidés à aller dans ce sens, tout en leur donnant un cadre pour raconter l’attachement du personnage à un lieu.
Des liens ont été noués avec les habitants de la cité Gagarine d’Ivry-sur-Seine où le tournage a pris place, notamment avec des femmes d’une association et des jeunes du quartier. Les deux apprentis cinéastes rêvaient de trouver l’interprète de Youri, le personnage principal, parmi eux, mais cela n’a finalement pas été le cas. Le tournage a duré quatre jours au cours desquels les habitants se sont rapprochés les uns des autres. Peu après le tournage, une maison de quartier s’est construite où Fanny Liatard et Jérémy Trouilh animent des ateliers vidéo.
Une projection de Gagarine a eu lieu au Luxy, le cinéma municipal d’Ivry-sur-Seine : les retours ont été très positifs et le film a permis d’ouvrir la parole. L’objectif du projet était de créer un lieu de mémoire filmique pour un lieu de vie et d’habitat qui va bientôt disparaître, sachant que certaines familles y résident depuis trois générations. Quelques habitants avaient même vécu les événements que les deux cinéastes ont découverts dans les images d’archives mises en lignes par le PCF et utilisées dans leur court métrage (la visite de Youri Gagarine à Ivry-sur-Seine en 1963). « Il n’y a rien de mieux [que ces images] pour montrer l’enthousiasme que cela représentait de rentrer dans une barre d’immeubles dans les années soixante ». De fait, la cité Gagarine conserve la mémoire de la visite du véritable Youri Gagarine : « on raconte qu’il a planté un arbre, mais personne ne sait lequel. On dit qu’une plaque a été posée, mais personne ne sait où elle se trouve ». Quoi qu’il en soit, la figure de Gagarine fait partie de l’identité du lieu. Ces images ont par ailleurs permis d’établir un lien avec les nouvelles utopies du personnage fictif de Youri. Avec ce film, il s’agissait de sublimer un lieu sans pour autant l’enjoliver.
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh développent en ce moment un projet de long métrage. La cité Gagarine en accueillera le tournage qui devrait avoir lieu d’ici 2019, date prévue pour la démolition de la cité. Le film reprendra l’histoire du personnage de Youri, ce jeune homme qui rêve d’espace, mais ne sait pas se projeter ailleurs que dans sa cité. La destruction de la barre d’immeubles sera filmée et fera partie intégrante du film. Il s’agira alors de se questionner : comment peut-on quitter un lieu ? Comment cette expérience s’articule-t-elle à la sortie de l’adolescence de Youri ? Un parallélisme sera ainsi établi entre l’immeuble et le personnage principal : « tous deux vivent une phase de transformation, tous deux brillent l’un par rapport à l’autre ».
Les adolescents dans le cinéma contemporain
En partenariat avec l’ACID (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion)
LA REPRÉSENTATION DES ADOLESCENTS DANS LE CINÉMA FRANÇAIS CONTEMPORAIN : LA PROMESSE DU NATUREL ?
Conférence par Murielle Joudet, critique de cinéma.
Comment filmer l’adolescence et pourquoi la filmer ? Il semble que le cinéma français ait toujours été obsédé par la quête de « naturel ». On peut en faire une généalogie qui irait des frères Lumière à Abdellatif Kechiche, en passant par Jean Renoir et Maurice Pialat chez qui la filiation naturaliste se cristallise autour de l’adolescence.
À travers un corpus de films français réalisés entre 2003 et 2016, et choisis selon ses propres goûts, Murielle Joudet s’est demandé si l’adolescence n’est pas l’écrin privilégié de ce naturel tant désiré par la caméra. Parce que l’adolescent est un corps en pleine mutation, qui se confronte, se rebelle, s’impatiente, se cherche : bref, l’adolescence, n’est-ce pas ce qui éclot à même l’écran – ce qui pourrait être une définition du naturel ?

La fiction du naturel
Le naturel peut être envisagé comme ce qui se donne comme tel et qui n’est affecté par aucune technique. Chez Jean Renoir, le naturel est obtenu par le jeu des acteurs, la technique doit absolument se faire oublier.
Le naturel, c’est aussi ce qui est vierge, innocent. Évidemment, envisager le naturel ainsi est une amorce de fiction, et les cinéastes s’en servent. Le choix des acteurs, dans cette perspective, va être crucial. Pour incarner un rôle d’adolescent au cinéma, on privilégiera des interprètes spontanés, souvent non professionnels, dans l’espoir que quelque chose d’inédit advienne à l’écran.
Le corps adolescent est par nature en transition, en perpétuel mouvement. Or, là est la définition même du naturel : un mouvement pur qui ne vaut que par lui-même. Trouver des acteurs non professionnels implique souvent de faire des castings sauvages et d’offrir son premier rôle à une jeune personne. Cela a été le cas pour Sandrine Bonnaire, découverte par Maurice Pialat, mais également pour Sara Forestier révélée par Abdellatif Kechiche. Ces cinéastes ont eu pour elles une dimension révélatrice, ils leur ont offert leur entrée dans le monde du cinéma
Cependant, deux problèmes se posent lorsqu’on filme un adolescent inexpérimenté dans la perspective de le révéler. Tout d’abord, une épiphanie ne peut avoir lieu qu’une seule fois. Dans certains cas, l’acteur risque de rester prisonnier de ce premier rôle. Adèle Exarchopoulos, révélée par Abdellatif Kechiche dans La Vie d’Adèle, ne parvient pas à se détacher de ce personnage si fort qui lui colle à la peau. Les personnages qu’elle a interprétés ensuite demeurent « en dessous » de celui-ci.
Ensuite, certains cinéastes ont une démarche quelque peu vampirique. D’une certaine manière, on pourrait dire de Kechiche qu’il nourrit ses films de chair fraîche. L’Esquive, La Graine et le mulet, comme La Vie d’Adèle, sont des films très sensuels. Il y a quelque chose de l’ordre de la dévoration de l’actrice par le réalisateur pour, une idylle platonique
Le naturel versus le discours
Dans ce type de films, deux énergies contradictoires sont à l’œuvre : la vie, avec sa dimension quasi documentaire, et un discours, une idéologie qui semble être l’inverse du naturel mais qui en nourrit la représentation. Alors que le naturel, en tant que tel, ne vise aucun but, au cinéma, il n’en va pas de même : les scènes convergent vers un discours, un film dit quelque chose de la société, il prend parti.

© L’Esquive d’Abdellatif Kechiche
Dans la scène de la répétition en classe des Caprices de Marianne (L’Esquive d’Abdellatif Kechiche), on peut dire que la figure de l’adolescent tire à elle d’autres thématiques, en l’occurrence ici l’école, la banlieue ou encore le langage.
Filmer l’école, où les existences se déterminent, c’est filmer la société française, c’est lui faire passer une véritable visite médicale ! Dans le film de Kechiche, les élèves sont attentifs, ils travaillent en dehors des cours. Le film déjoue tous les clichés sur la banlieue. On comprend bien dans quel camp se situe le cinéaste. Il faut voir comment un cinéaste filme l’école pour comprendre sa vision du pays.
Le traitement de la langue dans le film est également très instructif : on assiste ici à une collision entre le langage des banlieues et le texte de Marivaux qui appartient à la littérature du dix-huitième siècle. Marivaux va-t-il entrer en banlieue ? La question peut se poser dans les deux sens si l’on considère l’énergie avec laquelle les lycéens travaillent : les jeunes vont-ils réussir à sortir de leur langue ?
La Vie d’Adèle va muscler le propos de L’Esquive. Dans ce film, on peut être gêné par l’articulation naturel / discours qui est à l’œuvre. D’abord, on constate une dimension documentaire du film à travers le choix du titre, de la caméra portée ou encore des longues séquences. S’agit-il de suivre les deux personnages sans émettre de discours ? Non, évidemment, personne n’est dupe. Le film traite d’un sujet violent, le mépris de classe, et de la façon dont ce mépris peut prendre le dessus sur le sentiment amoureux.

© La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche
La scène de flirt entre Emma et Adèle dans un parc est animée d’un mouvement qui se déploie jusqu’à la fin. L’actrice, la situation, la mise en scène, les répliques sont toutes porteuses d’une grande sensualité. On ressent très fortement cette dimension vampirique évoquée plus tôt : tout le monde ici veut s’entre-dévorer. Adèle, Emma (Léa Seydoux) mais aussi Kechiche et les spectateurs. Nous sommes tous impliqués dans cette scène et c’est précisément cela qui peut être gênant. Le choix de l’actrice a été déterminant pour La Vie d’Adèle : Adèle Exarchopoulos semble capable de tout manger. L’acte de manger est éminemment sensuel et, dans le film, manger du jambon exprime un pas vers l’acte sexuel.
Filmer un adolescent renverrait in fine à une vérité ontologique liée à cette figure. Adèle Exarchopoulos porte son vrai prénom dans le film, elle exprime sa vérité. Quant à Emma, incarnée par Léa Seydoux, c’est un personnage. Il faut préciser à ce stade que c’est une fiction que de croire qu’Abdellatif Kechiche nous montre la vérité de son actrice. Pourtant, il a l’air d’y croire lui-même. Il est, selon Murielle Joudet, l’un des représentants les plus talentueux de cette veine réaliste (de cette « illusion de réel ») qui traverse également le cinéma de Céline Sciamma, mais aussi celui des frères Dardenne (en particulier dans Rosetta). Il est aussi un point de repère pour envisager d’autres manières de filmer l’adolescent.
Un possible teen-movie à la française ?
Aux Etats-Unis, il existe un genre dédié à la figure des adolescents : le teen-movie. En France, quelques films ont tenté de transposer cet univers : La Boum, Lol… Cette cinématographie se veut générationnelle et elle ne sied que partiellement au cinéma français.
Le « teenager » est une créature typiquement américaine, née dans les années cinquante avec La Fureur de vivre de Nicholas Ray. À cette époque, Hollywood cherchait à rajeunir son public. Cette catégorie socioculturelle du teenager a ensuite contaminé le reste du monde : on peut considérer que Les Cousins de Claude Chabrol et Rendez-vous de Juillet de Jacques Becker sont les premiers films d’adolescents français.
Les teen-movies se caractérisent par l’attention qui y est portée aux « premières fois » : premier baiser, premier rapport sexuel, première cuite… Il faut en passer par certaines étapes pour devenir adulte. En France, l’idée de la première fois est sans doute moins importante.

© Les Beaux gosses de Riad Sattouf
Avec Les Beaux gosses, Riad Sattouf s’est inspiré de ce genre de films et l’a importé dans son univers d’auteur de bandes-dessinées. Le film nous présente des corps qui ont quelque chose d’incontrôlable. Il pousse le trait jusqu’à en faire un pur motif comique. Le fait que tous les personnages gardent toujours les mêmes vêtements inscrit le film dans l’univers du cartoon. On est au-delà du réel. Le sens du cadre, des dialogues, du montage semble provenir de la pratique de la BD. Les personnages de Riad Sattouf sont des personnages types : les puceaux, les filles, les beaux gosses… Il faut reconnaître au film son casting de génie ! Riad Sattouf parvient avec ce premier long métrage à faire quelque chose de très français tout en s’inspirant du teen-movie américain.
A contrario, Camille redouble, de Noémie Lvovsky, échoue à transposer dans le cinéma français cette obsession pour le cinéma américain. Elle part d’une très belle idée mais qui vient d’un autre film, Peggy Sue s’est mariée de Francis Ford Coppola, dont elle fait un remake non assumé. Les adolescents sont ici majoritairement joués par des adultes, dans un divorce total avec tout effet de réel. Elle reprend l’idée maîtresse selon laquelle l’adolescent est une figure chimérique, mais la cinéaste peine à adapter en France le film de Coppola : elle ne parvient pas à le transposer/transformer suffisamment.

© Camille redouble de Noémie Lvovsky
L’adolescent chez Abdellatif Kechiche est un corps, une langue et une gestuelle. Chez Riad Sattouf, l’adolescence se réduit à l’obsession pour le sexe et à une ingratitude généralisée. Chez Noémie Lvovsky, ce sont des costumes, des codes, des rituels, une panoplie. Elle développe aussi la représentation très américaine de l’adolescence comme un âge d’or, une parenthèse enchantée, avec sa sur-socialisation, les copains et les soirées. Ce voyage en adolescence éclaire tout d’une lumière mélancolique, mais il est nécessaire de prendre un peu de recul : cette dimension paradisiaque et chimérique renvoie en effet à la fiction.
L’adolescence, une chimère ?
C’est l’objet du dernier film d’Arnaud Desplechin, Trois souvenirs de ma jeunesse. Il s’agit là de son premier film sur des adolescents, censé représenter la jeunesse de Paul Dédalus, personnage créé dans Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle). En fait, il ne s’agit en rien d’un prequel, mais bien plutôt d’une sorte d’affabulation : il n’y a aucun lien logique entre les deux films. Trois souvenirs de ma jeunesse est composé de trois parties : l’enfance de Paul, un voyage scolaire et une histoire d’amour. Le souvenir fonctionne comme un voyage dans le passé où l’on pourrait prendre toutes les libertés souhaitées avec le réel. Le film propose ainsi un récit d’aventure et un récit vengeur qui tordraient le cou à la réalité. On a affaire à l’expression d’une haine du réel, de la réalité. Ce qui compte, c’est moins ce qu’on a réellement vécu que le mensonge que l’on s’en raconte.

© Trois souvenirs de ma jeunesse d’Arnaud Desplechin
La scène de la rencontre entre Paul et Esther entre en résonnance avec celle de La Vie d’Adèle : filmer la rencontre est un exercice de style à part entière. Ici Arnaud Desplechin reprend la grammaire américaine : il filme la voiture comme aurait pu le faire Scorsese. Tout semble irréel : le jeu des acteurs, leurs vêtements… La vision rétrospective du personnage rend tout chatoyant. L’époque à laquelle l’action se déroule est impossible à dater. On est dans une promesse d’artifice pur. Si Abdellatif Kechiche filme contre la classe bourgeoise, Arnaud Desplechin, lui, filme contre le réel. Tout son cinéma procède de cette transformation, il exprime un amour des mensonges et des histoires que l’on se raconte. L’adolescent a quelque chose de chimérique, d’intimement faux.
En dernière instance, on peut dire que pour chacun des cinéastes cités, l’adolescence est un fantasme. Chez Abdellatif Kechiche on est encore en train de sublimer et de délirer, même s’il le cache davantage qu’Arnaud Desplechin qui, pour sa part, assume la part de mensonge romanesque que recèle l’adolescence. Autrement dit, l’adolescent n’existe pas.
QUATRE CINÉASTES VIENNENT PARTAGER LEUR EXPÉRIENCE AVEC DES ADOLESCENTS : FOCUS SUR DES MÉTHODES DE TRAVAIL SINGULIÈRES
Table ronde avec Damien Manivel, réalisateur de Un Jeune Poète, Le Parc et Takara, la nuit où j’ai nagé, Lila Pinell et Chloé Mahieu, réalisatrices de Kiss & cry et Cyprien Vial, réalisateur de Bébé tigre. Animée par Laura Tuillier, cinéaste et critique de cinéma pour Les Cahiers du Cinéma.
Cyprien Vial a confié le rôle principal de son film à un adolescent qui n’avait jamais joué. Damien Manivel a fait tourner dans Le Parc deux jeunes adolescents sans expérience. Quant à Lila Pinell et Chloé Mahieu, elles ont tourné Kiss & cry dans la continuité de leur documentaire Boucle piqué où elles suivaient un groupe de jeunes patineuses et leur entraineur : c’est alors qu’elles avaient fait la rencontre de Sarah Bramms, devenue par la suite l’actrice de Kiss and cry.

Le Parc de Damien Manivel
Damien Manivel explique que les deux jeunes interprètes de son film ne se connaissaient pas du tout avant le tournage et venaient chacun d’un univers bien différent. Or ce film traite justement de la rencontre de deux adolescents et du désir qui naît entre eux. Initialement, Damien Manivel avait imaginé un scénario allant beaucoup plus loin dans l’expression de la sensualité, mais il a fallu s’adapter à la pudeur de ses jeunes acteurs. Afin de conserver la timidité et la préciosité de leurs gestes, il n’y a eu aucune répétition avant le tournage. Le réalisateur n’avait d’ailleurs pas fourni de scénario à ses acteurs et leur avait juste exposé l’idée du film.
Pour diriger ses acteurs, Damien Manivel s’adressait à eux pendant les prises : il leur proposait des idées et ils étaient alors libres de les accepter ou non. Le réalisateur leur permettait également d’aller puiser dans leurs propres vies. Afin de de réduire la pression qui pesait sur les deux adolescents, l’équipe technique était réduite. Damien Manivel pense n’avoir aucune méthode de direction d’acteur, il s’adapte simplement aux interprètes de son film.

© Le Parc de Damien Manivel
Kiss & Cry de Lila Pinell et Chloé Mahieu
Pour réaliser Kiss & cry, les deux réalisatrices ont travaillé avec un groupe de jeunes filles déjà constitué, comme dans le documentaire Boucle piqué qu’elles avaient tourné à Colmar, en 2014, où elles suivaient un groupe de patineuses. Pour Kiss & cry, le club de patinage où se déroule le film a été trouvé à la dernière minute et le tournage a eu lieu lors d’un stage d’été. Les patineuses avaient alors onze ans.
Après le tournage de Boucle piqué, les réalisatrices avaient gardé contact avec certaines patineuses et Xavier Dias, l’entraîneur, à qui elles ont proposé de jouer dans Kiss & Cry. Il a accepté d’endosser de l’impitoyable entraineur, composant alors avec ce qu’il est. Quant à Sarah Bramms, qui interprète le rôle principal dans Kiss & cry, elle n’apparaissait que très peu dans Boucle piquée, mais les deux cinéastes l’avaient repérée et l’ont donc recontactée pour leur long métrage. Chacune des filles devait s’approprier son rôle, y mettre son énergie singulière, et Sarah avait particulièrement le sens de l’improvisation, du rythme, de l’humour. Toutes ont beaucoup donné d’elles-mêmes, jusqu’à faire naître la confusion, dans le film, entre le vrai et la fiction. Cependant, Sarah a su faire la différence entre son histoire personnelle (le fait qu’elle ait quitté le club et arrêté le patinage et toute la rancœur qu’elle a pu éprouver contre Xavier Dias, son ancien entraîneur) et son rôle dans le film qu’elle a envisagé comme un travail.

© Kiss & cry de Lila Pinell et Chloé Mahieu
Un scénario avait été écrit, mais chaque scène comportait beaucoup d’improvisation. En effet, le film est tourné à la manière d’un documentaire et la mise en scène s’en ressent. En particulier, les réalisatrices ont privilégié les plans séquences et ont peu recouru aux champs-contrechamps qui auraient brisé toute l’énergie. Ces méthodes de tournage particulières ont été plutôt compliquées pour les techniciens qui ont eu davantage de mal que les comédiennes à s’adapter au dispositif, à l’absence de clap, au placement des acteurs… Entre Boucle piqué et Kiss & cry, la méthode a finalement peu évolué, si ce n’est au niveau de l’écriture qui s’est faite au jour le jour pour Boucle piqué, contrairement au long métrage de fiction qui a nécessité un temps d’écriture beaucoup plus important. Mais le tournage s’est caractérisé, dans les deux cas, par l’intervention fréquente des deux cinéastes tout au long des prises : « On parle aux filles pendant les prises, on investit un entraînement, on organise la fête et on fait monter l’ambiance…» précise Chloé Mahieu. Il s’agit alors de provoquer les situations sans pour autant nécessairement les laisser se dérouler d’elles-mêmes : les réalisatrices ont aussi tendance à beaucoup couper les scènes, et à les faire rejouer.
Bébé tigre de Cyprien Vial
Bébé tigre est un film conçu dans le prolongement d’ateliers que Cyprien Vial a menés au collège Jean Lolive à Pantin pendant trois ans. Attaché à une classe auprès de laquelle il intervenait, le cinéaste a souhaité poursuivre l’aventure en tournant un film de long métrage. C’est tout particulièrement sa rencontre avec un jeune collégien originaire du Pendjab, au statut de mineur isolé, qui a impulsé son envie de faire un film sur le sujet. Il était cependant impossible de faire jouer un garçon vivant lui-même une situation similaire. Un casting sauvage a donc été organisé au sein de la communauté, bien représentée en Seine-Saint-Denis, pour trouver un jeune interprète parlant le pendjabi et familier de cette culture. Le réalisateur a reconnu chez Harmandeep Palminder, qui joue le rôle de Many, la fierté qui habite ceux dont il s’est inspiré pour créer son personnage. Du point de vue du jeu, Harmandeep était beaucoup plus à l’aise avec les scènes écrites. Lorsqu’il s’agissait d’improviser, il lui a fallu beaucoup d’entraînement, mais le challenge a plu au jeune homme. Elisabeth Lando, qui joue sa petite amie dans le film, faisait, elle, partie de la classe dans laquelle Cyprien Vial était intervenu. Âgée de 16 ou 17 ans au moment du tournage, elle a dû retrouver l’énergie de ses 14 ans. Les autres élèves du film venaient aussi d’une véritable classe que le cinéaste connaissait.

© Bébé tigre de Cyprien Vial
La singularité du jeu des adolescents
Damien Manivel a travaillé à deux reprises avec le jeune Rémi Taffanel, à qui il a donné un premier rôle dans La Dame au chien (2010), puis un autre dans Un Jeune Poète (2014). Le cinéaste a alors déclenché la carrière du jeune homme. Lors de leur première collaboration, Rémi Taffanel avait quatorze ans. Pour ce qui est du jeu, à cet âge, on est souvent peu conscient de ce qui arrive dans et par son corps. Pourtant, Rémi a beaucoup étonné le réalisateur qui se souvient tout particulièrement d’un essai lors duquel il lui avait demandé de jouer l’attente. La tendance habituelle des apprentis acteurs est de se presser. Le jeune acteur a, au contraire, très bien intégré la durée et avait même élaboré une technique qui lui permettait de mesurer le temps nécessaire dans sa tête. A dix-huit ans, lors du tournage d’Un Jeune Poète, il était davantage conscient et, de ce fait, moins innocent de ce qu’est un tournage. « Quand on tourne avec lui, il faut envisager que le film doit adopter son monde, sa façon d’être, de penser. » explique le cinéaste, « les personnages doivent être créés à partir de lui ». Lorsqu’il parle de Rémi Taffanel, Damien Manivel reconnait que beaucoup de choses restent encore mystérieuses pour lui : à certains moments, le réalisateur pense que l’acteur improvise alors que ce n’est pas le cas ; à d’autres, il lui semble que beaucoup de choses lui échappent alors qu’il parvient à les reproduire à l’identique.

© Rémi Taffanel dans La Dame au chien de Damien Manivel
Damien Manivel est intéressé par les corps adolescents, autrement dit par les corps non « finis ». Le jeune Rémi Taffanel avait des bras très longs, comme une araignée, tandis que les deux acteurs du film Le parc ont un physique plus banal, qui correspond à l’approche du cinéaste pour ce film. Damien Manivel ajoute qu’il travaille également pour le théâtre avec des adolescents et qu’il trouve magnifique la façon dont certains gestes automatiques peuvent leur échapper.

© Rémi Taffanel dans Un Jeune Poète de Damien Manivel
Dans différentes scènes de Boucle piqué et Kiss & cry, les réalisatrices font en sorte que le groupe de patineuses ne forme qu’un seul corps. En tant que cinéastes, quelle place occupent t’elles alors ? Les jeunes filles sur-réagissent-elles parce qu’elles sont devant une caméra ?
Une scène de Kiss and cry présente la bande d’adolescentes, dans la chambre de l’une d’elles, lors d’une soirée entre amies. Leurs téléphones à la main, elles s’amusent à envoyer des photos d’elles – via Snapchat – à des garçons, se dénudant un peu plus à chaque fois. Dans cette scène, l’équipe de tournage était composée de trois personnes, avec un matériel très visible. Cependant, la façon dont les interprètes semblent oublier leur présence est tout à fait étonnante. On n’obtient pas davantage d’intimité que l’on soit deux ou dix sur le plateau, notent les réalisatrices.
Dans Boucle piqué, Lila Pinell et Chloé Mahieu avaient mis en scène une autre scène de groupe dans la chambre d’une des patineuses : plusieurs petites filles chahutaient ensemble, puis se liguaient peu à peu contre l’une d’elles, sans véritable raison. Cette scène était écrite, mais les filles avaient eu toute liberté d’improviser. La façon dont l’action s’est déroulée n’a pas vraiment surpris les cinéastes : elle est simplement allée un peu plus loin que ce qu’elles avaient imaginé En l’occurrence, l’excitation collective a évolué peu à peu vers l’agression de l’une des filles alors que la caméra tournait. Si cette petite fille était dans la « vraie » vie le bouc-émissaire du groupe, la présence de la caméra a sans doute exacerbé le comportement des autres envers elle. Se pose alors la question du moment où l’on intervient pour éviter que cela ne dégénère. Le curseur entre le jeu et le réel est parfois difficile à situer, on peut parler de « cinéma pour de vrai ».

© Boucle piqué de Lila Pinell et Chloé Mahieu
À la différence des deux films précédents, Bébé tigre a mobilisé une équipe de tournage conséquente, jusqu’à vingt-cinq personnes contre cinq pour Le Parc et Kiss & cry. Harmandeep Palminder s’est tout de suite senti très à l’aise, « il a compris que la caméra l’aimait ». Ses parents ne sont jamais venus sur le tournage et il a pris conscience qu’il était de sa responsabilité de travailler avec sérieux. Cyprien Vial n’a jamais eu l’impression de beaucoup le diriger, le cinéaste considère plutôt qu’il lui revenait de créer un cadre propice à son acteur et de comprendre ce que celui-ci était en train de vivre sur le tournage. L’adolescent a néanmoins été très intimidé à deux reprises : la première fois lors d’une scène de baiser, la seconde lorsqu’il a dû un vrai contact physique avec Elizabeth. Le réalisateur s’est alors rendu compte qu’il allait très vraisemblablement filmer le premier vrai baiser d’Harmandeep et par conséquent vampiriser quelque chose qui lui appartenait. Or, en tant que cinéaste, il n’a pas envie de voler ces moments-là. L’équipe a donc fait en sorte de ne tourner qu’une seule prise.
Dans le cas du film de Damien Manivel, Le Parc, les scènes ont été tournées dans l’ordre chronologique. Les deux interprètes ont compris qu’ils allaient jouer une scène de baiser, ils l’ont vue venir. Leur réaction a été composée d’un mélange d’inhibition et de volonté de réussir. Le cinéaste les a aidés en leur rappelant qu’il s’agissait d’un baiser de cinéma. La mise en scène des « premières fois » est passionnante à travailler avec des adolescents pour Damien Manivel. On peut bien sûr filmer des premières fois avec un homme de quarante-cinq mais, alors, on n’échappera pas à une certaine forme de nostalgie. Un Jeune Poète est d’ailleurs un film sur les premières fois. Rémi y a d’ailleurs vécu sa vraie première cuite !
L’adolescence est un thème que l’on privilégie peut-être dans ses premiers films, mais elle peut aussi faire l’objet de toute une œuvre. Cyprien Vial a, pour sa part, l’impression d’avoir mis en scène l’histoire d’adolescence la plus éloignée qui soit de sa propre vie. Il va lui falloir encore un peu de temps pour évoquer la sienne à l’écran. Lila Pinell précise, quant à elle, qu’elle a toujours filmé les adolescents. Elle aimerait tourner un documentaire de long métrage sur ce thème avec Chloé Mahieu, mais la nécessité d’obtenir un grand nombre d’autorisations rend ce projet complexe. Damien Manivel, lui, a toujours envie de tourner avec les adolescents dont il adore la grande créativité et l’énergie. Il a par ailleurs réalisé un film avec un petit garçon de six ans, et pour le coup, « il fait vraiment ce qu’il veut sur le plateau. C’est lui le metteur en scène ».
La salle de cinéma indépendante art et essai à l’heure de la métropole
En partenariat avec Écrans VO (association des cinémas indépendants du Val-d’Oise) et le SCARE (Syndicat des Cinémas d’Art, de Répertoire et d’Essai)
Matinée animée par Antoine Leclerc, délégué général du Festival Cinéma d’Alès – Itinérances et de l’association Carrefour des festivals.
QUELLES MARGES DE MANŒUVRE DANS LA PROGRAMMATION DES FILMS ? QUELLES STRATÉGIES ?
Rencontre animée par Antoine Leclerc, délégué général du Festival Cinéma d’Alès – Itinérances et de l’association Carrefour des festivals. Avec Christine Beauchemin-Flot, directrice-programmatrice du Sélect à Antony (92), Sylvain Clochard, directeur du Concorde à Nantes et du groupement national de programmation Micromégas, Xavier Lardoux, directeur du cinéma au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et Caroline Lonqueu-Lahbabi, directrice des cinémas Utopia de Saint-Ouen-L’Aumône et Pontoise (95)

Confrontés à la concurrence toujours plus vive des multiplexes sur les titres porteurs, comment les cinémas art et essai de la périphérie peuvent-ils affirmer une singularité éditoriale tout en maintenant une diversité cinématographique et une fréquentation suffisante ?
Antoine Leclerc ouvre cette table ronde en rappelant quelques chiffres et données pour resituer le cadre général de l’évolution de l’exploitation entre 2007 et 2016 :

Mais le nombre d’entrées et la recette moyenne par entrée n’augmentent pas de la même façon selon la catégorie d’établissements.
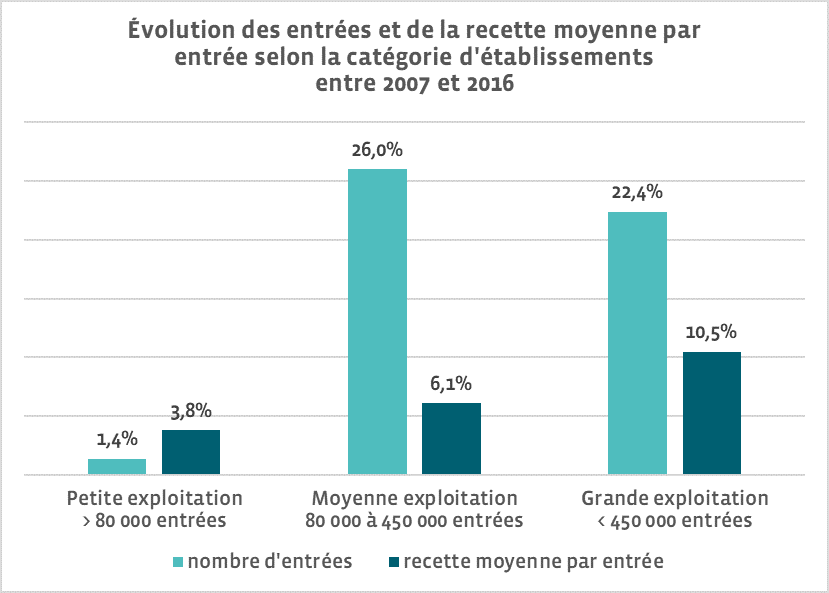
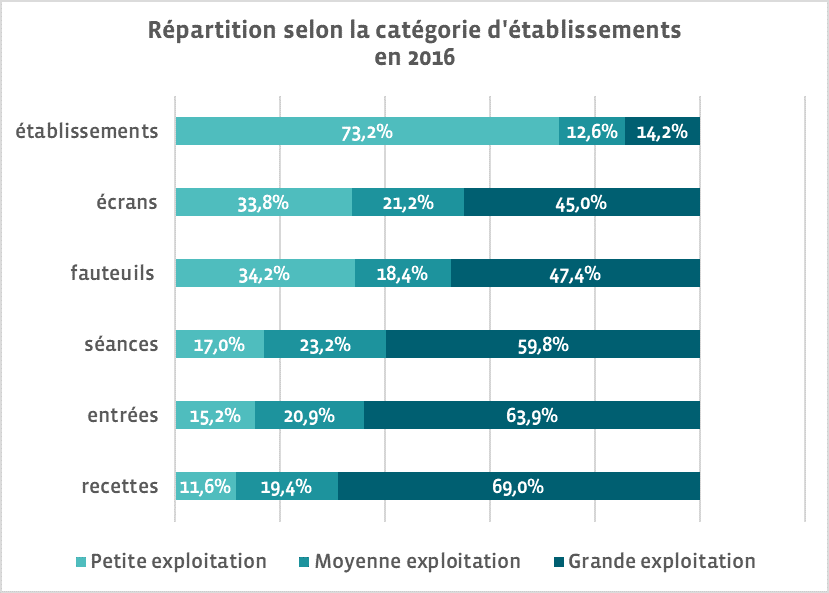

Avant de décrire le rôle de régulateur joué par le CNC, Xavier Lardoux précise quelques chiffres :
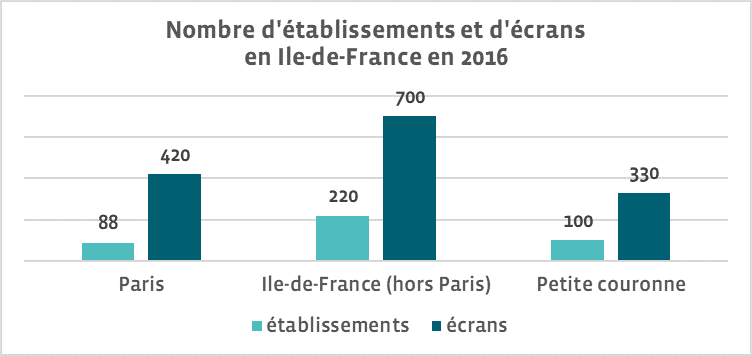
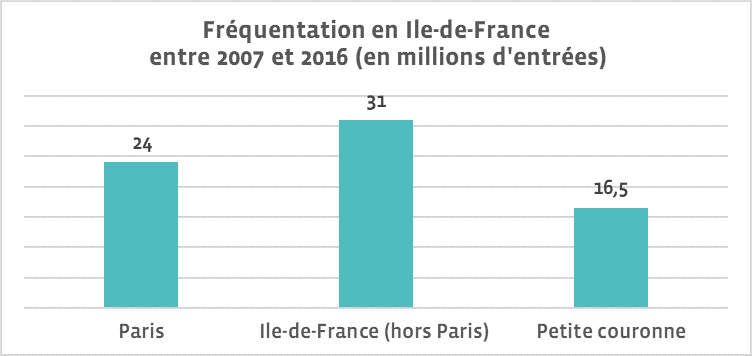
Selon Xavier Lardoux, ces chiffres plutôt satisfaisants s’inscrivent dans un mouvement national global :
- En 2016 : 213 millions d’entrées. Soit le deuxième meilleur score depuis 50 ans.
- En 2017 : la tendance est très bonne au niveau national : les 210 millions d’entrées devraient être atteintes.
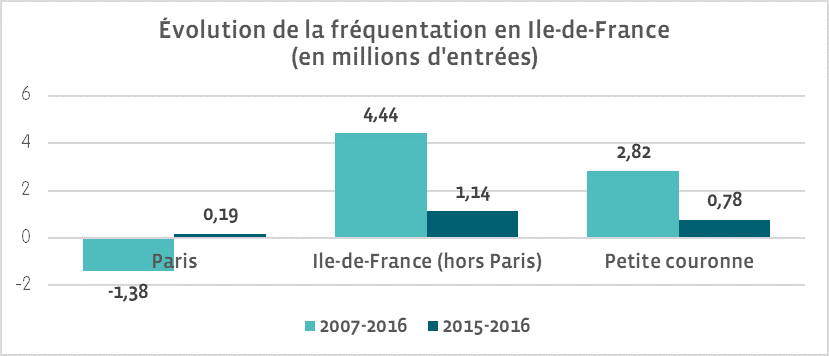
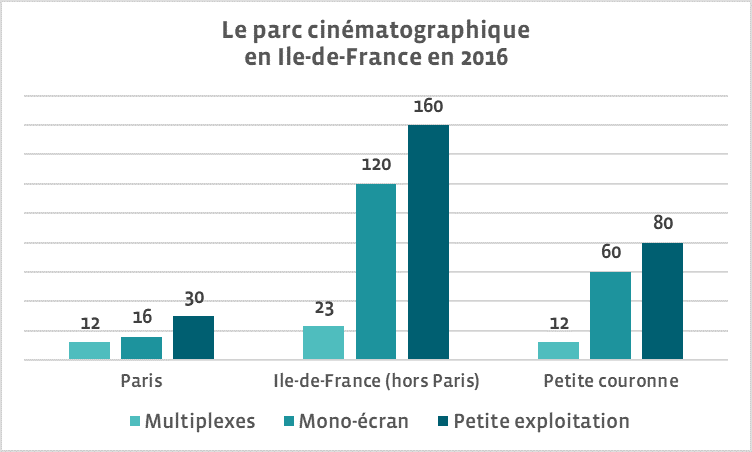
Le poids des mono-écrans est très important en Ile-de-France par rapport aux autres régions et on y observe la place prépondérante de la petite exploitation. Une partie importante de l’augmentation de la fréquentation est due aux multiplexes, mais les salles art et essai ont progressé de manière non négligeable en 2015-2016 notamment. Il est rappelé qu’en France, plus d’une salle sur deux est classée art et essai.
L’autorisation de création de salles avec plusieurs écrans et plus de 300 fauteuils
La France est le seul pays qui dispose d’un système de régulation en la matière. Il y a beaucoup plus de présentations en CDAC (Commission départementale d’aménagement cinématographique) et de recours en CNAC (Commission nationale d’aménagement cinématographique) pour des créations d’équipement en Ile-de-France que dans les autres régions. Sur les trois derniers exercices, 22 projets franciliens ont été examinés en CNAC et 11 ont été validés, soit 50% alors que le taux de validation atteint 75% pour le reste de la France.
Un séminaire avec l’ensemble des membres de la CNAC et leur nouveau président Pierre-Etienne Bisch aura lieu très prochainement. Un bilan annuel de l’aménagement cinématographique en France va dorénavant être publié pour davantage de transparence.
En savoir + : La commission nationale d’aménagement cinématographique
Les engagements de programmation
Créé dans les années 80, ce premier outil de régulation au monde permet d’imposer aux multiplexes des critères de multidiffusion d’un même film dans un même établissement, mais aussi de les obliger à programmer des films de la diversité et de tenir les films au moins 15 jours à l’affiche. Ces mesures permettent une liberté de choix des films par les spectateurs. En mai 2016, un accord interprofessionnel a renforcé les engagements de programmation pour les multiplexes (plus de 8 écrans).
En miroir, ont été créés des engagements de diffusion pour les distributeurs. Cet accord date du 13 mai 2016 et est effectif depuis juillet 2017. Il pose la question de l’accès aux films et a été conçu pour mieux servir les salles indépendantes dans les villes de moins de 50 000 habitants ou dans les zones rurales, sachant que, depuis 10 ans, la présence d’art et essai porteur dans ces zones était en baisse. Désormais les distributeurs doivent, pour les films recommandés art et essai dit « porteurs » (sortant sur plus de 175 points de diffusion en sortie nationale), assurer aux salles indépendantes un plan de sortie nationale. Si une salle demande un film art et essai porteur à un distributeur et qu’elle n’arrive pas à l’obtenir, le distributeur est contraint de lui donner une partie de son plan de sortie au niveau national. Le CNC vérifie si les distributeurs respectent les pourcentages prévus.
En savoir + : Les engagements de diffusion
Le rôle de la médiation
La médiatrice du cinéma (Laurence Franceschini) représente une autorité administrative indépendante. Elle a publié une série de recommandations, dont deux récemment, sur les salles mono-écrans et, cet été, sur les salles de deux ou trois écrans. Ces textes sont une base très concrète pour saisir la médiatrice s’agissant de l’accès aux films, même si on n’a pas toujours envie de se battre contre un distributeur avec lequel on travaille au quotidien.
En savoir + : Le Médiateur du cinéma
Les engagements de programmation spécifiques
Ils sont imposés à certains multiplexes qui se créent ou qui sont en extension, par rapport aux salles qui sont dans la même zone de chalandise. Ces engagements servent de base aux salles indépendantes pour un éventuel recours au médiateur dans l’accès aux films.
Xavier Lardoux incite les salles à anticiper au maximum leur programmation (en évitant de programmer le lundi pour le mercredi) car la brièveté des délais peut rendre les recours impossibles. Selon lui, les ententes et groupements nationaux de programmation peuvent aussi être une possibilité pour un meilleur accès aux films.
L’ensemble de ces outils de régulation nous sont enviés dans le monde entier, mais ils restent trop souvent méconnus des exploitants eux-mêmes. Il nous revient de faire œuvre de pédagogie supplémentaire. C’est dans cette perspective que le CNC a également accru son soutien sur l’art et essai depuis début 2017 : 1 million d’euros supplémentaires pour une enveloppe globale de 15 millions, avec des dispositions qui visent à tirer les salles art et essai vers le haut.
Christine Beauchemin-Flot présente le cas du Sélect, un mono-écran (avec plus de 100 000 entrées par an) étendu récemment à 4 salles. Avant cela, elle réagit à l’annonce des bons chiffres de fréquentation pour 2017 : ce ne sera pas le cas pour le Sélect où la fréquentation régressera pour la première fois depuis l’extension. Au SCARE et ailleurs, on est toujours un peu en décalage avec les annonces extrêmement positives et parfois erronées sur la fréquentation nationale, qui ne reflètent pas la réalité des salles indépendantes art et essai.
Christine Beauchemin-Flot revendique d’être à la fois directrice et programmatrice. Or le premier acte de programmation consiste à voir les films, tous les films (400 par an !). C’est très chronophage, surtout si on pratique la multiprogrammation sur quatre salles comme c’est le cas au Sélect. Christine Beauchemin-Flot ne programme pas toujours les films qu’elle préfère, mais assume ses choix et leur cohérence, insistant sur la nécessité de suivre une ligne éditoriale. En tant que cinéma municipal, le Sélect doit rendre des comptes à la ville et affirmer une forte identité art et essai n’est pas toujours aisé. Le passage d’une à quatre salles a fait l’objet de débats avec les élus et les habitants.
Le Sélect, seul cinéma de la ville, n’a pas de concurrent direct. De ce fait, il n’a pas pour l’instant de problèmes d’accès aux films, ce qui représente un cas un peu particulier dans le paysage des cinémas indépendants. Toutefois, il y a 15 jours, un multiplexe Pathé a ouvert à Massy. Un recours a été déposé en CNAC, mais il n’a pas abouti. C’est donc avec attention que Christine Beauchemin-Flot va s’assurer du respect des engagements de programmation de cet établissement.
La programmation du Sélect est mensuelle (de 3 à 7 semaines selon les périodes de l’année), mais ce rythme n’est pas imposé par des éléments extérieurs. L’équipe était jusqu’à présent composée de 11 équivalents temps plein et vient de passer à 12 après 3 années de fonctionnement sur 4 salles.
En savoir + : Le Sélect
Caroline Lonqueu-Lahbabi est directrice des salles Utopia de Saint-Ouen-L’Aumône (5 salles) et Pontoise (1 salle) depuis 15 ans et y travaille depuis 25 ans.
Chez Utopia, la multiprogrammation est revendiquée. C’est un collectif interne de quatre personnes qui l’assure. Ce fonctionnement apporte une vraie diversité dans le choix des films et crée une relation forte avec les spectateurs.
Caroline Lonqueu-Lahbabi se retrouve dans les propos de Christine Beauchemin-Flot : la fréquentation sera en baisse en 2017. Certes le cinéma se porte bien au niveau national, mais sur quels titres ? Constat est fait qu’il est très compliqué de faire vivre les films les plus fragiles. Pour ce faire, le travail d’animation reste très important : on ne peut pas simplement se contenter de montrer les films. Par ailleurs, l’identité d’une salle passe aussi par les films qu’elle choisit de ne pas montrer. Comme le Sélect, l’Utopia n’a pas de problème d’accès aux films : c’est un privilège de ne pas pouvoir satisfaire toutes les demandes des distributeurs.
En savoir + : Les cinémas Utopia de Saint-Ouen L’Aumône et Pontoise
Sylvain Clochard dirige le Concorde à Nantes. Le contexte y est très concurrentiel, sur un territoire qui a été marqué par l’arrivée des multiplexes. Il est également à l’initiative de Micromegas, un groupement national de programmation destiné aux salles indépendantes. A ses yeux, les deux activités sont intimement liées.
Les parents de Sylvain Clochard ont acheté le Concorde en 1984, à l’époque où toutes les salles fermaient. Ils n’avaient aucune connaissance de ce marché. Ils ont décidé de passer les films qu’ils aimaient, à savoir les grands films cultes. Toute une génération s’est retrouvée autour de ces films et la salle a fonctionné contre toute attente.
Lorsque le Gaumont du centre-ville (6 salles) a fermé, le Concorde a vécu une époque bénie qui s’est arrêtée net quand Pathé a rouvert un établissement avec 12 écrans. En périphérie, à Saint-Herblain, Pathé et UGC ont par ailleurs ouvert deux établissements à quelques mètres de distance l’un de l’autre, ce qui a donné lieu à une guerre des tarifs sévère à partir de 1996.
Le même schéma s’est reproduit au sud de la ville avec le groupe Cinéville et le Katorza, qui est certes labellisé art et essai, mais qui demeure une salle de circuit. De plus, un multiplexe « Leclerc » a ouvert en 2003, également en périphérie Sud. La salle UGC historique de centre-ville a elle aussi pratiqué une guerre des prix avec des tarifs extrêmement bas : des entrées à 10 francs puis à 2 €.
Le Concorde a donc eu à muter sans cesse. Les groupes ne se préoccupaient pas des indépendants et leur implantation a créé de véritables dommages collatéraux. Le Concorde a perdu énormément d’entrées, a dû emprunter, retravailler son identité et recentrer sa programmation. Face à Gaumont, Pathé, UGC, Cinéville et Leclerc, Le Concorde ne pouvait pas rester seul indépendant au risque de se faire manger. « On a eu besoin de recréer du collectif. Or, quel est le dénominateur commun des indépendant ? La programmation. »
En savoir + : Le Concorde
C’est ainsi qu’est né le projet de Micromegas, un groupement de programmation qui n’implique pas pour les salles de déléguer leur programmation (contrairement aux ententes de programmation), mais de confier la négociation de leur programmation avec les distributeurs. Il importe de préciser que les groupements de programmation ont un champ d’action national, contrairement aux ententes de programmation qui sont d’échelle régionale. Aujourd’hui, Micromegas compte 100 écrans sur 50 sites et représente 1% du marché.
Lorsqu’il lui est demandé quelle est la taille critique d’un groupement national de programmation, Sylvain Clochard tient à préciser que Micromegas « ne cherche pas à grandir pour être plus fort. L’objectif est d’être efficient. Faire sa programmation seul est très chronophage, mais négocier également. Nous constituons une communauté d’adhérents qui échangent sur ce qu’ils vivent. On mutualise et on échange au-delà de la programmation : sur le passage au numérique, sur la concurrence avec les multiplexes. Nous accompagnons les salles dans leurs projets. » Cet accompagnement se fait aussi bien quand tout va bien que lorsqu’il y a des problèmes d’implantation de multiplexes par exemple.
En contrepartie Micromegas prélève 2 à 3% HT des recettes sur la base film. Cette donnée n’influence pas les choix de programmation des salles. Les facteurs de décision dans les choix de programmation se jouent ailleurs.
Antoine Leclerc demande aux exploitants présents s’ils utilisent des outils informatiques pour gérer la programmation, assurer un suivi. Pour les participants à la table ronde, le cahier, le crayon et la gomme restent des outils de prédilection, même si les équipes des cinémas représentés utilisent des logiciels spécifiques. Pour Christine Beauchemin-Flot, le papier et le crayon répondent au geste intuitif et subjectif de programmation. Il serait d’ailleurs dangereux de s’en remettre à des algorithmes qui indiqueraient quel serait le meilleur film pour telle ou telle séance !

Questions du public
Renaud Laville – AFCAE constate que les salles art et essai ont connu plusieurs bouleversements : le passage au numérique, l’évolution de la chronologie des médias et, actuellement, le départ de toute une génération d’exploitants. Le contexte de concurrence est aujourd’hui particulièrement inquiétant : un projet de multiplexe qui repasse en CNAC a quasi 100% de chance d’être autorisé. Par ailleurs, nous venons d’apprendre la vente de Cap Cinéma à CGR.
Or les outils de régulation sont nés pour l’essentiel dans les années 80 et ont simplement été adaptés (la loi Raffarin sur les multiplexes date de 1996). Dans ce contexte, comment arriver à se moderniser en conservant le maillage existant de cinémas avec une ligne éditoriale forte ? Aujourd’hui, le risque, c’est le manque de volonté politique, au moment même où on a besoin d’un nouvel élan politique très fort. C’est toute une nouvelle génération d’élus auprès desquels il va falloir faire de la pédagogique.
Xavier Lardoux répond que le CNC a tout de même donné un nouvel élan avec la volonté de structurer et de valoriser les salles art et essai avec la réforme qui va porter ses fruits dans les mois et années qui viennent (l’art et essai n’avait pas été réformé depuis 15 ans). Outre les aides financières supplémentaires, des outils de valorisation et de communication autour des films art et essai ont été créés (des pastilles réalisées par Michel Gondry, des cartons indiquant qu’il s’agit de films art et essai projetés avant les films concernés) : l’art et essai est un bijou national, il faut en être fier et le revendiquer. Par ailleurs, l’aide à la création et à la modernisation des salles concerne les salles indépendantes. Elle représente 8 à 9 millions d’euros chaque année et les projets en centre-ville sont favorisés. Elle permet d’aider les salles à hauteur de 400 000 € environ.
Tifenn Martinot-Lagarde – Drac Ile-de-France précise qu’il n’est pas exact de dire que, lorsqu’un projet d’implantation ou d’extension de multiplexe repasse en CDAC ou CNAC, il est autorisé dans presque 100% des cas. Par exemple, le projet d’un multiplexe à Claye-Souilly (77) en est à son quatrième passage sous différentes enseignes. En revanche, un projet aura plus de chances d’être autorisé si le nombre de salles prévues est revu à la baisse. Mais il est vrai qu’il est très compliqué de faire comprendre aux élus que l’impact de ces cinémas reste problématique.
Jean-Jacques Rue – Cinéma Utopia constate que le mot « œuvre » n’a été cité qu’à deux reprises. Or un fossé se creuse entre les œuvres. Il n’y a pas « trop de films » sur les écrans, mais trop d’écrans qui montrent les mêmes films. Il y a des films magnifiques qui ne sortent que sur 10 copies. Le numérique n’est pas du tout la panacée en ce domaine. En tant qu’exploitant, il arrive à Jean-Jacques Rue de faire de la micro-distribution.
En ce qui concerne la médiation, Jean-Jacques Rue dénonce certains effets ubuesques et pervers : à Bordeaux, Utopia a été obligé de déprogrammer le film de Vincent Macaigne à la demande de Bac Films pour programmer The Square qui était déjà à l’affiche dans toutes les salles bordelaises et qu’Utopia comptait programmer plus tard. [lire la rectification de Laurence Franceschini ci-dessous]
Fabienne Hanclot – ACID fait remarquer que les multiplexes sont intelligents : ils se positionnent eux aussi sur l’art et essai. Par ailleurs, elle considère qu’il faut casser l’image de salles indépendantes « sous perfusion ». On ne dit pas du théâtre public qu’il est sous perfusion. Il s’agit d’un enjeu culturel, donc d’une volonté des élus. Enfin, s’agissant de l’accès aux films, l’alternative n’est pas dans tous les cas le groupement national de programmation, qui n’est pas aussi vertueux partout.
Séverine Rocaboy – Cinéma Les Toiles à Saint-Gratien (95) insiste sur le fait que négocier avec les distributeurs n’est pas une perte de temps : cela permet de parler des films et de se faire connaître. Par ailleurs, l’Acrif et le GNCR sont deux ressources précieuses. L’Acrif organise chaque mois des projections de films parmi les plus singuliers. On parle, on se rencontre, on « se pique » des idées. Pour ce qui la concerne, jamais Séverine Rocaboy ne sera programmée par une entente. Quand une salle ne va pas bien, c’est souvent parce qu’elle n’a pas l’équipe nécessaire pour que les films qui le méritent soient vus.
Marc Olry – Lost films fait part de son expérience : « je vais au combat tous les jours et, cette année, je me suis senti mourir. Je suis très dépendant des salles et je me rends compte que je parle de moins en moins de cinéma avec les exploitants. » Pour le film de Jean-Baptiste Thoret, We Blew It, la présence du réalisateur est posée comme condition à la programmation du film et Marc Olry se retrouve à devoir gérer ses déplacements, ce qui n’est a priori pas le travail d’un distributeur. Il se dit même asphyxié par les tout petits distributeurs. Notre pain quotidien, qui est un chef-d’œuvre, est sorti dans une seule salle en France ! Ces films risquent de ne même plus être produits.
——————————
Laurence Franceschini, Médiateur du cinéma, a pris connaissance de cette restitution et souhaité rectifier certains propos tenus : « le film The Square n’est pas sorti en sortie nationale à l’Utopia de Bordeaux mais en décalé, après qu’un accord a été trouvé en réunion entre le distributeur et l’exploitant. Cet accord était le résultat d’une conciliation, (…) aucune déprogrammation de film déjà confirmé n’a été mentionnée, celle-ci étant de l’entière responsabilité de l’exploitant. » Par ailleurs, Laurence Franceschini tient à rappeler la nécessaire « confidentialité du contenu des médiations, (…) les parties prenantes à la médiation étant tenues au secret des affaires. »
LE PANDORA À AVIGNON
Présentation par Vincent Clap, co-directeur et Arnold Henriot, programmateur du Pandora à Avignon
Avignon est une grande ville de culture, très dynamique en termes d’exploitation. Elle compte, outre le Pandora, le Vox (2 écrans en centre-ville), le cinéma Utopia réparti sur deux sites et deux multiplexes en périphérie.
Le Pandora a fait l’objet d’un projet de reprise il y a trois ans pour faire de ce cinéma un lieu multidimensionnel, « un ovni de l’exploitation cinématographique » : 3 salles ont été conservées et la quatrième a été transformée en studio. Actuellement, la structure salarie cinq personnes, en plus des deux associés (qui ne se versent pas de salaire) : un programmateur théâtre, un programmateur cinéma, deux salariés pour l’accueil et l’événementiel cinéma, une personne au pôle création.
Le Pandora dispose de trois salles et d’un studio ; il combine trois pôles d’activité :
- La programmation cinématographique
- La programmation théâtrale
- La création et la production de vidéos Youtube.

Le pôle cinéma
La programmation est plutôt grand public avec des films projetés en V.O. (ce qui n’est pas le cas dans les multiplexes). La programmation est mensuelle et des événements sont organisés chaque semaine. Le cinéma fait tout un travail avec différentes associations. Des séances de ciné-club sont proposées et animées par « le fossoyeur de films », un youtubeur accueilli en résidence par le Pandora. Une projection « Vers les docs » est programmée toutes les deux semaines, et des soirées exceptionnelles ont lieu (soirée « veillée », ciné-concerts…). La phase finale d’un concours de jeux vidéo a même été projetée sur grand écran.
La clientèle est jeune et va des adolescents de 15 ans aux trentenaires actifs.
L’accompagnement des films est conçu de façon originale, par exemple avec des ateliers d’incrustation des spectateurs dans les affiches ou photos de films, rendus possibles par l’existence d’un studio équipé d’un fond vert.
Le lieu a été ré-agencé pour le rendre le plus convivial possible : derrière la billetterie, un bar a été créé qui propose de la petite restauration. Cela permet aux spectateurs d’échanger sur les films de façon confortable et chaleureuse. Un espace bibliothèque a été installé dans le hall avec le Wifi en accès libre.

Le pôle théâtre
Le Capitole accueillait déjà des spectacles pendant le festival d’Avignon mais il s’agissait simplement de louer les espaces. Pour se différencier des multiplexes, le Pandora a maintenu cette activité l’été, mais est devenu programmateur à part entière. Quelques événements ponctuels ont lieu également et des artistes de spectacle vivant sont accueillis en résidence en matinée.
Le pôle création

C’est le fer de lance du Pandora. Ses deux co-directeurs viennent du domaine de l’audiovisuel. Le studio est équipé en haute définition et 4 K et d’un fond vert ; il peut aussi accueillir des décors réels. Le Pandora est également équipé de loges, de locaux de stockage de costumes et de décors, de salles de formation et de deux salles de post-production.
Des ateliers d’éducation à l’image y sont proposés, notamment aux scolaires. Les espaces sont aussi ouverts sous la forme d’un medialab. Un label de vidéastes, « Pandora création », a été créé et 8 chaînes Youtube sont produites, toute orientées vers la vulgarisation culturelle.
Le festival Frames (Web vidéo festival) en est à sa seconde édition. Il a accueilli 3 000 visiteurs et rayonne au-delà du Pandora : des passerelles sont créées avec les autres établissements culturels du centre-ville et les différents publics (des événements sont ainsi organisés à la Collection Lambert, au Palais des Papes et au Théâtre du chêne noir).
Plusieurs projets sont en cours :
- la captation live de débats autour de films du patrimoine et la possibilité d’interagir par Internet,
- la postproduction numérique de tournages effectués dans la région et l’organisation de projections test,
- le développement du label Pandora création.
En savoir + : Le Pandora
LE GRAND PARIS, C’EST QUOI ET C’EST POUR QUAND ?
Présentation par Antoine Soulier-Thomazeau, urbaniste spécialisé dans la conduite de projets d’aménagement, actuellement chef de projet Canal et Plaine de l’Ourcq, Est Ensemble – Grand Paris
Cette présentation vise à donner une vision rapide de l’ensemble des enjeux urbanistiques du Grand Paris, afin de mieux envisager la question de la place des cinémas indépendants sur ce territoire en mutation.
Pourquoi s’intéresse-t-on à la création du Grand Paris ? Depuis cent ans, les villes ont explosé, en particulier les villes de plus de dix millions d’habitants que l’on appelle des « monstres urbains ».
La ville désigne deux réalités :
- L’agglomération (ou unité urbaine) qui inclut l’ensemble des communes dont la continuité du bâti présente un écart de moins de 200 mètres entre les bâtiments.
- L’aire urbaine qui se définit par l’ensemble de communes dont au moins 40% de la population se rend dans l’agglomération pour travailler. Cette définition qui prend en compte les déplacements pendulaires paraît être la définition de la ville la plus pertinente aujourd’hui. Aujourd’hui l’aire urbaine de Paris dépasse déjà largement les frontières de l’Ile-de-France.
Or les frontières administratives actuelles (communes et départements qui déterminent aussi les limites des régions) datent pour la plupart de 1790 : notre organisation administrative n’a pratiquement pas changé depuis plus de 200 ans quand, dans le même temps, l’agglomération parisienne est passée de moins d’un million à 10-11 millions d’habitants.
À partir de là, il convient de se demander quelle est la bonne structure pour réguler le quotidien de nos vies, dont la culture fait partie. Contrairement au reste de la France, Paris est très en retard dans cette réflexion. Cela fait quarante ou cinquante ans qu’en région, les villes se sont constituées en intercommunalités ou nouvelles administrations. Rennes a créé des districts dans les années soixante-dix et le Grand Lyon existe depuis les années soixante… A Paris, ce sujet n’est remis sur la table que depuis le début des années 2000.

Historique
1860 : Paris est circonscrit par l’enceinte de Thiers. On passe de 12 à 20 arrondissements en absorbant des villages voisins (les villages de La Villette et de Belleville par exemple, sur décision de Napoléon III). L’enceinte est démolie après la seconde guerre mondiale. En 1973, on construit le périphérique sur ce même périmètre fixant physiquement une frontière qui aurait dû disparaître avec l’accroissement de la ville.
1910 : on constate que la carte du métropolitain est restée quasiment identique à aujourd’hui. De nombreuses lignes s’arrêtent aux portes de Paris qui matérialisent encore la limite entre Paris et sa banlieue. Or on sait qu’aujourd’hui la première couronne fait déjà partie du centre-ville de Paris. C’est tout le débat qui nous anime aujourd’hui. On a presque arrêté de consolider le réseau de métro il y a 100 ans ! Il est à noter que la ligne 9 a pour terminus Mairie de Montreuil depuis 1933 et pourtant Montreuil a quadruplé sa population. Il y a eu un manque d’investissement dans les transports en commun, ce qui explique l’un des projets phare du Grand Paris : le Grand Paris Express.
1965 : Plan Delouvrier pour la région parisienne, date de création du RER et de cinq villes nouvelles autour de Paris conçues comme des pôles relais. Or c’est seulement aujourd’hui que ces villes commencent à devenir des pôles attractifs en termes d’emploi.
1968 : création des départements de petite et grande couronne.
Aujourd’hui on s’interroge sur la suppression des départements de la petite couronne.
1973 : construction du périphérique.
Pourquoi s’est-on mis à reparler du Grand Paris ?
Bertrand Delanoë, élu maire de Paris en 2001, a créé une mission de discussion et de dialogue avec les villes limitrophes en partant du constat que la plupart des services urbains parisiens (les transports publics, les stations d’épuration, la gestion des déchets, les cimetières notamment) reposent sur l’utilisation d’entrepôts ou d’implantations situés extra-muros, montrant l’étroitesse de Paris intra-muros. Le projet de couverture du périphérique Porte de Vanves et Porte des Lilas est né de ces discussions et de missions bilatérales qui ont été mises en place. Petit à petit un partenariat se crée, mais on est encore très loin de l’association.
En 2007, Nicolas Sarkozy lance un grand appel à projets aux architectes et aux urbanistes du monde entier. Il en est resté des idées et deux institutions :
- Le Forum métropolitain du Grand Paris qui est une instance de dialogue, un syndicat d’études qui permet aux maires franciliens de réfléchir à cette notion de métropole.
- L’Atelier international du Grand Paris qui a regroupé l’ensemble des architectes et de la matière récoltée lors de la consultation de 2007.
On s’est alors interrogé sur les limites d’un grand Paris qui pourrait même aller jusqu’au Havre d’ici 2050. Il existe aujourd’hui de nombreuses coopérations de l’Ile-de-France à la Normandie (création du grand port HAROPA notamment).
On est toujours dans ce débat et on n’a toujours pas trouvé de solution. Si on considère la plupart des élus des villes limitrophes de Paris, on constate qu’ils sont également élus au niveau national. Cela contribue à expliquer la lenteur des prises de décision, le jeu étant de savoir qui, au final, pourra exercer les fonctions-clefs.
De tout ce mouvement, plusieurs institutions sont nées :
- la Métropole du Grand Paris, qui pourrait être l’équivalent du Grand Lyon, et les établissements publics territoriaux qui la composent (il y en a 12 dont Est Ensemble Grand Paris),
- la société du Grand Paris (qui est un établissement public chargé de réaliser le nouveau réseau de transport en commun du Grand Paris Express),
- le Forum métropolitain du Grand Paris (cf supra),
- L’Atelier du Grand Paris qui a pour vocation d’alimenter les réflexions.
Par ailleurs il existe déjà des institutions qui gèrent nos grands services urbains et qui ont déjà un périmètre métropolitain dépassant largement la seule ville de Paris enfermée dans son périphérique :
- transports : Ile-de-France Mobilités
- déchets : SYCTOM
- assainissement : SIAAP
- chauffage urbain : CPCU
- logement : Grand Paris Habitat
- aménagement : Grand Paris Aménagement
- foncier : EPFIF
- urbanisme, planification : APUR, IAU-IDF
Ces différents acteurs agissent sans gouvernance unique. On aurait tout à gagner à créer une structure administrative pour articuler l’ensemble de ces politiques.
Il y a tout un débat autour du mode d’action pour faire naître la métropole : soit on agit par le biais des institutions, soir à travers les projets (dans une dynamique selon laquelle les institutions suivront une fois les projets lancés).
Le projet du Grand Paris Express
C’est le projet que tout le monde retient mais qui n’est qu’une toute petite partie de ce que devrait être le Grand Paris. Ce projet est en fait du rattrapage. Il s’agit de créer du lien entre les différentes lignes de RER avec la construction d’un réseau de 200 km. Cela coûte extrêmement cher et on assiste déjà aux premiers dérapages financiers. Un certain nombre de lignes supplémentaires (la 17 et la 18) sont aujourd’hui sur la sellette.
Le GPE implique la construction de nouvelles gares et un travail est mené pour aménager des quartiers autour de ces gares, un effort qu’il va falloir intensifier en construisant plus de logements, mais aussi en amenant des services culturels parmi lesquels des cinémas. C’est autour de ces futures gares que se jouent la création d’une métropole multipolaire avec plus de centralités animées aux fonctions rayonnantes.
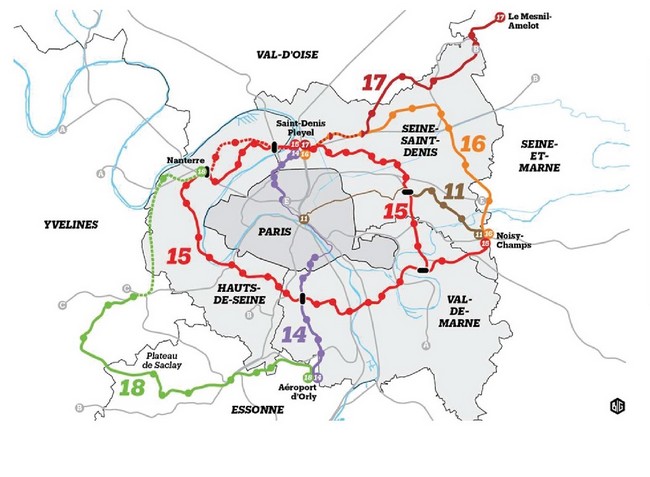
Les appels à projets
En 2014-2015, la Mairie de Paris a lancé un grand concours, « Réinventer Paris », pour contrer son image de ville musée où la nuit se meurt. Cet appel à projets urbains innovants pour transformer des friches que la mairie ne parvenait pas à valoriser et révéler tout leur potentiel a très bien marché : la ville a reçu 500 réponses et ce concours a rapporté un milliard d’euros à la ville, avec une polémique autour de la non-rémunération des architectes qui y ont participé.
Quand la Métropole du Grand Paris est créée en 2016, un appel à projets a également été lancé : « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Presque toutes les communes de la métropole ont participé et 55 sites sont concernés, en particulier autour des nouvelles gares. Les lauréats viennent tout juste d’être désignés.
Dans le cadre de ces appels à projets, les collectivités, avec leurs partenaires propriétaires des parcelles, soumettent à l’institution organisatrice du concours une parcelle pour laquelle il est proposé que des équipes soient constituées avec des architectes, des promoteurs, mais aussi avec les futurs utilisateurs de ces nouveaux immeubles qui, fait nouveau, sont désignés dès le montage des projets. Avant, les promoteurs se souciaient peu des usages qui en allaient être faits. Beaucoup d’immeubles en périphérie étaient construits sans commerces en rez-de-chaussée, ni équipements : on construisait des villes « exclusivement logement ».
Des effets pervers se sont fait sentir : pour la sélection des équipes par les jurys (constitués des vice-présidents de la Métropole du Grand Paris, et surtout des élus des collectivités partenaires et des maires), ce sont surtout les maires qui ont eu le dernier mot. On est retombé dans une sélection très locale et on a assisté à une course à l’échalote en matière de mieux-disant sur les charges foncières. On est censés utiliser ces appels à projets pour des investissements plus qualitatifs mais on n’y arrive pas toujours.
En Mars 2018, est prévue une 2eme édition d’inventons la Métropole. D’autres concours encore sont à venir : « Reinventing cities » a été annoncé par Anne Hidalgo en tant que présidente de C40, un réseau mondial de grandes villes qui vise à développer et à mettre en place des mesures politiques et des programmes afin d’aboutir à des réductions notables du gaz à effet de serre et des risques climatiques. Réinventer Paris 2 a également été lancé.
Les « grands projets métropolitains »
Ils désignent des projets lancés avant cette réflexion sur le Grand Paris, mais qui se trouvent en première ligne dans la mise en œuvre de cette métropole. C’est le cas des grands aménagements urbains de la Plaine Saint-Denis (accueil du village olympique, aménagement du quartier Pleyel), de Saclay ou bien encore de la plaine de l’Ourcq.
Concernant ce projet de réaménagement de La Plaine de l’Ourcq, il concerne 200 ha de sites industriels en reconversion appartenant à la petite couronne. Situé le long de 11km du canal traversant Est Ensemble, son aménagement se fait dans le prolongement de Pantin et dans la continuité de la rénovation lancée suite à l’implantation des cinémas Mk2 au bassin de la Villette dans le 19e arrondissement. Le projet comporte la construction de 10 000 logements à l’horizon 2030 dont des logements sociaux et très sociaux sur d’anciennes parcelles industrielles ou d’activité. Il faut aussi conserver de l’activité et garder une trace du passé industriel de la zone. Cela passera par le renforcement et la création de 6 ports fluviaux. Si on regarde la carte de la plaine de l’Ourcq, on constate qu’elle est coupée non seulement par le canal, mais aussi par la Nationale 3 et par le couloir ferroviaire de la gare de l’Est qui complexifient les liens de ville à ville. L’enjeu est de retourner les villes vers le canal. Le projet porte également l’ambition de faire émerger 3 centralités métropolitaines à l’emplacement des futurs nœuds de transport en commun : Raymond Queneau, La Folie et Pont de Bondy. Toutes ces transformations devront se faire avec la préservation d’un site exceptionnel en termes de nature, de loisirs de proximité et d’invitation à la campagne en grand périphérie (mais accessible en 40 minutes à vélo le long du canal !).
En savoir + : Consulter la présentation d’Antoine Soulier-Thomazeau
QUELS MODÈLES D’EXPLOITATION INDÉPENDANTE POUR LA MÉTROPOLE DE DEMAIN ?
Rencontre animée par Antoine Leclerc, délégué général du Festival Cinéma d’Alès – Itinérances et de l’association Carrefour des festivals. Avec Franck Lombard-Platet, directeur du développement et de l’exploitation chez Étoile Cinémas, Antoine Mesnier, directeur général du cabinet d’études Vuillaume CinéConseil, Sonia Pignot, maire adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et à la mémoire de la Ville de Saint-Denis et Boris Spire, directeur de L’Écran à Saint-Denis (93).
Quelle espérance de vie pour les cinémas mono, 2 et 3 écrans souvent déficitaires et dont l’activité dépend de financements publics qui se raréfient ? Dans les zones encore « sous-équipées » convoitées par les circuits, est-il possible d’imaginer un autre modèle d’exploitation, type miniplexe art et essai, qui permette de limiter la dépense publique ?
De grands chantiers d’aménagement urbain vont bouleverser les paysages de la périphérie : reconquête et rénovation des centres-villes, appels à projets métropolitains (les 56 sites d’ « Inventons la Métropole du Grand Paris », les gares du Grand Paris Express …) : quelle place pour le cinéma indépendant dans ces projets d’aménageurs ? De nouveaux modèles culturels et économiques peuvent-ils être inventés ?
En ouverture de la table ronde, Antoine Leclerc constate que la présence du cinéma est importante dans certains projets du Grand Paris. Dans certains cas, les grands gestes architecturaux autour du cinéma ne sont-ils pas les cache-sexes d’une certaine paresse urbanistique et d’une forme d’uniformisation en termes de programmation ? Et comment, dans une telle conversion, fait-on pour affirmer des missions culturelles fortes ?

Le cinéma : une valeur sûre pour les élus, les promoteurs et les financeurs
Selon Antoine Mesnier, s’il y a autant de projets de construction de cinéma, c’est d’abord parce que c’est un secteur qui se porte bien. Du point de vue des élus, des promoteurs ou même des citoyens, la fréquentation est importante et le nombre de films élevé. Dans les années 80, moins de 50% des Français allaient au cinéma et, aujourd’hui, ils sont plus de 66%. Quels sont les « drivers » de ces nouveaux projets ? D’abord les acteurs qui ont les moyens et veulent se développer, les collectivités qui ont une volonté et souhaitent voir évoluer leurs équipements ou en créer. Chaque commune veut « son » cinéma, certaines en viennent à se jalouser entre elles.
Depuis 1945, on assiste à une explosion urbaine, avec le phénomène de la voiture. Un des drames urbains a été la spécialisation : on a construit des quartiers de logements séparés des quartiers de commerce (avec des centres commerciaux immenses comme Vélizy 2). Ces zones sont performantes en termes économiques, mais produisent une vraie brutalité urbaine, une unicité. Les promoteurs étaient alors spécialisés. Désormais on leur impose d’entremêler les fonctions, de faire des commerces en pied d’immeuble, de construire des écoles, des hôtels, etc. Ce qui constitue une vraie contrainte pour eux.
Dans ce contexte, les promoteurs de centres commerciaux et des nouveaux quartiers ont les mêmes mots à la bouche : les loisirs, la culture. Concrètement, c’est ce qui fonctionne le mieux en termes de flux : c’est un secteur fiable et performant, qui offre une garantie de professionnalisme et entre en synergie avec l’activité des bars et restaurants. De plus, c’est un secteur qui ne pose pas de problèmes de sécurité. Et cela fonctionne sur la durée. Tous ces éléments font que c’est très rassurant pour les financeurs.
Antoine Leclerc remarque que le choix du cinéma se fait donc par défaut. Mais quel impact ont ces nouveaux projets sur les salles existantes ? Quels liens, quelle complémentarité ? A Saint-Denis, un projet d’extension du cinéma associatif L’Ecran, situé en centre-ville, est en actuellement en cours.
Le projet d’extension de L’Ecran, cinéma associatif art et essai de centre-ville à Saint-Denis
Sonia Pignot rappelle que Saint-Denis a d’abord disposé d’une salle mono-écran au sein du Théâtre Gérard Philipe. Le cinéma a été relocalisé en centre-ville et il est aujourd’hui géré par une association subventionnée. L’Ecran accueille 80 000 spectateurs chaque année : il existe une réelle complicité entre le public et la salle qui présente plus de 400 films par an.
Boris Spire explique que le projet d’extension de L’Ecran est né il y a une dizaine d’années. Il a fallu ce temps pour que le projet mûrisse. Le point de départ de la réflexion est né du constat qu’il manquait un lieu d’accueil au cinéma, avec un bar, un espace convivial, dont les spectateurs sont friands. Au terme d’échanges avec plusieurs architectes, il s’est avéré qu’il était possible de gagner des espaces en occupant une partie de la place située devant le cinéma et en construisant une salle supplémentaire sur une terrasse située au-dessus de la salle 2. Cet agrandissement de deux à quatre salles s’inscrit dans un projet de renouvellement du centre-ville aujourd’hui très dégradé.
Sonia Pignot confirme que le projet était resté dans les cartons un certain temps. Les villes sont de plus en plus soumises à des injonctions budgétaires : faut-il dès lors réduire les subventions allouées au cinéma ? C’est finalement le pari inverse que Saint-Denis a fait, en portant l’idée que le cinéma doit participer à une dynamique économique pour le centre-ville : « et si le cinéma pouvait être moteur d’un développement urbain ? »
Aux yeux de Sonia Pignot, il était effectivement essentiel que la rénovation et l’extension du cinéma soient inscrites dans le programme de rénovation urbaine, alors que ce n’était pas prévu au départ. L’objectif est de rouvrir le centre-ville à la population et d’en profiter pour y installer un équipement culturel, le cinéma, qui soit aussi un tiers-lieu où se pratique un accueil inconditionnel.
La question est maintenant de savoir comment s’inscrire dans la métropole, en lien avec les autres lieux et équipements culturels qu’on va accueillir sur le territoire : le 6B, La Piscine, des espaces à la Plaine Saint-Denis. Saint-Denis est une ville de 120 000 habitants et les équipements sont très concentrés en centre-ville. Il est parfois plus facile d’aller à Paris et la concurrence d’offres est très importante.

Antoine Leclerc précise que la ville de Saint-Denis est très étendue : quand on habite la pointe sud, il est plus rapide de se rendre à Paris pour aller au cinéma qu’en centre-ville. Or la ville de Saint-Denis va accueillir un second projet de cinéma. En effet, dans le nouveau quartier qui doit voir le jour autour de la Gare Pleyel, hub des futures lignes du Grand Paris Express, la culture ne sera pas absente. Notamment avec un projet de cinéma porté par Etoile Cinémas et, dès le départ, l’idée que L’Ecran y sera associé.
En savoir + : L’Écran de Saint-Denis
Le projet d’un cinéma porté par Etoile Cinémas, en partenariat avec L’Ecran, dans le nouveau quartier Pleyel, au sud de Saint-Denis
Franck Lombard-Platet tient d’abord à souligner qu’Etoile Cinémas a toujours défendu le cinéma art et essai. Le groupe possède plusieurs salles classées à Paris (Le Balzac, le Saint-Germain) où il est membre des CIP qui est un réseau de salles indépendantes, mais également dans les centres-villes d’autres communes (Le Cosmos à Chelles, L’Etoile Palace à Vichy…). Les politiques et les promoteurs ont fait ce constat que le cinéma était une locomotive et un moyen de lutter contre la désertification de ces centres-villes.
L’Etoile Lilas a constitué la première brèche dans le périphérique parisien. L’objectif était de s’adresser aux habitants des Lilas, de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et des 19e et 20e arrondissements de Paris. Un premier pas vers le Grand Paris.
Le groupe a ensuite été sollicité par des promoteurs pour animer des projets. S’agissant de Saint-Denis, Etoile Cinémas a fait le constat que le territoire est très étendu avec une grande qualité des équipements déjà présents (salle de cinéma L’Ecran, réseau Cinémas 93…). Il s’agit donc de tenter d’apporter une réponse vertueuse à travers la création d’un maillage des salles où celles qu’Etoile Cinémas créera seraient davantage une extension de l’existant qu’une mise en concurrence.
En savoir + : L’Étoile cinémas
Boris Spire indique que le lieu sera constitué de deux salles réparties autour d’un hall commun : une salle de spectacle vivant de 350 places avec une programmation musicale confiée au Glazart, et une salle de cinéma de 250 places programmée par L’Ecran, ouverte sept jours sur sept, proposant quatre séances par jour. Il est prévu que la grande salle de spectacles puisse être utilisée de temps en temps pour le cinéma (en journée notamment) et inversement. Etoile Cinémas prendra en charge le personnel et le coût de fonctionnement à l’année.
Franck Lombard-Platet reconnaît que, dans un premier temps, Boris Spire n’a pas accueilli Etoile Cinémas avec beaucoup de bienveillance. Mais ils ont réfléchi ensemble à une offre cohérente et diversifiée, avec deux programmations complémentaires et variées en fonction des deux implantations, qui constitueront une offre qui corresponde à tous les publics : c’est bien de faire du cinéma art et essai très pointu, mais c’est encore plus difficile d’amener tout le monde dans les salles.
Boris Spire suppose que la présence de Franck Lombard-Platet autour de la table a de quoi surprendre. Pour lui, ce projet est éminemment expérimental, sans équivalent en France, et personne ne doit être naïf sur les enjeux d’un tel partenariat. Mais il y a là une carte à jouer intéressante. L’objectif est d’inventer quelque chose de nouveau entre le public et le privé.
D’abord, Saint-Denis est un territoire très étendu. Le centre-ville n’est évidemment pas le seul endroit où les habitants ont envie de sortir. Cette proposition faite par le promoteur à Etoile Cinéma qui s’est adressé ensuite à L’Ecran porte sur des problématiques essentielles : la relation de proximité avec les lieux et le fait de s’adresser au plus grand nombre pour réduire les inégalités géographiques.
Ensuite, on assiste à une désertion des deniers publics pour ce qui touche aux enjeux culturels. En mettant en œuvre un partenariat public-privé, il y a quelque chose à inventer à cet endroit à aussi.

© Les Lumières Pleyel / Sogelym Dixence – Snøhetta – Baumschlager Eberle Architekten – Chaix & Morel et Associés – Ateliers 2/3/4/ – Mars architectes – Maud Caubet Architectes – Moreau Kusunoki
Sonia Pignot souligne que le cinéma une fonction d’éducation populaire et que le cinéma populaire n’existe pas seulement dans les multiplexes. Elle échange beaucoup avec Boris Spire sur ce point et ils sont tous deux convaincus que certains films de niche peuvent avoir un public populaire.
Les aménagements qui vont toucher la ville représenteront un énorme chantier : on redessine une nouvelle ville. Au départ, Saint-Denis n’était pas associée aux enjeux culturels de la métropole. Or les projets de la métropole ne doivent pas se faire au détriment des Dionysiens. La ville de Saint-Denis s’est donc invitée dans le dialogue : le projet de création d’un cinéma ne pouvait pas se faire sans elle.
Franck Lombard-Platet indique que, pendant la phase de concours, le rapport de forces avec le promoteur était en leur faveur et qu’ils ont pu dicter leurs conditions : la qualité de l’offre culturelle était un réel argument. Le nouvel équipement n’a donc pas été pensé comme un multiplexe, mais comme un lieu de distraction pour les habitants qui fera vivre le quartier et qui respecte l’existant. Dans ce cadre, L’Ecran aura pour fonction de programmer la salle : ils connaissent la population et sont en lien avec les associations. Le financement de l’équipement sera pris en charge en majeure partie par le promoteur.
Une délocalisation de billetterie devrait être mise en place. La structure sera une SCIC (société collective d’intérêt collectif) qui permet à la fois d’avoir des partenaires privés et publics. La répartition des droits de vote ne sera pas fonction des détentions de participations (ainsi le promoteur immobilier n’aura pas plus de poids dans les votes) : c’est la garantie dans la durée que chacun ait une voix qui aura le même poids.
Pour arriver à un équilibre économique, il est prévu de louer les espaces en matinée (le promoteur a volontairement sous-dimensionné les salles de réunion des bureaux du bâtiment). Un pourcentage des recettes HT sera reversé au cinéma L’Ecran. Une partie des charges facturées à ceux qui loueront les salles sera réservée au fonctionnement du lieu.

Questions du public
Jean-Jacques Rue – Cinéma Utopia considère que ce projet ouvre la boîte de Pandore. D’un point de vue symbolique, il trouve inquiétant que des professionnels comme ceux de l’Ecran, l’une des meilleures salles art et essai, qui vient de l’éducation populaire, délèguent une partie de leurs missions à un opérateur privé : « on connaît la dérive ultralibérale des partenariats public-privé ».
Boris Spire répond que le secteur de Pleyel ne concerne pas la même population que celle qui se rend actuellement à L’Ecran et que ce dernier sera, dans le même temps, agrandi : « à quel endroit perdrions-nous notre âme ? »
Franck Lombard-Platet fait remarquer que l’Ecran ne délègue pas une compétence. Il ajoute que l’idée est de créer de nouvelles habitudes de consommation. Enfin, il indique que tous les établissements d’Etoile Cinémas sont classés art et essai et qu’il existe une réelle politique jeune public à l’Etoile Lilas.
Franck Sescousse – directeur du Cin’Hoche à Bagnolet ne veut pas laisser dire qu’Etoile Lilas porte uniquement des projets de cinéma art et essai : l’actionnaire a demandé une réorientation de la programmation d’Etoile Lilas car celle-ci ne marchait pas. De plus, quand le groupe a ouvert ce cinéma, il a nié l’existence des salles de banlieue et l’implantation de ce nouvel établissement a privé ces salles d’une partie de leur public. Quant au travail sur le jeune public, L’Etoile Lilas n’a pas de médiateur et ne mène pas d’action d’éducation populaire.
Yves Bouveret – Ecrans V.O observe qu’Etoile Cinémas présente deux faces distinctes. D’un côté, un projet de cinéma à Saint-Denis Pleyel qui semble vertueux, avec une élue de choc. De l’autre, des projets de multiplexes commerciaux (avec 9 ou 10, voire 12 salles) situés en grande couronne, même si les luttes menées auprès de la CNAC ont tendance à faire réduire la taille des projets autorisés. Dans ce dernier cas, les engagements de programmation conclus en CNAC n’ont qu’une durée limitée de trois ans : il faut penser à de nouveaux outils.
Yves Bouveret évoque également la situation observée à Bezons, où un nouvel opérateur souhaite s’implanter avec cinq salles : la ville se demande si elle ne va pas fermer les deux salles de cinéma existantes car on lui a expliqué que le nouvel établissement de cinq salles serait suffisant.
Antoine Mesnier rappelle que, dans les années 80, des cinémas ont été sauvés par des mairies. Mais, depuis vingt ans, des réinvestissements sont à l’œuvre, souvent issus d’initiatives privées. Cela pose la question de la coexistence d’une salle municipale et de ces nouveaux établissements privés.
D’abord en termes d’offre cinématographique : quel sens donner à chaque équipement, quelle complémentarité ? On est aujourd’hui face à des situations qui n’existaient pas avant et qui nous ramènent aux films.
Antoine Leclerc relève que, contrairement à Saint-Denis (où est réaffirmé le rôle du cinéma existant), c’est la question de la substitution qui est ailleurs posée, avec l’effet booster que représente le Grand Paris. On constate que le plus souvent il n’y a pas de concertation. Doit-on faire du passé table rase ?
Selon Antoine Soulier-Thomazeau, les villes bougent, les sociologies évoluent. Si des promoteurs, des circuits s’intéressent à ces villes, cela n’est pas un mauvais signe. Ayant travaillé sur le projet de nouveau Méliès à Montreuil, Antoine Soulier-Thomazeau précise que les cinémas publics ont également en ligne de mire la conquête de nouveaux publics.
Arlène Groffe – programmatrice au Ciné 104 à Pantin demande si le projet d’un nouvel établissement Etoile Cinémas à La Courneuve, sur la friche Babcock, a été pensé sur le même modèle qu’à Saint-Denis ? Quels seront ses liens avec L’Etoile, le cinéma municipal existant ?

© La Courneuve Babcock, La Fabrique des Cultures / Compagnie de Phalsbourg – Dominique Perrault Architecture – Encore Heureux – Après la pluie
Franck Lombard-Platet ne le sait pas encore. Etoile cinémas ne peut pas intervenir dans un débat où il n’est que prestataire : c’est à la Mairie de la Courneuve de consulter les équipes de son cinéma l’Etoile et d’imposer ses choix au promoteur.
Sonia Pignot précise qu’à Saint-Denis, Etoile Cinémas n’a pas été accueilli à bras ouverts. La ville s’est imposée et a dit que les choses ne se feraient pas sans elle. C’est la même démarche qui devrait être menée à La Courneuve. C’est le rôle des élus que de l’affirmer.
Antoine Leclerc constate qu’en effet, le rôle des élus et leur réactivité sont fondamentaux. L’un des enjeux est de préserver une diversité cinématographique, un multiplexe diffusant en moyenne 200 films par an, alors qu’un cinéma comme le Sélect ou Utopia en diffuse plus de 350.
Fabienne Hanclot – ACID se demande quel sera le modèle économique du cinéma de Pleyel. Si le cinéma est un produit d’appel, cela passe par la programmation. Or il ne s’agira pas ici d’une politique culturelle financée par la collectivité. Se pose donc la question des films qui seront programmés.
Franck Lombard-Platet lui répond que la salle sera bien un produit d’appel, mais qu’à l’opposé du modèle des multiplexes, la programmation sera très exigeante, sur le modèle du 104, rue d’Aubervilliers : pourquoi une programmation de qualité ne remplirait-elle pas la salle ?
Une représentante de l’association de défense du cinéma indépendant à Argenteuil indique que, dans cette ville, un multiplexe Etoile Cinémas de 9 salles se construit à 200 mètres du cinéma municipal, le Figuier blanc, alors que ce dernier était sous-utilisé faute de moyens financiers et, ouvert depuis 2009, a représenté un investissement public de 17 millions d’euros.
Franck Lombard-Platet fait remarquer qu’avec seulement deux écrans, on ne peut pas sortir tous les films : la diversité passe aussi par l’augmentation du nombre d’écrans et, de ce point de vue, Argenteuil était sous-équipé (2,5 écrans pour 110 000 habitants). Il souligne également le fait que Le Figuier blanc est financé par de l’argent public, mais que 60% de la population n’y va pas car la programmation ne lui correspond pas : « les jeunes de la dalle ont l’impression d’aller dans un musée d’art contemporain. »
José Agusti – président d’Ecrans VO intervient pour rappeler l’histoire récente des cinémas de la périphérie parisienne à travers le cas d’Argenteuil. Lorsque, en 1984, UGC est passé de 600 à 500 000 entrées, Alain Condroyer est allé voir le maire de la commune en lui disant : « moi, je ne peux plus travailler, je ferme les salles. Si vous voulez, vous les reprenez. » C’est ce qui s’est passé à Argenteuil, et plus largement en banlieue avec la reprise de cinémas privés par les municipalités. Aujourd’hui, ces mêmes groupes, ou de nouveaux, reviennent avec des projets de multiplexes, en promettant monts et merveilles. Mais, dans quelques années, si cela ne marche pas, ils n’auront pas de scrupules et s’en iront à nouveau. Or il y a beaucoup de personnes qui font un travail magnifique dans ces cinémas publics, et maintenant que le travail magnifique est fait, évidemment, cela suscite les convoitises.
Antoine Leclerc clôt les échanges très animés et passionnants.
Contact
Ressources
Partenaires
La Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France, la DRAC – Île-de-France, Cinéma Public, L’ACID, le SCARE, Écrans VO, le Fil des images.





