Journées professionnelles 2018
Les 14, 15 et 16 novembre 2018 s’est déroulée la sixième édition des Journées professionnelles organisées par Cinémas 93. Retrouvez la restitution de ces 3 journées
Éveil culturel et développement de l’enfant avant l’entrée à l’école, prélude à l’éducation à l’image ?
LA CULTURE ET L’IMAGE ENTRE ACQUISITIONS ET APPRENTISSAGES
Conférence de Bernard Golse est pédopsychiatre, professeur des universités – praticien hospitalier de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris Descartes.

Introduction : l’approche Piklérienne
Bernard Golse place la question du lien au cœur de ses recherches et de sa pratique. Quand on s’intéresse au développement des tout-petits, il faut avoir à l’esprit la façon dont le bébé va se représenter tous ses liens avec l’environnement. Après avoir travaillé de nombreuses années auprès de bébés, d’enfants autistes et d’enfants adoptés, Bernard Golse est arrivé à la conclusion que la question du lien est au cœur de ces trois domaines : l’autisme est une absence de lien et l’adoption implique que des liens se tissent avec des adultes qui souhaitent se positionner comme parents. Or l’accès à la culture et au langage a un rapport avec cette question du lien. Lire ou observer des images avec les tout-petits a des effets très profonds sur leur construction psychique.
L’association Pikler Lóczy-France a été fondée dans la mouvance de l’institution Pikler Lóczy de Budapest. Emmi Pikler était une pédiatre avant-gardiste hongroise qui a développé des idées très innovantes dans les années 1930, à une époque où cette ville était une des grandes capitales de la psychanalyse. Elle considérait les bébés comme des personnes actives et donc co-acteurs de leur développement. À la fin de la seconde guerre mondiale, la ville était en ruines. Emmi Pikler, bouleversée par les enfants rescapés, a accueilli nombre d’entre eux dans une villa de la rue Lóczy que l’État hongrois lui a donnée. Il ne s’agissait pas pour elle d’assurer uniquement leur survie physique mais de les aider à se construire et à devenir des personnes dignes de ce nom. Entre 1946 et 2011, la villa de la rue Lóczy a accueilli plus de 5 000 enfants entre 0 et 6 ans.
On retrouve le principe qui a guidé le travail d’Emmi Pikler dans toutes les pédagogies actives. Le bébé humain a beau être à la naissance le plus inachevé de tous les mammifères, il a une part active à jouer dans son propre développement, il n’est pas un être purement passif. Très tôt, il a plaisir à découvrir par lui-même ce qu’il est capable de faire, accompagné par une personne qui ne fait pas tout à sa place. Il participe ainsi à la construction d’une estime de soi.
Myriam David et Geneviève Appell ont importé ces idées en France dans un livre devenu culte, Le maternage insolite, paru en 1973. Dans les années 1980, elles fondent l’association Pikler Lóczy en France. En 1984, la série télévisée en 3 volets Le bébé est une personne réalisée par Bernard Martino contribue au rayonnement de l’approche piklérienne auprès d’un plus grand public.
De 0 à 2 ans : enjeux et objets transitionnels, objets d’attention conjointe
Dès qu’un bébé arrive au monde, il se retrouve confronté à plusieurs grands chantiers développementaux, interdépendants les uns des autres :
- Un certain nombre de fonctions vont s’enclencher, à commencer par la respiration aérienne. Le bébé est alors confronté à la discontinuité : le rythme des tétées, la soif, la faim, les excrétions…
- Un attachement avec un adulte se met en place. Pour cela, il faut une très grande présence et une accessibilité de l’adulte. Petit à petit, le bébé est capable de penser à lui et de se le représenter pour supporter son absence.
- Il accède à l’intersubjectivité : le bébé va pouvoir ressentir, intégrer, éprouver que lui et l’autre font deux, qu’il y a un écart entre les sujets. C’est dans cet écart que vont se développer tous les liens, en particulier le langage.
- Il faut que s’établisse une régulation entre plaisir et déplaisir : le bébé va rechercher les situations de plaisir et éviter celles qui provoquent le déplaisir. Il lui faudra « savoir attendre ». Puis un jour le bébé tiendra compte du plaisir et du déplaisir de l’autre.
Les expériences culturelles partagées facilitent l’accès à l’intersubjectivité. Pour qu’un enfant puisse ressentir l’altérité, il faut à la fois creuser l’écart en soi et avec l’autre, avec douceur pour éviter l’arrachement, et créer des liens pour ne pas se perdre. Il faut se détacher sans se lâcher.
Entre l’adulte et le bébé, les liens doivent être générés de concert. C’est à cela que servent par exemple les jeux d’imitation. On parle de « dialogue tonique » lorsque le bébé et l’adulte s’ajustent. Entre 18 mois et 2 ans, le langage fait son apparition. Jean-Bertrand Pontalis, grand psychanalyste et auteur de romans psychanalytiques, explique que si le langage verbal nous touche à ce point c’est parce qu’il ne nous parle que de séparation. Le langage est la séparation même : pour parler à un autre, il faut que l’autre soit précisément un autre. C’est le très beau paradoxe du langage : parler c’est un constat d’écart. Les plus belles histoires d’amour fusionnelles sont muettes, mais ne sont-elles pas celles qui comportent aussi un moment de défusion ? Dire « je t’aime » pour ne faire qu’un, c’est constater qu’on est deux tout en le masquant, c’est tenter de renouer avec une fusion perdue. Les activités culturelles, elles, permettent une défusion progressive.
Donald Winnicott, célèbre pédopsychiatre et psychanalyste anglais, a beaucoup travaillé sur cette question à travers les concepts d’objets et d’espaces transitionnels. On peut considérer que la culture est un objet transitionnel. Elle permet de se détacher sans s’arracher. Le bébé choisit souvent son doudou parce qu’il a des caractéristiques qui lui rappellent la fonction maternelle : la douceur, la rétention de la chaleur, son odeur, sa malléabilité. On peut aussi malmener, triturer un doudou. C’est la première possession « non moi », « first non me possession » dit Winnicott, un espace intermédiaire, potentiel. Ces objets transitionnels vont aider à se différencier sans se perdre. Car il ne s’agit pas de se séparer, mais bien de se différencier. Certains enfants n’ont pas de doudou, mais d’autres phénomènes en sont l’équivalent qu’on appelle « phénomènes transitionnels » : le langage et la culture en sont. Ils permettent de partager des émotions.
Le concept d’objet d’attention conjointe est également important. Dans Comment les enfants apprennent à parler, le psychologue Jérôme Bruner montre que les moments d’attention conjointe et partagée sur un objet sont essentiels au développement des enfants. Le langage le permet : il faut présenter les objets du monde aux bébés, sans être trop brutal. Si l’on montre un objet, l’enfant va le regarder en même temps que l’adulte avec un plaisir partagé et dans un climat de complicité.
« Ça, c’est un biberon. ». Au début, l’objet ne s’appellera biberon que dans un contexte précis. La complicité et la confiance entre l’adulte et le bébé sont contextualisantes. Comment alors donner un sens général au mot ? Il faut créer des moments de complicité décontextualisante pour que les choses gardent leur nom même en l’absence de l’adulte.
Le cinéma peut aussi jouer cette fonction. Pour un tout-petit, le cinéma n’a de sens que dans la relation avec un adulte. Le cinéma est alors un objet partagé.
Acquisitions et apprentissages : quelle différence ?
Les premières acquisitions ne sont pas des apprentissages car elles viennent du dedans. Les apprentissages, eux, viennent du dehors. Par exemple, on n’apprend pas à un enfant à marcher, la marche survient, elle surgit, c’est une acquisition. Il faut des obstacles considérables pour ne pas marcher ! De même on n’apprend pas à dire « je », ni à dire « oui ».
Margaret Mahler parle de « différenciation douce » à propos de cette série de triomphes nostalgiques dont l’un des exemples emblématiques est la marche : quelque chose s’est passé et désormais tout sera différent. L’enfant va payer ce progrès car tout à coup il se retrouve loin de sa mère. Le même affect de tristesse touche la mère à la fois triomphante et regrettant déjà que son bébé grandisse si vite. Les émotions partagées sont des occasions de faire prévaloir le triomphe sur la nostalgie.
Pour apprendre, il faut pouvoir dire « oui » à ce que l’autre nous apporte. Or dire « oui » peut être dangereux. Dire « non » à l’inverse nous protège. L’enfant ne peut aller à l’école que lorsqu’il est prêt à « prendre » quelque chose de l’enseignant sans que cela ne représente un danger. Il faut qu’il se sente en sécurité pour que la prise d’information ne soit pas vécue comme une menace.
La crise des 2 ans et demi : le passage au « je » et au « oui »
Vers 2 ans et demi, l’enfant va passer du « moi » au « je » et commencer à dire « oui ». Le passage du « moi » au « je » signe le passage de la possession à l’être.
L’enfant commence toujours par dire « non ». Vers 15 mois, quand la marche survient, les parents vont lui dire « non, ne touche pas à cela ! Ne fais pas cela ! ». L’enfant va alors inventer le « si » qui signifie « non, je ne veux pas de ton non », puis il passera au « oui ». Avec ce « oui », il commencera à ressentir que ce qui vient de l’autre n’est pas un danger. Cette phase correspond à l’apparition des ronds fermés dans les dessins d’enfant. C’est un signe que quelque chose se passe à l’intérieur de lui et qu’il commence à se ressentir comme une personne bien différenciée, bien protégée par ses enveloppes psychiques, corporelles, cutanées. Il faut tout cela pour aller à l’école.
Il y a de nombreux débats sur la scolarisation précoce des enfants à deux ans. Or, pour aller à l’école, il faut que la crise des 2 ans et demi soit élaborée. Rendre l’école obligatoire à partir de 3 ans est plus sensé. Avant, on risque de fragiliser les capacités d’attachement. En mettant les enfants à l’école trop tôt, on risque d’accroître les inégalités sociales car c’est dans les milieux sociaux les plus défavorisés qu’on observe les attachements les moins sécures, comme l’a bien montré Boris Cyrulnik. Il faut que les enveloppes soient bien fermées pour accepter l’autre.
La plupart des enfants font semblant d’écrire avant de lire. L’écriture n’est pas une activité qui leur semble dangereuse car elle implique que l’on éjecte quelque chose de soi. Mais lire revient à prendre en soi quelque chose de l’extérieur et à le lier à ses représentations. Avec les autistes, il est par exemple plus facile de leur apprendre à lire à partir de leurs propres textes, qui leur apparaissent comme étant moins menaçants.
L’éveil à la culture et la place du tiers
Le cinéma et les images pour les tout-petits touchent des processus de développement très précoces et profonds. Ils constituent une aire de partage émotionnel : on est ensemble à partir d’un objet qui nous rassemble, dans une situation d’émotions partagées. On pourrait les qualifier d’ours en peluche culturels. Ils sont l’occasion de savoir si l’on peut ressentir la même chose. Certaines personnes parlent au cinéma, cela rassure les tout-petits de savoir que les autres ressentent la même chose qu’eux, cela apaise une grande inquiétude. Mais il est également important de travailler le fait qu’on ne va peut-être pas éprouver la même chose. On peut se différencier au niveau des affects et des émotions autour d’un objet commun.
Le cinéma et les images permettent aussi d’aller vers un langage de plus en plus complexe en verbalisant les affects. On peut proposer des mots pour qualifier les émotions : c’est une aide pour l’enfant de constater qu’un adulte peut poser des mots justes, cela signifie qu’il peut partager et comprendre ce qu’il ressent.
Le cinéma et les livres ne viennent ni du dedans, ni de l’extérieur, ils se situent entre les acquisitions et les apprentissages. Pour un enfant, le film est un objet, le cinéaste n’a pas d’importance à ses yeux. Ce n’est donc pas un objet brutal qui s’impose à lui.
Se pose également la question du sens de l’esthétique qui se développe très précocement : les enfants sentent que quelque chose fait « tilt » des deux côtés.
Conclusion
La question de l’exposition aux écrans ne se pose pas ici car, au cinéma, il ne s’agit pas de laisser l’enfant seul devant un écran. L’intérêt du cinéma tient justement à la question du partage et des liens. C’est pourquoi il faut penser la question des conditions du cinéma avec les tout-petits pour en faire une occasion de relation et de différenciation douce dans un enchaînement qui va du corps aux images et aux mots.
La tolérance se nourrit toujours de la culture, vive le cinéma le plus tôt possible !
Questions
Une responsable d’un relais d’assistantes maternelles prend la parole pour témoigner d’une sortie au cinéma. Elle était installée au balcon avec les enfants tandis que des centres de loisirs occupaient le bas de la salle. Les salles de cinéma, avec leur configuration, sont-elles faites pour accueillir des enfants de 2 ans ? La médiathèque lui semble être un lieu plus « cocooning ».
Bertrand Golse rebondit sur cette question pour informer le public de l’ouverture depuis l’an dernier d’une université populaire du bébé à l’Université Paris V, imaginée pour faire dialoguer toutes les professions. Une de ses ambitions serait de mobiliser des assistantes maternelles. Concernant l’accueil des jeunes enfants au cinéma, le plus important est qu’ils soient à proximité suffisante d’un adulte.
Pour répondre aux remarques récurrentes sur les enfants qui ne tiennent pas en place pendant une séance, Bertrand Golse rappelle qu’ils ne peuvent penser qu’en bougeant. Le corps est de la pensée incarnée. Il arrive également parfois que certains enfants bougent beaucoup pour mettre à distance leurs émotions.
Une éducatrice en PMI au Blanc-Mesnil témoigne de son expérience au cinéma. Elle indique que les séances sont réservées à la PMI avec un accueil adapté, une lumière tamisée, les enfants peuvent bouger, même être débout et personne ne dit « Chut ! ».
Une enseignante de Très Petite Section de maternelle à La Courneuve évoque le fait que cette première séance de cinéma pour les tout-petits l’est aussi parfois pour certaines mamans accompagnatrices.
Enfin une maman, qui est par ailleurs réalisatrice, s’inquiète de l’attrait de son enfant de 12 mois pour les écrans. Bernard Golse renvoie au travail de Serge Tisseron pour répondre à cette question. Il s’interroge quant à lui sur la question de la protection à tout prix des enfants par rapport aux images alors qu’elles font partie de la vie. En les choisissant bien, regarder des images peut aussi être une formidable occasion d’être ensemble.
Ciné-danse LIGHT PLAY INTERPRÉTÉ PAR MIGUEL DE SOUSA
Interprété par Miguel de Sousa sur une chorégraphie de Christina Towle. Un spectacle mêlant danse et projection de films expérimentaux. Suivi d’une discussion avec Christina Towle.

Light play est un ciné-danse qui raconte l’histoire d’un petit garçon fasciné par l’univers du cinéma. D’abord seul devant l’écran, avec une loupiote pour éclairer l’espace, le garçon est émerveillé par l’arrivée d’un grand faisceau lumineux provenant du projecteur vidéo. L’espace s’illumine d’une lumière blanche, éblouissante, et l’ombre du petit garçon apparaît sur l’écran. Cette ombre, son double, devient son copain de jeu. Ce ciné-danse intègre et interagit avec 3 films courts autour de la thématique de l’ombre et la lumière : What Light Future Shorts de Sarah Wickens, Feet of Song d’Erica Russell et Rainbow Dance de Len Lye. Le spectacle a été créé pour des spectateurs à partir de 2 ans.
Light Play est une nouvelle proposition, un « spectacle tout terrain » qui s’inscrit dans la continuité de Danse la lune (2013), la précédente création de Christina Towle qui répondait à un certain nombre d’impératifs pour pouvoir être joué en salle de cinéma :
- des horaires de répétition variables selon les salles,
- des variations de tailles de plateaux et de distances salle-écran entre les différents lieux,
- une installation technique et scénographique nécessairement légère et rapide à monter.
Dans Danse la lune, la danse se juxtaposait aux films autour d’une même thématique. Avec Light Play, la réflexion a été menée pour aller plus loin et créer un lien entre le corps et l’image. Lors du processus de création, la chorégraphe et son danseur ont utilisé la Kinect, un dispositif interactif qui permet de capter et reproduire les mouvements. L’enregistrement a ensuite servi de fil conducteur à l’écran entre les trois films.
La narration de ce spectacle est non-linéaire et gravite autour du corps et de la lumière. Le premier film, What Light Future Shorts, présente la lumière comme un objet avec lequel on peut jouer. Quant à Rainbow Dance, il propose sa propre chorégraphie et permet un jeu de chat et de la souris entre Miguel, le danseur, et le personnage du film sur l’écran. Le dernier film porte sur une danse traditionnelle de la Guinée. Au final, Light Play est le voyage surréaliste et poétique d’un personnage qui découvre la lumière et son ombre, et plonge dans l’écran pour en absorber toute l’énergie dansante. Le corps de Miguel se charge de lumière et devient électrique. À la fin du spectacle, les enfants sont invités à danser sur le début de Feet of song.
LE MINIFILMCLUB, FILMS D’AVANT-GARDE ET EXPÉRIMENTAUX POUR LES ENFANTS DE 4 À 6 ANS
Présentation par Bettina Marsden, directrice de l’école maternelle Kita Grüne à Francfort.
Le Minifilmclub est un projet conceptualisé en 2015 au Deutsches Filmmuseum de Francfort par Christine Kopf, directrice de l’éducation cinématographique, et Daniela Dietrich, directrice de l’éducation muséale, aidées par des experts en éducation scolaire. Le Minifilmclub conçoit ses programmes pour les petits comme des expériences esthétiques et non narratives. Les participants se familiarisent avec les collections du Deutsches FIlmsmuseum et découvrent des films d’avant-garde en salle.
Le Minifilmclub est conçu comme une formation cinématographique pour les enfants en âge préscolaire de 4 à 6 ans. En Allemagne, l’école débute à 6 ans. À partir de 3 ans, les enfants peuvent s’inscrire au Kindergarten, le « jardin d’enfants », qui n’est pas à proprement parler une école mais un espace de découverte et de jeu, où l’on initie les enfants à la vie collective.
Le Minifilmclub accueille des groupes de 8 à 10 enfants. Les établissements peuvent s‘inscrire formellement depuis 2016. À ce jour, 37 groupes ont été accueillis, issus de 18 établissements. Une aide financière sur trois ans (2018-2020) a été accordée par l‘État pour faire rayonner cette expérience sur le plan national, notamment à travers la formation de passeurs et d’éducateurs spécialisés. D’autres cinémas et établissements devraient ainsi pouvoir s’emparer du projet.

Les objectifs
Les enfants découvrent l’histoire du cinéma comme médium, son dispositif technique et ses caractéristiques spécifiques. Le Minifilmclub vise également à sensibiliser les participants aux films abstraits et non-narratifs et à leur faire connaître le cinéma sur pellicule. A l’issue du projet, les enfants auront élargi leurs connaissances esthétiques et techniques et aiguisé leur curiosité.
La méthodologie
Le personnel pédagogique des établissements inscrits bénéficie d’une formation et travaille en relation étroite avec l‘équipe. Les rôles de chacun sont bien définis grâce à une session préparatoire au Kindergarten qui permet de s’assurer de la coopération active de tous les participants. Une soirée de présentation est même organisée avec les parents. Le déroulement du Minifilmclub s’articule autour de 7 visites de deux heures en matinée et s’achève avec une soirée de clôture là encore en présence des parents.
Dans un premier temps, il s’agit de permettre aux enfants de se familiariser lentement avec le musée et la salle de cinéma. Ils découvrent le matériel, le dispositif de la projection sur pellicule, ses caractéristiques spécifiques. Ensuite la projection d’un film d’avant-garde est organisée en salle (des œuvres de Len Lye ou de Norman Maclaren font partie du programme). Les enfants participent dans la foulée à des activités créatives pour approfondir la compréhension de ce qu’ils ont vu lors de la séance. Un DVD du film est remis au Kindergarten avec les droits de diffusion pour organiser une seconde diffusion en présence des enfants qui redécouvrent alors le film avec les sens aiguisés. La soirée de clôture est l’occasion de discuter avec les enfants du travail effectué et des expertises acquises.
La première session porte sur la magie du cinéma. Le projectionniste projette de la pellicule vierge. Les enfants installés en salle peuvent communiquer avec lui et lui demander d’ajouter les couleurs de leur choix. L’opérateur s’exécute et peint directement sur la pellicule. Il peut également ajouter de la musique. Cette expérience est l’occasion d’une première rencontre avec le cinéma expérimental.
De retour au Kindergarten, les enfants peuvent se servir librement dans la DVDthèque qui est mise à leur disposition. Ils peuvent voir ces films seuls, en groupe ou avec un adulte dans une salle équipée à cet effet.
L’importance de la participation culturelle
La découverte et l’appropriation du musée sont une donnée importante. Certains parents ne sont jamais venus au Deutsches Filmmuseum. Les enfants développent une relation étroite avec les lieux qui deviennent « leur » musée et « leur » cinéma. Le but est aussi d’encourager la créativité des enfants et de leur faire prendre conscience qu’ils peuvent agir et non pas seulement réagir. Le choix de films non narratifs permet de contourner l’obstacle de la langue : à Francfort, seuls 30 % des enfants ont l’allemand comme langue maternelle.
La réussite du Minifilmclub dépend du temps qui est accordé aux enfants pour leur permettre de prendre possession physiquement des espaces du musée et de la salle de projection (ils peuvent courir dans les gradins par exemple), mais aussi des rituels et des pauses qui rythment les visites. La qualité de l’apprentissage est aussi tributaire des relations personnelles qui se tissent entre les élèves et les médiateurs. C’est pourquoi ce sont toujours les mêmes adultes qui interviennent auprès des mêmes enfants. On évite les jugements de valeur et on regarde les films en toute impartialité. Enfin, l’équipe essaye de maintenir la curiosité des enfants pour le médium film de façon soutenue. Il ne faut surtout pas baisser le niveau d’exigence : les jeunes enfants sont capables de voir des choses complexes.

Pourquoi des films d’avant-garde ?
Les enfants ont une grande capacité d’attention, une grande curiosité. Ils manifestent une réelle ouverture d’esprit envers toutes les formes cinématographiques. Entre 3 et 6 ans, peu leur importe si un film est muet, parlant, narratif, en noir et blanc. Ils retrouvent toujours des matières, des objets qui leur sont familiers (des ombres, de la danse, de la peinture…) dans les films qu’on leur propose. L’enfance est une phase de perception intense au cours de laquelle il n’est pas encore indispensable d’interpréter ses ressentis de façon utile. La langue n’a pas encore tout envahi. Pour autant, la fenêtre temporelle pendant laquelle la perception des enfants reste ouverte se referme plus rapidement qu’il y a cinq ou dix ans, avec la prégnance de l’audiovisuel dans leur environnement.
D’autres projets sont menés avec des enfants plus âgés (jusqu’à 10 ans), par exemple des films réalisés avec des artistes au moyen d’une bolex.
Le cinéma comme langage à l’école maternelle ?
L’IMAGINATION ENFANTINE SOUS LES REGARDS CROISÉS DE PSYCHOLOGUES ET CINÉASTES
Ciné-conférence de Marielle Bernaudeau, formatrice indépendante en éducation à l’image, rédactrice du blog La Fille de Corinthe.

En tant qu’intervenante sur le cinéma auprès d’élèves d’écoles maternelles, Marielle Bernaudeau se voit régulièrement confrontée à deux types de questions :
1/ Les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans. Est-ce bien raisonnable de les amener au cinéma sur le temps scolaire ?
2/ N’est-il pas dangereux de proposer à de jeunes enfants des histoires de fiction qui les détournent de la réalité ?
Il est aujourd’hui impossible d’ignorer ces questions même si, en matière de cinéma, le terrain n’est pas vierge : on a l’expérience des dispositifs d’éducation à l’image et de nombreux textes sur l’importance de la culture à l’école ont été publiés.
« L’art, cela ne s’enseigne pas, cela se rencontre, cela s’expérimente, cela se transmet par d’autres voies que le discours du seul savoir, et parfois même sans discours du tout. L’affaire de l’enseignement c’est la règle, l’art doit y gagner une place d’exception. » écrit Alain Bergala dans L’hypothèse cinéma, (Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2002). Dans les dispositifs comme Maternelle et cinéma, on ne parle pas d’écrans en général mais de cinéma. Le cinéma est un lieu de rencontre avec des œuvres et une pratique culturelle partagée.
Force est de constater un manque : il n’y a pas de recherche-action sur les liens entre le cinéma et les jeunes spectateurs comme c’est le cas dans le domaine des livres pour la jeunesse. Marielle Bernaudeau s’est donc tournée vers les recherches de psychologues tels que Paul Harris, un professeur anglais qui s’intéresse aux émotions et à l’imagination des enfants. Son ouvrage L’Imagination chez l’enfant : son rôle crucial dans le développement cognitif et affectif a été traduit en français (éditions Retz, 2007).
Le rôle de l’imagination est de produire des raisonnements contre-factuels : nous mettons en œuvre notre capacité d’imaginer des possibilités alternatives à la réalité. Ainsi l’imagination nous fait-elle réfléchir sur le passé, nous aide à comprendre le point de vue d’autrui et nous fait penser l’avenir. Marielle Bernaudeau propose donc de croiser les regards de chercheurs qui travaillent sur l’importance de l’imagination et de la fiction dans nos vies avec ceux de cinéastes qui mettent ces capacités en scène.
Les jeux symboliques du faire « comme si »
La pratique de ces jeux émerge chez l’enfant vers 2 ans en même temps que le langage apparaît. À cette période on constate l’importance des objets détournés, des tremplins à la création imaginaire.
Extrait Les cadeaux d’Aston de Lotta et Uzi Geffenblad

© Les cadeaux d’Aston de Lotta et Uzi Geffenblad (2012)
Marielle Bernaudeau insiste sur la manière délicate et sensible dont le film nous fait partager la vie psychologique du personnage. On éprouve son impatience du jour de son anniversaire de même que son impuissance qu’il va transformer en action : tout en attendant ses cadeaux, il va se mettre à en faire. La planche en bois d’Aston va devenir riche de multiples identités.
Le film fait écho à cette citation de Paul L. Harris : « Il est clair que l’action de faire semblant chez les jeunes enfants est tout au plus un détournement de la réalité, dans la mesure où des objets sont utilisés de façon créative comme supports, comme le seraient des accessoires de théâtre. A un niveau plus profond, le jeu symbolique offre une possibilité d’imaginer, d’explorer certaines possibilités inhérentes à la réalité et d’en parler. » (L’Imagination chez l’enfant : son rôle crucial dans le développement cognitif et affectif). Harris n’oppose pas imagination et connaissance de la réalité. Tous les enfants s’inspirent d’événements réels pour faire semblant. Ils extrapolent à partir de ce qu’ils savent des lois causales du monde réel.
Extrait Les trois brigands de Hayo Freitag

© Les trois brigands de Hayo Freitag (2007)
Tiffany est une enfant orpheline. Elle est seule dans une voiture qui la conduit à l’orphelinat. Elle a deux objets : un livre et une poupée. Elle fait semblant de lire le livre à sa poupée. On remarque ici l’importance du langage dans l’élaboration du jeu symbolique. Tiffany invente une « fiction efficace » qui l’aide à vivre. La poupée et le livre sont des objets transitionnels situés entre le dedans du monde intérieur de Tiffany et le dehors.
L’anthropologue Maurice Godelier a publié L’imaginé, l’imaginaire & le symbolique (CNRS Éditions, 2015) dans lequel il explique que le jeu du faire semblant existe dans toutes les sociétés humaines : « L’enfant qui joue au cow-boy en brandissant des revolvers qui font du bruit mais ne peuvent tuer personne sait qu’il (est et) n’est pas un « vrai » cow-boy quand il joue à l’être. Et lorsque, plus petit, il grondait son ours en peluche pour avoir fait pipi sur le tapis, il savait déjà que Teddy n’était pas un « vrai » ours et n’avait pas « vraiment » fait pipi. » L’enfant joue et sait qu’il joue. Il est à la fois lui-même et quelqu’un d’autre. L’enfant voit le monde du point de vue du personnage, comme si le monde se dédoublait.
Extrait Le Gruffalo de Jakob Schuh et Max Lang

© Le Gruffalo de Jakob Schuh et Max Lang (2011)
Cette séquence n’existe pas dans l’album. Les réalisateurs jouent ici avec l’une des émotions les plus fortes qui soient : la peur. On passe de la peur pour de faux à la peur pour de vrai. Une fois le danger éloigné, les cinéastes nous offrent un exemple d’activité libératrice : celle de maman conteuse. L’histoire racontée permet de recycler la peur réelle en peur symbolique. La présence de cette narratrice est un indice supplémentaire pour les jeunes spectateurs : le film est une fiction qui se présente comme telle, c’est une histoire pour de faux. Jean-Marie Schaeffer parle de « feintise ludique ». Une feintise sérieuse, c’est lorsqu’on se cache pour tromper les spectateurs.
Regarder la bande-annonce du Gruffalo
Dans J’élève ma poupée (L’École des loisirs, 2010), Christophe Honoré écrit : « Souvent, je me dis qu’être parent, ça devrait juste être ça, faire en sorte que son enfant soit capable de reprendre une histoire qu’on lui aurait racontée cent fois. Que le seul héritage qui vaille, c’est celui de notre imaginaire. Souvent, je me dis que le plus important conseil d’éducation au monde tient en moins de dix mots : prends soin d’écrire une histoire avec ton enfant. »
Marielle Bernaudeau achève sa conférence en faisant partager aux spectateurs son intime conviction : l’espèce humaine est profondément fabulatrice. Le plus beau cadeau que l’on puisse faire consiste à raconter de belles et riches histoires. Le cinéma en est un magnifique pourvoyeur.
Le cinéma comme langage à l’école maternelle ?
Table ronde avec Marielle Bernaudeau, formatrice indépendante en éducation à l’image, rédactrice du blog La Fille de Corinthe, Amélie Lefoulon, directrice adjointe, chargée des actions éducatives et partenariales de L’Alhambra à Marseille, Line De Smet, enseignante en maternelle à Pantin (93), Julie Rembauville, auteure jeunesse, réalisatrice de nombreux courts métrages d’animation et intervenante en ateliers, Marjolaine Rouzeau, professeur des écoles à l’école élémentaire Providence (Paris XIIIe), Annie Talamoni, chargée de la mission maternelle à la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis.
Animée par Camille Maréchal, Les Enfants de cinéma.
En partenariat avec Les Enfants de Cinéma

En introduction, Camille Maréchal pose les prémices de la discussion qui portera sur le sens et l’apport de l’expérience du cinéma à l’école maternelle. Dans ce domaine, un besoin d’allers-retours entre théorie et pratique se fait sentir. Plusieurs villes et départements ont inventé des dispositifs à destination des classes de maternelle (à l’instar de la Seine-Saint-Denis avec Ma première séance) et Les Enfants de cinéma ont lancé un dispositif expérimental, École et cinéma – Maternelle, qui a concerné 27 départements et près de 70 000 élèves sur l’année scolaire 2017/2018. Contrairement aux dispositifs nationaux, ce dernier n’a pas vocation à se généraliser.
En maternelle, les enfants vivent souvent leurs premières expériences de spectateurs de cinéma, leurs premières rencontres avec des œuvres cinématographiques. Dans le même temps, on constate une méfiance envers les images de la part des adultes. Serge Tisseron situe l’âge idéal des premières séances cinématographiques vers 6 ans, c’est-à-dire lorsque l’enfant est en mesure de bien comprendre le récit d’un film. Tout ceci contribue à alimenter une certaine frilosité envers le cinéma à l’école maternelle.
Camille Maréchal pose l’hypothèse que les professionnels présents autour de la table sont « sérieux », et « savent ce qu’ils font ». Cette table ronde est l’occasion d’explorer, à partir d’expériences de terrain, comment le cinéma peut répondre aux enjeux des classes de maternelle tant d’un point de vue esthétique que de celui des programmes, ces deux exigences n’étant pas exclusives l’une de l’autre.
La place du cinéma à l’école maternelle
Annie Talamoni rappelle que le langage est au cœur des programmes de maternelle. Un enfant qui a de bonnes compétences langagières va facilement entrer en lecture, en écriture et en compréhension. Depuis 2008, la maternelle est devenue la pierre angulaire de cette exigence mais les parents n’en n’ont pas vraiment conscience. Que le ministre de l’Éducation nationale souhaite rendre l’école maternelle obligatoire reste un vœu symbolique mais qui a le mérite de considérer la maternelle comme partie intégrante du système scolaire.
En 2015, les programmes de maternelle ont évolué et répondent désormais aux exigences de cinq domaines d’apprentissage :
- mobiliser le langage dans toutes ses dimensions,
- agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique,
- agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques,
- construire les premiers outils pour structurer sa pensée,
- explorer le monde.
Le cinéma a ainsi pu entrer à l’école maternelle par la porte des programmes officiels en apportant une réelle plus-value dans deux champs en particulier : le langage et les activités artistiques. Le cinéma permet de poser des mots sur ses émotions et le domaine artistique permet justement de faire l’expérience de nouvelles émotions.
Camille Maréchal ajoute que la pertinence des expériences menées autour du cinéma ne relève pas de la seule résonnance avec les programmes. Pourquoi se dit-on qu’il est pleinement pertinent d’emmener une classe de maternelle découvrir des œuvres cinématographiques en salle ?
Le déroulement d’une séance en salle de cinéma
Pour Line De Smet, c’est la rencontre avec un objet culturel dans un lieu dédié qui fait tout l’intérêt d’une sortie au cinéma. Les salles sont des structures proches des écoles (elles sont facilement accessibles), ces sorties peuvent se penser en termes de parcours et l’élève a la possibilité d’y retourner ensuite en famille. Il existe une grande différence entre les petites et les grandes sections de maternelle dans leur rapport au cinéma : pour les petits, on insiste en priorité sur la rencontre, la découverte du cinéma. Quant aux grands, en général, ils ont déjà une histoire avec le cinéma. Il apparaît donc, dit Camille Maréchal, que la responsabilité de la salle est immense. Le trajet, la mise en ambiance comptent beaucoup. Comment gérer cela ?
Pour Amélie Lefoulon il s’agit d’une responsabilité partagée. Comme prérequis il faut avoir un grand désir d’emmener de très jeunes enfants au cinéma et la relation que l’exploitant établit avec les enseignants est primordiale. L’Alhambra est une grande salle en gradins située dans les quartiers Nord de Marseille. L’accueil est pris en charge par un caissier qui a eu l’idée de découper un pan de la banque d’accueil pour pouvoir se mettre à hauteur d’enfants. Quand les élèves arrivent, ils découvrent l’affiche du film qui est systématiquement disposée à l’entrée du cinéma, ensuite tous les enfants passent à l’accueil pour retirer leur ticket, passage obligé pour obtenir ce sésame qui symbolise le fait d’être spectateur. Pour entrer dans la salle, il faut gravir des escaliers. Cela prend un peu de temps en raison de la motricité caractéristique de cet âge. Le rythme est très différent de celui des classes d’écoles élémentaires, il faut accepter de prendre son temps. Quand les élèves découvrent la salle, ils s’exclament souvent « C’est grand ! C’est noir ! » Il est alors nécessaire de prendre le temps d’expliquer comment la séance va se dérouler, de présenter l’écran, les rideaux, mais aussi pour les enfants de s’assoir confortablement et de regarder un peu en l’air. « Nous faisons le choix de projeter les films dans le noir sans lumière tamisée » explique Amélie Lefoulon. Une petite répétition est nécessaire pour mettre tout le monde à l’aise avant de lancer la séance.
En savoir + :
L’Alhambra
Des parcours de deux films sont proposés aux classes chaque année. Des temps de médiation sont expérimentés avant la projection proprement dite. La salle est véritablement un espace spécifique, une séance a un début un milieu et une fin, contrairement à l’usage des écrans qui est fait à la maison.
Camille Maréchal cite, pour appuyer cette remarque, l’ouvrage d’Yves Citton, Pour une écologie de l’attention (Éditions du Seuil, 2014) : la salle de cinéma fait partie de ces espaces où l’on peut se reconcentrer, elle a un côté contenant qui produit les conditions nécessaires à l’attention.
Line De Smet revient pour sa part sur la préparation des sorties du dispositif Ma Première séance. Des supports sont mis à disposition des élèves en libre accès pour leur permette de se projeter sur cette sortie. Après la séance, elle leur propose de réaliser un journal composé d’illustrations et de photogrammes accompagnés de quelques paroles d’élèves qui puisse être rapporté à la maison et ainsi servir de support pour évoquer la séance avec les parents.
Prendre conscience de ses émotions
L’expression « émotions partagées » est très importante aux yeux d’Amélie Lefoulon qui précise néanmoins que partager des émotions n’implique pas que l’on ressente tous, la même chose.
Concernant précisément la question des émotions, Marielle Bernaudeau tient à rappeler que, dans une salle de cinéma, l’enseignant se retrouve à côté des élèves, face à l’écran. Chacun est spectateur à égalité et les enseignants ont donc une place dans le dialogue qui est proposé. Par ailleurs il est important de respecter les enfants qui n’ont pas envie de partager leurs émotions.
Annie Talamoni ajoute qu’à cet âge il est nécessaire de revenir en classe sur ce qui a été vécu en salle, non pas pour dire ce qui est juste mais pour créer un espace mémoriel. On risque sinon de diminuer la plus-value des films découverts dans ce contexte par rapport à d’autres films. Une chose est de ressentir une émotion, une autre est d’en être conscient. L’enjeu de ce travail autour des films est la conscientisation des émotions, ce qui représente un travail très ambitieux et technique pour un enseignant.
Quand un enfant ne parle pas directement de ses émotions, on peut envisager différents dérivatifs, explique Line De Smet. Par exemple, les élèves ayant assisté à la projection d’un programme de courts métrages ont fabriqué des marionnettes à partir de leurs dessins des films. On peut multiplier les opportunités de parler, pas forcément en présence des enseignants d’ailleurs, en laissant aux élèves différents outils. Le langage entre pairs peut être une piste intéressante. Camille Maréchal évoque également les ateliers Danser les films proposés notamment dans le cadre de Ma Première Séance qui sont un moyen pertinent de se réapproprier le cinéma par le corps.
Les spécificités du langage cinématographique
Marielle Bernaudeau rappelle que les champs du cinéma et de l’album jeunesse relèvent tous les deux majoritairement du domaine de la fiction. Ce sont deux moyens de raconter des histoires même si le cinéma est une expérience collective tandis que la lecture d’un album crée un lien intime entre deux personnes. Une autre différence existe dans la façon dont le rythme de lecture d’un livre est choisi alors que celui d’un film échappe au spectateur, même si on peut aujourd’hui revenir en arrière ou faire pause quand on regarde un film sur un lecteur DVD.
Marjolaine Rouzeau, enseignante dans une classe de petite et moyenne section de maternelle, a travaillé sur l’album Le petit bonhomme de pain d’épices à partir duquel elle a réalisé un petit film avec ses élèves âgés de 4 ans. Dans la foulée, les enfants ont regardé un autre court métrage, Bottle, de Kirsten Lepore. Ce film qui parle d’une histoire d’amitié a été visionné à plusieurs reprises. Ce fut l’occasion de travailler en classe sur ce qu’est un message, à quoi cela sert. Les enfants en ont même fabriqué différents types. Ils ont aussi créé une maquette des décors pour prendre conscience de la distance qui sépare les deux personnages du film. La fin de l’histoire où l’on constate que ces deux personnages ne parviennent pas à se retrouver a permis de travailler sur le phénomène de la dissolution. De nombreuses autres activités ont été menées en lien avec le film : un goûter philo sur l’amitié, une dictée à l’adulte… Le film a été envisagé comme un support au travail sur le langage et la compréhension, mais aussi comme permettant de mettre en place des activités dites « décrochées ».
Pour Camille Maréchal, ces activités ne sont pas annexes au film. Même si certaines d’entre elles relèvent du programme « Explorer le monde », on reste au cœur d’un travail sur les choix cinématographiques. Le film n’est pas envisagé ici comme simple prétexte.
Marjolaine Rouzeau présente ensuite le portail films-pour-enfants.com auquel elle a contribué : il s’agit d’un site Internet qui propose un catalogue de courts métrages d’animation visibles dans le cadre familial. Les films mis en ligne ne sont pas « pour » les enfants mais visibles « par » les enfants. Ils sont regroupés par tranches d’âges et par thématiques (par exemple l’écologie, la différence, les animaux…). Il s’agit uniquement de films non commercialisés choisis pour leurs qualités graphiques et artistiques. Tous sont sans dialogues (et donc sans contrainte de langue). Un second volet du site dédié aux écoles et aux institutions propose un accompagnement pédagogique.
Quand un artiste se rend en classe
Julie Rembauville est intervenue dans une école maternelle de Noisy-le-Grand qui avait construit son projet d’établissement autour du cinéma d’animation. Chaque classe devait réaliser un film et elle jouait le rôle de « facilitatrice ». Dans un premier temps, elle a suivi à distance le travail effectué en classe par les enseignants : elle échangeait avec eux par écrit et était également en contact avec les élèves à qui elle envoyait des messages. Dans un second temps, elle est intervenue dans l’école puis au cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. Un atelier de bruitage a par exemple été mené avec une classe autour de l’album jeunesse La Moufle.
L’enjeu a été de s’adapter aux compétences d’enfants de 3-4 ans. Lors d’une séance d’atelier, elle a proposé de réaliser une petite séquence en pixillation. Les enfants devaient avancer en serpentant. L’un d’eux n’y parvenait pas parce qu’il ne comprenait pas ce qu’il était en train de faire (c’est-à-dire faire un film). Julie s’est alors rendu compte que c’est souvent au moment de la projection que le projet prend véritablement sens dans l’esprit des élèves.
Line De Smet a eu différentes expériences avec des artistes. L’an dernier, une réalisatrice est venue rencontrer des élèves de CP. Elle a pu expliquer très concrètement sa démarche : faire un film c’est faire des choix qui se construisent au fur et à mesure.
De plus en plus d’artistes et de cinéastes interviennent auprès des enfants mais malheureusement, pour Julie Rembauville, il arrive fréquemment que certains artistes souhaitent que les élèves s’adaptent à leur méthode. Il est beaucoup plus intéressant de demander aux enfants : que voulez-vous raconter ? Quels moyens mettre en œuvre ? On ne plaque pas une technique donnée sur n’importe quel sujet.
Le lien avec les familles
Amélie Lefoulon intervient pour rappeler combien le lien avec les familles lui semble important. L’emplacement de L’Alhambra à l’extrémité Nord-Ouest de Marseille en fait un lieu très mal desservi par les transports en commun. Pour s’y rendre, les classes doivent faire appel à des sociétés de cars privées. L’argent investi dans les transports ne peut alors pas être utilisé pour organiser des rencontres par exemple. Quand une classe se rend au cinéma, tous les parents qui souhaitent venir sont les bienvenus. Il arrive que ce soit la première séance pour eux également. Sans cette sortie, le vécu partagé ne pourrait pas s’opérer autour du cinéma. Dans un second temps, la salle essaye de proposer des rendez-vous aux familles en s’appuyant sur d’autres structures culturelles, comme la bibliothèque de quartier par exemple avec laquelle un parcours articulé entre les temps scolaires et familiaux a été imaginé autour du Gruffalo et du Petit Gruffalo.
Annie Talamoni constate que l’accompagnement des films est beaucoup plus harmonisé qu’elle ne le pensait et cela a le mérite de créer un cadre très rassurant pour les enfants de maternelle. Si l’objet est différent, l’accompagnement reste le même, il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Pour Amélie Lefoulon, cela tient beaucoup à la qualité du partenariat et de la co-construction. Camille Maréchal pense que la spécificité du très jeune public a poussé les différents acteurs culturels à inventer, mais elle regrette le manque de recherche-action dans le domaine du cinéma et des très jeunes enfants.

Questions
Une continuité existe-t-elle entre ce qui est entrepris à l’école et la pratique des familles ?
Annie Talamoni rappelle que la relation aux familles est primordiale. Le fait qu’un enfant issu d’un milieu populaire réussisse ou non ne dépend pas tant de l’aide que les parents pourront lui apporter que de l’enjeu qu’ils donnent à l’école. Les apports du cinéma à l’école n’ont pas été mesurés et on ne peut se fonder que sur la base d’un ressenti. Il faut par ailleurs bien garder à l’esprit que nous ne sommes pas là pour éduquer les parents. Ils sont libres.
Line De Smet ajoute que la présence de nombreux parents lors de la projection d’un film réalisé par les élèves marque leur adhésion au projet.
Amélie Lefoulon remarque pour sa part que, s’il y avait un retour au cinéma des familles dont les enfants sont impliqués dans des actions menées dans le cadre scolaire, les salles seraient pleines ; or ce n’est pas le cas. Les familles reviennent très peu au cinéma, elles se déplacent surtout pour voir les traces et partager un moment d’un projet initié dans le cadre de l’école. La mission de l’école est d’ouvrir les enfants sur le monde. Les parents eux ne sortent pas toujours.
Question à Julie Rembauville : quel rôle jouent les enfants dans la réalisation de vos propres films ?
Julie Rembauville : « On est très seul en animation. Mener des ateliers permet d’être dans la vraie vie. Dans le cadre d’un appel à projets de Canal + sur la liberté d’expression au quotidien sous la forme d’un film d’animation de 3 minutes, je me suis souvenue d’une discussion que nous avions eue avec des enfants. Nous l’avons retranscrite rythmiquement et graphiquement. La fiction se nourrit du réel. »
De l’expérimentation des formes au cinéma expérimental : mélange des formats, croisement des expressions artistiques, recherche poétique.
ATELIERS IMAGINÉS PAR DES ARTISTES
Avec Emilie Morin, réalisatrice et Laetitia Foligné, chargée de programmation de Comptoir du Doc, Paula Ortiz, cinéaste documentariste, Sébastien Ronceray, co-fondateur de l’association Braquage et Fred Soupa, documentariste.
Matinée animée par Anne-Sophie Lepicard, réalisatrice et intervenante en milieu scolaire.

Anne-Sophie Lepicard pose les enjeux de la rencontre entre l’éducation à l’image et les expérimentations de formes, autrement dit ce que l’on nomme plus communément le cinéma expérimental. Nombreux sont les projets qui se réfèrent en premier lieu au modèle narratif, avec un scénario et la construction d’une dramaturgie. Mais un certain nombre d’acteurs de l’éducation à l’image proposent d’autres approches, notamment sur les matières sonores et imagières. S’il est naturel que les enseignants de lettres se réfèrent d’abord à ce qu’ils connaissent, à savoir l’écriture et la narration, le cinéma expérimental est l’occasion d’aborder les choses autrement, avec une entrée plus directe vers certaines questions de cinéma, de montage, qui contournent la dimension narrative.
Sébastien Ronceray présente les activités de Braquage, association composée uniquement de bénévoles qui organise des programmations de films majoritairement sur pellicule (8, 9,5, 16mm…) et anime de nombreux ateliers dans des institutions, des établissements scolaires, des centres de loisirs, des festivals, mais également des squats, des cafés… Ces ateliers portent sur la pratique de l’intervention sur pellicule, le pré-cinéma et les lanternes magiques, le cinéma d’animation ou encore la photographie avec le rayogramme* et le sténopé**. Ces ateliers sont destinés à des publics à partir de 5 ans (pour les ateliers dessin/grattage sur pellicule) jusqu’à l’âge adulte (atelier de création d’images sur support film sans utiliser de caméra).
* Le rayogramme est une photographie obtenue par simple interposition de l’objet entre le papier sensible et la source lumineuse.
** Le sténopé est un dispositif optique dérivant de la camera oscura. Il s’agit d’un trou percé sur la paroi d’une boîte afin de faire rentrer la lumière. Sur la surface opposée à ce trou, un support photosensible peut capturer l’image de l’extérieur.
Projection 16 mm d’un film réalisé à partir de pellicule grattée avec une classe

Fred Soupa évoque sa collaboration avec une classe de 4eme du collège Victor Hugo à Noisy-le-Grand (93). Il ne se positionne pas d’emblée dans le champ du cinéma expérimental mais plutôt dans celui de l’expérimentation, souvent le résultat d’une adaptation à une situation particulière. « Le temps manque souvent, il faut adapter le matériel à cette réalité, ce qui donne des outils singuliers, pas du tout technologiques ! » Le projet Je(u) 100 frontières a permis de décliner les notions de « frontière » de manière thématique et formelle, en rencontrant des professionnels de plusieurs domaines artistiques (musique, cinéma, danse) et en déclinant cette thématique dans différentes matières scolaires.
Emilie Morin et Laetitia Foligné travaillent pour Comptoir du doc, association basée à Rennes qui œuvre au développement et à la diffusion du cinéma documentaire. Depuis cinq ans, Comptoir du doc s’installe entre Maurepas et la Bellangerais pour y construire le projet Des histoires : une programmation de films documentaires conçue avec des habitants et des adhérents de Comptoir du doc, des ateliers de création, un stage proposé à des jeunes de 16 à 25 ans, des temps de rencontres et de sensibilisation au cinéma documentaire. Lors de la dernière édition, a été montée une exposition de photos, de vidéos et de créations sonores dédiées à Maurepas et ses habitants. Le projet a été développé sur plusieurs mois avec des jeunes adultes et des habitants du quartier formés à la photographie et au développement avec une boite noire fabriquée dans une canette de coca. Dans un second temps, ils ont fabriqué un sténopé géant dans lequel les jeunes pouvaient entrer. Parallèlement, les participants ont visionné des films qu’ils ont ensuite présentés au public.
En savoir + :
Le Comptoir du doc
Le projet Des histoires
Paula Ortiz a quant à elle travaillé avec des élèves du collège Jean-Baptiste Clément de Dugny à partir d’un texte d’Italo Calvino, « Les villes et les signes », extrait de l’ouvrage Les villes invisibles dans lequel un voyageur parvient à lire les signes de la ville, qui parlent d’elle et de ses habitants. Elle a mis ce texte en regard des symphonies urbaines, films typiques des avant-gardes des années vingt et trente, qui décrivent de façon visuelle et poétique l’activité d’une ville et dont l’une des œuvres emblématiques est Berlin symphonie d’une grande ville (1927) du cinéaste allemand Walter Ruttmann. La forme de ces symphonies visuelles offre une approche très libre qui permet de débuter une aventure sans savoir où on va arriver (un peu comme dans le documentaire). À Dugny, les signes présents dans la ville étaient essentiellement institutionnels, mercantiles, mais aussi des signes sauvages. C’est le décalage entre tous ces signes qui a fait l’objet d’un travail lors de l’atelier.
Extrait de Berlin symphonie d’une grande ville

© Berlin symphonie d’une grande ville (1927) de Walter Ruttmann
Projection du film réalisé lors de l’atelier Symphonie de Dugny

© Symphonie de Dugny réalisé avec les élèves du collège Jean-Baptiste Clément de Dugny
- Après la présentation de chacun des ateliers, Anne-Sophie Lepicard interroge les invités de la table ronde sur la façon dont ces objets protéiformes, singuliers en termes d’écriture et pas toujours achevés, se construisent avec les enseignants et les élèves.
Sébastien Ronceray explique que la réalisation de films sans caméra est une activité que l’on peut mener en intérieur et qu’elle est tout à fait envisageable dans une salle de classe. Au cours de ce type d’atelier chacun participe individuellement à une œuvre collective en dessinant directement sur de la pellicule. Il n’est pas question ici de représentation si ce n’est éventuellement à travers le dessin qui peut être figuratif ou non. Les participants sont amenés à travailler avant tout les questions de rythme et le montage est réalisé à la main dans une approche très tactile où l’on expérimente le fait d’assembler des éléments ensemble. En raison des supports et du matériel utilisé, il est impossible de voir immédiatement le produit fini. L’attente est un processus important de la pédagogie de la création des films. C’est au moment de la projection que l’on découvre le résultat et cela oblige les participants à réfléchir à leur création dans le cadre d’un dispositif de projection et d’agrandissement de l’image.
Emilie Morin et Laetitia Foligné remarquent que les jeunes participants étaient très surpris par le sténopé géant dont il a fallu monter la structure. Pour eux il était étonnant de passer une demi-journée à faire une photo sans avoir la possibilité de la voir immédiatement. Il faut effectuer plusieurs tests pour avoir une idée précise du temps d’exposition nécessaire. D’un point de vue pédagogique, cette temporalité est très intéressante. Aucun des participants n’avait jamais pris en main d’appareil photo argentique, encore moins fait des photos d’un mètre carré réalisées avec du papier qui ne doit pas voir la lumière avant d’être développé ! Le processus est très long (et collectif) pour passer de l’image négative à l’image positive. La version du sténopé fabriqué dans une canette est beaucoup plus légère et plus immédiate pour provoquer la curiosité et la discussion. Ces outils très simples permettent de développer soi-même ses photos et la magie l’emporte sur l’attente.
- Anne-Sophie Lepicard s’enquiert de la réception de ces images très singulières.
Le sténopé fabriqué à partir d’une canette produit un effet fish-eye et l’image est parfaitement nette. Le sténopé géant est doté d’une lentille et il suffit d’entrer dans l’appareil pour voir à l’œil nu comment la netteté se fait (ou pas) dans l’image. A l’inverse de la canette, il n’y a pas de déformation. Le plus impressionnant reste de voir l’image se refléter sur soi quand on est à l’intérieur du sténopé.
Dans le cas de l’atelier mené par Paula Ortiz les jeunes ne se représentaient pas bien à quoi le projet allait ressembler (elle non plus d’ailleurs !). Les confronter à ce qu’ils pensaient de leur ville était une question compliquée car ils n’en étaient pas très fiers. Leur propre rapport à la consommation leur laissait penser que la rue principale de Dugny n’était a priori pas très intéressante : « On ne va pas montrer ça, c’est nul ». Ils avaient une image d’eux-mêmes négative avec un rapport au corps compliqué (les coiffures ont pu être filmées mais pas leurs visages). Au final, ils sont malgré tout parvenus à éprouver une vraie fierté pour les lieux qu’ils habitent.
Pour le tournage, Paula Ortiz a constitué deux équipes image et une équipe son. Les enseignantes aussi se sont inscrites dans un processus d’apprentissage. Les phases d’écriture se sont avérées plus compliqués : il était difficile pour les élèves d’exprimer des ressentis par rapport aux images qui ne relèvent pas de simples descriptions. Un détour par Georges Perec et son ouvrage Espèces d’espaces et son approche très ludique de la ville a simplifié les choses et permis aux élèves de laisser de côté leur vision très négative de Dugny. Enfin, le travail avec un sound designer sur la voix off a permis de créer une vraie composition sonore.
- La posture de l’enseignant qui accepte d’être aussi en apprentissage, à égalité avec les élèves participe-t-elle au succès du projet ?
C’est évident pour Paula Ortiz qui se présente aussi elle-même en posture d’« apprentissage » de la ville de Dugny. Fred Soupa explique quant à lui qu’il fallait trouver la thématique la plus large possible « pour faire entrer un maximum de choses ». La « frontière » est un thème très à la mode, un peu « tarte à la crème », mais qui a aussi l’avantage d’être une proposition très large. Les premiers partenaires avec lesquels Fred Soupa a travaillé autour de la notion de frontière étaient des enseignants d’un centre d’accueil pour mineurs isolés situé dans le Val-d’Oise avec des pratiques plus libres que dans l’Éducation nationale. Les jeunes sont partis de leur propre approche de la question des frontières. Au collège, des professeurs d’anglais, de SVT, de musique, d’histoire-géographie étaient partie prenante au départ, mais quelques-uns n’ont pas suivi le projet dans son intégralité. Dans ce cas, le sujet des frontières a été envisagé selon des acceptions liées à des disciplines précises : les frontières dans la musique, celles entre le vivant/le mort en SVT, etc. Ces acceptions étaient très ouvertes, peut-être trop.
Questions
- La responsable des dispositifs scolaires d’Atmosphère 53 pose la question de la réception des ateliers, notamment par les professeurs. En Mayenne, elle a tenté de proposer un atelier de grattage de pellicule qui s’est avéré très difficile à mettre en place dans des établissements scolaires.
Anne-Sophie Lepicard rappelle qu’en effet la posture de l’enseignant reste la pierre angulaire des projets.
Sébastien Ronceray ne rencontre pas ces difficultés au sein de Braquage. L’association a la chance d’être sollicitée par des enseignants qui ont envie de proposer ces ateliers à leurs élèves et qui disent pourquoi : ils sont ludiques pour les petits et apportent des connaissances en histoire des arts aux plus grands. Pour les adolescents, c’est un peu plus compliqué. Il est toujours intéressant de savoir ce que les professeurs pensent des propositions. Sébastien Ronceray ajoute qu’il s’autorise aussi à dire non s’il sent que cela ne va pas fonctionner avec le projet général proposé par Braquage.
Les enseignants apprennent avec les élèves et cela les implique dans le projet. Tous découvrent quelque chose de différent par rapport à leurs pratiques du cinéma et de spectateur. Ils ont l’occasion de se poser des questions sur les outils, sur les technologies : à quoi servent-ils, que nous racontent-ils du monde, en quoi celui-ci se transforme-t-il et en quoi sommes-nous liés à ces transformations ? Il y a une histoire des images dans laquelle s’inscrivent les différentes pratiques et formes.
- Une éducatrice de jeunes enfants dans une crèche départementale demande comment approcher le cinéma expérimental avec les tout petits.
Cinémas 93 monte des projets de résidences dans les crèches, précise Sébastien Ronceray. On peut par exemple envisager un travail sur les ombres (placer les doudous devant une machine qui projette des ombres), sur la couleur (avec la projection de plaques de lanterne magique, avec ou sans commentaires). On peut projeter des extraits de films avec des projecteurs de cinéma, un peu de cinéma d’animation, en animant les enfants eux-mêmes… Mais tout cela ne peut se faire qu’en étant à l’écoute du personnel des crèches et en utilisant des éléments de l’univers des enfants. Il est important de ménager des temps de formation du personnel des crèches mais c’est difficile car ces personnes travaillent beaucoup !
- Dans la genèse du projet, comment articuler les attentes des professeurs et des institutions et les propres envies des porteurs de projet ?
Les projets que Fred Soupa a menés en lien avec Cinémas 93 sont le fruit d’échanges entre plusieurs partenaires. Cinémas 93 connaît les enseignants et leurs envies, puis des rencontres se font entre des préoccupations pédagogiques et des propositions artistiques. « Je défends des choses et il arrive que la rencontre ne se produise pas, parce que notre rapport au monde, à la création, n’est pas le même. J’essaye toutefois de rester très ouvert tout en défendant ce vers quoi j’ai envie d’aller » explique-t-il. « A nous d’avoir des positions claires mais souples. »
Paula Ortiz insiste sur son envie de partager un univers avec des élèves : « Je n’ai jamais senti le poids de l’institution. Ce qui est important c’est qu’il s’agit d’un échange. Et puis il faut accepter que les réactions ne soient pas aussi extraordinaires qu’on le souhaiterait… »

- En tant qu’intervenant, lorsqu’on mène un projet, quelle place donne-t-on aux enfants ? On observe souvent des propositions, des performances qui sont davantage celles des adultes.
Pour Emilie Morin et Laetitia Foligné, c’est une question qui se pose à chaque nouveau projet et la place des intervenants est à chaque fois à réinventer : « on apporte un cadre mais après c’est le projet des jeunes ; on est là pour les accompagner, les aider à aller plus loin. » La question du temps dont on dispose change tout. Avec le projet conçu pour « Des histoires », un petit collectif d’habitants s’est formé et, bien que la place où le sténopé avait été placé ait été détruite, le labo n’est plus temporaire et sert toujours. Mais cette implication se défend en dehors de tout budget alloué par les institutions. A Comptoir du doc, peu de projets sont finalement menés avec des enseignants mais ils le sont le mieux possible.
- Anne-Sophie Lepicard demande qui sont les producteurs des images ?
Dans le cas des ateliers menés pour Des histoires par Comptoir du doc, le sténopé canette a donné lieu à une exposition photo au festival. En parallèle, le groupe de jeunes mobilisés et partenaires du projet ont vu les films programmés pendant le festival et choisi les séances qu’ils allaient animer. Ils ne se sont pas contentés de faire des photos, ils ont participé à une semaine complète de préparatifs d’un événement qui a eu lieu deux mois plus tard.
Fred Soupa explique qu’il intervient sur des temps généralement courts. Les enseignants peuvent de leur côté gérer des temps qui nourriront l’atelier. Tout dépend de la façon dont ils s’emparent du projet. Finalement, en tant qu’intervenant, on ne maîtrise pas tout. Il faut aussi savoir qu’un travail collectif amène des niveaux d’implication très différents. Le montage est souvent effectué rapidement par l’intervenant à la fin du projet, en heures supplémentaires et sans les élèves. On est toujours tributaires de l’obligation de la restitution qui oblige à fournir un résultat même s’il n’est pas bon et l’intervenant passe souvent beaucoup plus de temps sur le projet que ce qui était prévu au départ.
Sébastien Ronceray considère pour sa part que l’expérience est suffisamment riche pour ne pas attacher trop d’importance au résultat final. Le montage se fait avec les élèves et c’est leurs gestes qui importent.
Démonstration de grattage de pellicule par Sébastien Ronceray
On prend une pellicule opaque (de la pellicule noircie ou de la pellicule son qui est une matière magnétique) dont on gratte le côté mat (avec les plus petits, on utilise des trombones). On peut travailler sur la longueur de la pellicule et pas uniquement photogramme par photogramme.
Sur de la pellicule transparente, il faut utiliser une réglette numérotée. Les bords de la pellicule ne se verront pas à la projection car ils sont réservés aux perforations et à la piste son. Il est possible de colorier les deux côtés de la pellicule, de jouer avec les couleurs (si on alterne le rouge et jaune, on verra de l’orange à la projection).
En guise de table lumineuse, Sébastien Ronceray utilise une boîte de VHS éclairée par une lampe de poche.
Paula Ortiz a souhaité présenter aux élèves des extraits de L’Homme à la Caméra (1929) de Dziga Vertov , de Mur, murs d’Agnès Varda (1982) et surtout l’intégralité de Lisboa Orchestra de Guillaume Delaperriere (2012) afin de leur montrer comment un film sur la ville peut être très rythmé grâce à un travail de montage et de son.
Collectifs et autres démarches de cinéma participatives
COLLECTIFS ET CINÉMA, HISTOIRE ET PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES
Conférence par Gabriel Bortzmeyer, historien du cinéma, enseignant-chercheur et critique de cinéma (Débordements, Trafic, Vacarme…).

Que le cinéma soit un art collectif n’échappe à personne. Mais il y a plusieurs façons d’entendre le mot : comme art « managé », qui coordonne et hiérarchise les talents et les techniques ; comme art collectivisé, qui agglomère les désirs et les énergies en redistribuant les fonctions. L’intervention soulèvera quelques questions autour de cette communauté : pourquoi s’associer, comment s’organiser, à quelles fins s’effacer dans une signature de groupe et, enfin, que faire pour lutter en travaillant autrement ?
Gabriel Bortzmeyer propose d’aborder les collectifs de cinéma à travers une réflexion plus générale sur les groupes qui portent une autre idée d’un travail traditionnellement très hiérarchisé et compartimenté. Un travail à redéfinir à travers l’expérience du collectif. Ces groupes d’hier et d’aujourd’hui sont composés de cinéastes confirmés, d’amateurs, de militants, de techniciens, de quidams : tous ont pour point commun de se réunir pour remettre en cause les hiérarchies et pour redistribuer les rôles. L’histoire des collectifs est celle des rassemblements et des mises en partage pour s’émanciper des corporations, s’éloigner des modes majoritaires de diffusion.
Gabriel Bortzmeyer articule son intervention autour de deux questionnements principaux :
1/ Comment les collectifs ont-ils interrogé un certain rapport au travail pour en faire autre chose que ce qu’il est (étymologiquement un instrument de torture) ? L’horizon serait de parvenir à un travail dans la joie.
2/ Comment penser une forme de communauté qui s’émancipe des structures traditionnelles ?
À chaque fois il s’agit de penser la transmission autrement que sous la forme d’une relation de maître à élève et de faire des films d’une manière qui rompe avec le modèle expert/technicien.
L’approche de Gabriel Bortzmeyer se situe à mi-chemin entre l’histoire et l’anatomie. Elle consiste à lister des noms, à cartographier des gestes, à comprendre des luttes. L’objectif est de comprendre quels types d’expériences correspondent à l’idée de collectif. Au-delà de la simple réalisation des films, les collectifs proposent des méthodes de travail, des expérimentations en groupe qui transcendent la simple question du produit fini : le processus compte autant que le résultat.
Les débuts du film collectif
La plupart des collectifs émergent à la fin des années soixante, entre 1967 et 1975 pour être précis.
Les groupes Medvedkine
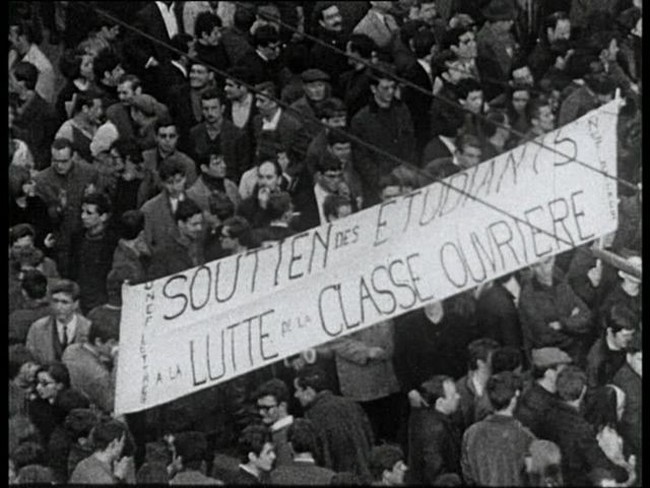
© À bientôt j’espère (1967)
Ils se constituent à Besançon en 1967 à l’occasion d’une grève dans une usine de montres filmée par Chris Marker dans À bientôt j’espère. C’est ce film qui a déclenché la constitution du collectif. Des débats sont lancés à l’issue de la projection : des ouvriers critiquent le film qui verse dans un romantisme pas tout à fait en phase avec leur lutte. Chris Marker leur rétorque : « le film que vous voudriez voir, il n’y a que vous qui puissiez le faire ». Ce sera Classe de luttes en 1969. En tout quatorze films sont réalisés par les groupes de Besançon et de Sochaux. Ils ont été édités en DVD par les éditions Montparnasse en 2006.
Écouter les débats enregistrés à l’issue de la projection en 1967
Parmi la quarantaine de membres des groupes Medvedkine : Chris Marker, Pol Cèbe, Bruno Muel, Antoine Bonfanti, Mario Marret, Pierre Lhomme.
Parmi les quatorze films : A bientôt j’espère (1967), Classe de lutte (1969), Week-end à Sochaux (1971-1972), Avec le sang des autres (1975)…
Voir un extrait de Classe de lutte
Le Groupe Zanzibar

© Détruisez-vous (1968)
Ce groupe voit le jour juste avant mai 1968. Détruisez-vous, qui porte sur l’université française et la société de consommation, est tourné à Nanterre et dans des bidonvilles. Le groupe Zanzibar a une origine sociale différente des groupes Medvedkine. Il s’agit de jeunes bohèmes héritiers des groupes d’avant-garde des années précédentes et le groupe s’écarte des collectifs de l’époque par son approche anarchiste dandy plutôt qu’au service de la lutte prolétarienne. Il est financé sous forme de mécénat par Sylvina Boissonnas et, surtout, les films sont signés individuellement et non collectivement. Quatorze films sont tournés en un an, mais le Groupe Zanzibar restera le groupe le plus éphémère, dissout en 1973, de fait sans activité depuis 1969. Néanmoins, il aura affirmé son désir de remettre en cause les divisions traditionnelles du travail.
Voir un extrait de Détruisez-vous
Le Groupe Zanzibar compte notamment : Philippe Garrel, Jackie Raynal, Pierre Clémenti, Serge Bard, Alain Jouffroy et Sylvina Boissonnas comme mécène.
Parmi les films : Détruisez-vous (Serge Bard, 1968), Le Révélateur (Garrel, 1968), Acéphale (Patrick Deval, 1969).
Le Groupe Dziga Vertov, 1969-1973

© Vent d’est (1969)
Il se forme autour de Jean-Luc Godard (et Jean-Pierre Gorin) dans un désir d’effacement de la figure individuelle. Il agit comme une sorte de thérapie de Godard contre lui-même même si un certain nombre de financements ont été obtenus grâce à son nom. Le groupe est créé en 1969 pendant la réalisation de Vent d’est avec Daniel Cohn Bendit. Il compte seulement six membres dont on retient essentiellement le duo Godard-Gorin. On y parle beaucoup de prolétariat et de lutte révolutionnaire, mais jamais ils ne sont mis en scène à l’écran. Il s’agit de dynamiter les codes de la représentation dans une approche très cérébrale du cinéma et avec des films qui réfléchissent sur la grammaire audiovisuelle de l’époque.
Noyau : Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin.
Membres fluctuants : Antoine Bonfanti, Armand Marco, Paul Bourro, Gérard Martin (et quelques collaborateurs encore plus occasionnels).
Films : British Sound (1969), Pvrada (1969), tous deux inscrits a posteriori dans le catalogue du groupe, Le Vent d’est (1970), Luttes en Italie (1971), Vladimir et Rosa (1971), Tout va bien (1972), Letter to Jane (1972).
Le Groupe Cinélutte

© A pas lentes (1977)
Il est constitué en 1973 en accompagnement de grèves et de mobilisations : soutien des sans papiers à Marseille, des Lipp, de la grève des prostituées à Lyon, dénonciation du comité Giscard (groupe de soutien à Giscard d’Estaing en 1974). Il est dissout en 1981 après sept longs métrages.
Cinélutte compte notamment : Mireille Abramovici, Jean-Denis Bonan, Richard Copans, François Dupeyron, Alain Nahum et Guy-Patrick Sainderichin.
Entre autres films : Bonne chance la France (1975), comptant trois moyens-métrages (L’Autre façon d’être une banque, Comité Giscard, Un simple exemple), A pas lentes (1977).
Quelques noms parmi les autres collectifs actifs à cette période :
- Cinéthique (Jean-Paul Fargier, Gérard Leblanc)
- Union de Production Cinéma Bretagne (où se trouve René Vautier)
- Unicité / Dynadia
- Le Grain de sable
Au Japon, on peut noter le Groupe Ogawa, piloté par une sorte de gourou charismatique de 1968 à 1992 qui a produit des documentaires autour de la lutte contre l’aéroport de Narita.
D’un groupe à l’autre : points communs et affinités
On note de nombreuses différences entre ces collectifs, qui vont du cinéma direct des groupes Medvedkine ou du groupe Cinélutte à l’approche beaucoup plus expérimentale des groupes Dziga Vertov et Zanzibar. Une des grandes lignes de partage se situe entre ceux qui font l’économie d’une tête d’affiche et les autres. Certains interdisent toute signature, d’autres pas. L’organisation au sein des collectifs est aussi très variable avec la question du partage ou non des tâches.
On peut questionner l’affinité entre l’histoire des collectifs et celle de la gauche. Il existe une alliance historique entre le militantisme et le cinéma de groupe, ne serait-ce qu’à travers le terme même de collectif.
On peut aussi interroger la parenté entre la forme du collectif et des formes qui fonctionnent sur des principes similaires : le groupuscule (qui est un rapprochement sur le plan organisationnel), la coopérative (avec la mise en commun des moyens de production), le mouvement d’avant-garde (avec de nombreuses analogies comme le désir d’expérimentation formelle et la création collective autour d’un projet esthétique partagé).
Flash-back : les précurseurs

© La Commune (1914)
Il faut aussi inscrire ces groupes dans une histoire qui a débuté avant la fin des années 60. Des collectifs ont en effet existé auparavant dans l’histoire du cinéma sous forme de regroupements :
- Cinéma du peuple autour d’Armand Guerra qui a tourné un film sur la commune de Paris en 1914 .
- Les ciné-trains d’Alexandre Medvedkine dans les années 30 en URSS.
- Les œuvres de la Workers Film and Photo League et de la Frontier Film group aux Etats-Unis dans les années 30.
- Les films collectifs dont plusieurs cinéastes réalisent chacun un volet, comme La vie est à nous tourné à l’initiative du Parti communiste français pour la campagne électorale du Front populaire ; une forme qui a explosé dans les années soixante avec des films comme Loin du Vietnam.
Les Collectifs de diffusion

©Loin du Vietnam (1967)
Voir la bande annonce de Loin du Vietnam
- Avec Loin du Vietnam, supervisé par Chris Marker et dont les séquences sont coréalisées par Joris Ivens, Claude Lelouch, Alain Resnais, Agnès Varda, Jean-Luc Godard et William Klein, naît la coopérative SLON (Service de Lancement des Œuvres Nouvelles, « éléphant » en russe), créée pour produire le film. SLON deviendra Iskra en 1974.
- Le Collectif jeune cinéma, créé sur le modèle de Filmmakers, coopérative de Jonas Mekas à New York, est une association qui a pour buts la distribution et la diffusion des pratiques cinématographiques expérimentales dans les arts visuels (cinéma, vidéo). Cofondée en 1971 par des cinéastes et critiques de cinéma expérimental, elle est la première coopérative de cinéastes à voir le jour en France, proche des coopératives d’artistes apparues peu de temps avant.
Collectif de moyens de production
- L’Abominable, laboratoire cinématographique pelliculaire partagé. Les films issus de L’Abominable sont souvent distribués par les coopératives du cinéma expérimental telles que Light Cone ou le Collectif Jeune Cinéma. Certaines œuvres, en particulier les performances et les installations, sont distribuées par les artistes eux-mêmes.
En savoir + :
Light Cone
Collectif jeune Cinéma
Collectifs vidéo

© Le collectif Mohamed
Les collectifs vidéo ont permis d’autres expressions comme les luttes féministes ou celles des groupes de banlieue. Ils ont effectué un travail à la marge, éloigné d’un certain patriarcat technicien. À l’instar de Carole Roussopoulos, les femmes ont investi la technique vidéo qui avait été délaissée par les hommes. Le filmage très souple et le mode de diffusion indépendant des dispositifs des salles ont permis à des personnes extérieures au cinéma de produire leurs propres images.
- Le collectif de diffusion Mon œil comprenant les quatre collectifs Video 00, Les Cents Fleurs, Vidéa et Les Insoumuses, très actives dans les luttes féministes.
- Le collectif Mohamed, actif entre 1977 et 1981, a produit des films comme Le Garage, Zone immigrée et Ils ont tué Kader.
Le séminaire Vidéo des premiers temps porté par le LABEX ARTS-H2H avec la BnF, le laboratoire ESTCA (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), l’IRCAV (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) et l’Association Carole Roussopoulos est une référence en la matière. Son site est très riche sur ce sujet alors que ces films produits sont très rarement diffusés : earlyvideo.hypotheses.org.
En savoir + :
BnF
ESTCA
IRCAV
Association Carole Roussopoulos
Aujourd’hui : un nouveau mouvement
On observe aujourd’hui une ligne de partage entre :
- des groupes traditionnels, héritiers de certaines méthodes de production et de travail, dont certains reviennent à des formats antérieurs au numérique,
- et des collectifs qui se posent moins la question de la production que celle de la circulation des images en-dehors des canaux télévisuels, du format de long métrage, soit un « journalisme citoyen » qui refuse de se présenter comme militant.

© Salaud d’argent (2016)
Parmi les groupes traditionnels, on trouve :
- Le groupe Boris Barnet (cinéaste soviétique) créé en 2004 en coordination avec des intermittents précaires (Salaud d’argent est une recherche sur la précarité produit en collaboration avec L’Abominable).
- Le collectif Synaps [développe et soutient des projets cinématographiques et audiovisuels ambitieux et originaux qui ne trouvent pas leur place dans les grands réseaux de production et de diffusion existants], le collectif Tribudom (plus institutionnel) [œuvre depuis 2002 dans les quartiers dits « sensibles » du Nord Est parisien et de la petite couronne en utilisant le cinéma comme un outil d’éducation au regard], Les Scotcheuses [voir présentation plus bas], le collectif COMET [voir présentation plus bas]…
S’agissant de « journalisme citoyen », on peut citer :
- Abounaddara est une société́ de production audiovisuelle indépendante basée à Damas en Syrie. Elle est spécialisée dans le documentaire de création qu’elle diffuse sur de nombreuses plateformes à travers le monde. Ce collectif anonyme de cinéastes autodidactes est très impliqué dans le cinema d’urgence et poste chaque vendredi sur Internet un court métrage d’une à cinq minutes qui porte un message complexe, ouvert.
- Mosireen a œuvré entre 2011 et 2014 en Egypte dans le but de documenter la Révolution Egyptienne à travers, notamment, la production d’images par le peuple en lutte plutôt que par des acteurs extérieurs. Le site https://858.ma propose un catalogue de vidéos brutes de la révolution et a également une chaîne youtube.
- Le collectif Les Yeux de Marianne s’est constitué pour rendre compte régulièrement du mouvement Nuit debout, de son organisation, des actions et des réflexions qui s’y développent.
- Le site d’infos Taranis news est apparu au moment du sommet de l’OTAN à Strasbourg en 2009 et a acquis une certaine notoriété lors du mouvement contre la loi Travail. Il a aujourd’hui le statut d’agence de presse et fait l’objet de certaines critiques pour ça.
Ces différents exemples révèlent une mutation dans la forme des collectifs : alors que les premiers collectifs évoqués étaient une stricte antithèse des corporations, il semble qu’à l’âge de la précarité universelle, on assiste à une rencontre entre les formes de travail contemporaines et le collectif.
Conclusion
Pour terminer sa conférence, Gabriel Bortzmeyer liste une série de questions que se sont posé tous les collectifs. Elles sont d’ordre :
- économique : comment garantir l’autonomie de la réalisation avec peu de moyens ? Quelles implications sur le plan esthétique ?
- technique et pédagogique : comment briser la hiérarchie professionnelle, comment se former et former les autres ?
- éthique : comment sortir d’un certain égocentrisme esthétique, inventer une signature qui soit celle d’un groupe ? Comment repenser la responsabilité de l’œuvre d’art et sortir d’un cadre individualiste ?
Enfin, comment trouver une forme d’expérience qui transcende le film ?
Conseils de lecture
Cinéma d’aujourd’hui (numéro spécial de 1976 sur Le Cinéma militant sous la direction de Guy Hennebelle) dénombre tous les collectifs de l’époque (vingt-trois en tout), dont l’unité René Vautier qui a organisé les premiers groupes sur le cinéma algérien, sur la décolonisation…
On pourra également consulter les travaux de Federico Rossin (programmateur et critique), d’Hélène Fleckinger (universitaire, spécialiste de la vidéo dans les années soixante-dix) et de Catherine Roudé (universitaire, autrice d’une thèse sur Slon-Iskra et les collectifs ayant gravité autour). La revue Vacarme relate de nombreuses expériences de collectifs.
Il existe une carence éditoriale en matière d’édition de textes et de DVD qui s’explique par le fait que la cinéphilie officielle est avide d’auteurs identifiables et remarquables.
DÉMARCHES ORIGINALES DE CRÉATION À PLUSIEURS
Avec Maxime Martinot et Benjamin Hameury, réalisateurs et membres du Collectif COMET, Le Collectif Les Scotcheuses et Olivier Bosson, réalisateur de Tropique, Le Forum des rêves et Dents de scie.
Après-midi animée par Louis Séguin, réalisateur et critique de cinéma aux Cahiers du cinéma.

Qu’est-ce qui pousse à créer de manière collective ? Circulation des idées et des savoirs, croyance dans la complémentarité des individus et de leurs talents créatifs, urgence à rendre compte ensemble d’une réalité sociale, invention de modèles alternatifs de production… Plusieurs cinéastes, qui profitent souvent de la souplesse de production offerte par les outils numériques, viennent parler de leurs démarches de création.
Louis Séguin introduit la table ronde en rappelant que, si le cinéma est intrinsèquement un art collectif, la notion de collectif désigne une façon de travailler ensemble et de produire des films, voire une expérience et un modèle de vie en communauté dont on retrouve une trace dans les films.
Les Scotcheuses se présente comme un collectif fondé autour d’une pratique du cinéma en super-8 qui s’intéresse aux lieux de lutte avec des personnes en lutte. Elles revendiquent une façon de faire des films « à l’horizontale ». Leur premier film, Le bal des absent.es (2013), a été tourné dans les Landes lors d’une fête des morts. D’autres films ont suivi, réalisés dans le Tarn et dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Le Collectif COMET est quant à lui né de la classe préparatoire Cinésup à Nantes. Le profil des membres est donc plus sélectif. Au départ, explique Maxime Martinot, l’objectif était de faire des films qui ne pouvaient pas être réalisés dans le cadre de la prépa : il ne s’agissait pas de constituer un collectif mais plutôt de réunir des affinités, des amitiés, pour concrétiser des projets. L’initiative a ensuite évolué vers l’envie de créer une structure de production pour faire des films plus ambitieux. Tous les films ont impliqué un nombre très important de participants, notamment pour permettre leur financement, et le projet a pris une ampleur difficile à contrôler. Louis Séguin fait remarquer la polyvalence des membres du collectif COMET : on retrouve les mêmes noms d’un générique à l’autre mais à des postes différents.
Olivier Bosson a pour sa part, réalisé des films avec des castings très importants, réunissant plusieurs centaines de personnes, toutes retenues pour le projet final. Ses films de fiction ont la particularité de réunir de nombreux acteurs pour interpréter peu de personnages principaux et donnent à voir des logiques sociales.
Extrait de Tropique d’Olivier Bosson (2015)

© Tropique d’Olivier Bosson (2015)
Regarder la bande-annonce de Tropique
La narration de Tropique fonctionne selon un système d’enchâssement, de poupées russes : le film met en scène des gens qui se fabriquent leurs propres histoires.
Extrait du making of de L’Arche russe d’Alexandre Sokourov

© L’Arche russe d’Alexandre Sokourov
Benjamin Hameury revient sur cet extrait où l’on découvre ce qui se passe après la prise du plan-séquence qui constitue le long métrage de Sokourov. C’est un exemple assez fascinant de ce que peut être le collectif au cinéma. Il faut parvenir à créer son propre langage et, avant cela, ses propres règles du jeu, à l’opposé d’une sorte de tyrannie auteuriste contre laquelle les collectifs se positionnent.
Le DVD des 4 films des Scotcheuses contient l’enregistrement d’une discussion très instructive pour appréhender leur façon de travailler. Les décisions sont prises lors de discussions collectives, avec les personnes présentes à ce moment-là, et elles concernent toutes les étapes de l’écriture à la projection en passant par le tournage, le montage… Il n’y a pas trop de disparités entre les savoir-faire, avec l’envie de la part de ceux qui savent de transmettre et l’envie de ceux qui ne savent pas d’apprendre. Cette notion de partage se déploie dans tous les domaines, y compris la cuisine : « On se fait la bouffe, on répare des toitures et on fait des films ! » Faire ensemble en autogestion prend évidemment du temps mais c’est un choix assumé qui implique une certaine logistique. Et si les membres du collectif ne vivent pas ensemble (ils habitent dans différentes régions de France), ils se retrouvent régulièrement.
Leur prochain film sera tourné dans la Meuse, sur le site d’enfouissement de déchets nucléaires de Bure. Le collectif crée des synergies sur le territoire. Par exemple, ses membres ont effectué des travaux chez l’habitant. Il faut penser toute une organisation au quotidien.
Selon Maxime Martinot, on ne peut pas dissocier la question du collectif et celle du/des lieu(x). Il apprécie beaucoup la façon dont les Scotcheuses laissent leur marque dans les lieux où elles travaillent. A ses yeux, il est important d’« apprendre à désapprendre » notre rapport au savoir et à la technique. Dans le cinéma collectif, on constate beaucoup d’apports en nature et en moyens de production. Cela passe souvent par les circuits étudiants. Le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes de Paris 8 permet par exemple le financement de projets culturels hors projets scolaires.
Olivier Bosson précise qu’il existe effectivement toutes sortes de financement, notamment dans le champ de l’art contemporain et de l’action culturelle. Lorsque Tropique a reçu l’Aide au film court du Département de la Seine-Saint-Denis coordonnée par Cinémas 93, il s’agissait du premier financement relevant véritablement du secteur cinématographique
Extrait de 200 % d’Olivier Bosson

©200 % d’Olivier Bosson
Olivier Bosson revient sur ses méthodes de travail lors d’un tournage. En premier lieu, il organise des castings où tout le monde est accepté, l’envie de jouer suffit pour être retenu. Les castings traditionnels fonctionnent selon des principes de sélection qu’il récuse. Il considère la fiction comme une possibilité d’accéder à une zone de liberté et c’est dans cette perspective qu’il considère que tous les personnages sont producteurs de « petites choses culturelles » qu’il va intégrer dans ses films. Ça l’intéresse de montrer comment les gens fabriquent eux-mêmes de la culture, en inventant par exemple des pas de danse ou toute autre petite création personnelle. Le film devient alors un miroir de nos pratiques sociales.
Extrait du film Les voisins de Benjamin Hameury

© Les voisins de Benjamin Hameury
Regarder un extrait du film Les voisins
Benjamin Hameury a grandi dans le quartier que l’on voit dans le film. Il s’est interrogé sur la façon de rassembler les gens du quartier en faisant un film, en racontant une histoire. Sa rencontre avec chacun de ses voisins lui a inspiré des personnages et le film a été écrit avec eux. La pratique du cinéma est ainsi à l’origine de moments de vie collectifs : « je trouve cela très beau qu’un film puisse être prétexte à la rencontre, à un idéal de vie commun. » Louis Séguin fait remarquer que le collectif est aussi à l’écran : le personnage principal du film, c’est la communauté, ce qui va à rebours d’une forme de narration individualiste.
Dans No ouestern réalisé par les Scotcheuses, les moments de figuration sont de grands moments de fête, mais ce ne sont pas pour autant les grands moments de rencontre, de plaisir, de partage, qu’elles espéraient au départ. « Ça pose aussi les limites de l’esthétique collective ». Il faut savoir « vivre les choses comme le collectif les définit ».
La diffusion des films
Louis Séguin aborde la question de la diffusion des films et interroge les participants sur la possibilité d’inventer là aussi autre chose.
Olivier Bosson a créé de nombreuses sortes d’objets filmiques avec des significations-fonctions variées, des projets qui s’inscrivent pleinement dans la logique du numérique. C’est le cas du Forum des rêves, une série composée de 10 épisodes de 20 minutes dans laquelle les protagonistes peuvent enregistrer leurs rêves sur leur téléphone portable et les partager sur une plateforme internet en forme de « forum de discussion vidéo ». Elle a été réalisée lors d’une succession de tournages internationaux (en France, à Cuba, au Maroc, au Canada, en Belgique, au Luxembourg… ) avec 200 acteurs et des dizaines de figurants pour jouer les dreameurs et les contributeurs du Forum. La série a été diffusée sur internet et fait l’objet d’un faux site , « La plateforme des dreameurs », qui réunit toutes les vidéos du film sous forme de 10 topics. Olivier Bosson fait par ailleurs remarquer que l’édition de films en DVD est formidable car cela permet d’offrir des objets. Il faut penser les perspectives de diffusion des films selon différentes dimensions.
En savoir + :
Le Forum des rêves
La projection de No ouestern des Scotcheuses a été le fruit d’un processus qui a duré un an. Elle a eu lieu en présence de 200 personnes dans une grange qui venait d’être occupée, sur des bottes de paille, avec des frites préparées avec les pommes de terre plantées pour les besoins du film. La projection en super 8 est fragile, le film super 8 lui-même est fragile. Cela crée une émotion particulière. « On aime créer des moments, inventer des stratagèmes pour diffuser nos films en dehors des circuits ». Dans la Meuse, cadre de leur prochain film, il est déjà prévu de faire la tournée des villages. Pour s’affranchir des circuits classiques, les Scotcheuses ont constitué avec d’autres collectifs (parmi lesquels Synaps) un kit de projection mobile utilisable pour toute projection non commerciale. Ces inventions « entre gens qui galèrent » leur permettent une véritable autonomie.
Un membre du collectif Synaps revient sur la question de la diffusion. En 2010, Synaps a créé sa propre structure de diffusion itinérante, Le Cinéma Voyageur, porté par l’envie de partager les films produits par le collectif mais aussi des coups de cœurs. Le Cinéma Voyageur programme des auteurs qui ont une démarche de libre diffusion (Art libre, copyleft, creative commons) ainsi que certains « OVNI » qui n’ont pas leur place dans les salles de cinéma classiques. Il voyage pendant les trois mois estivaux, sans subvention. L’accès pour tous est favorisé par des séances uniquement à prix libre. Le collectif s’est constitué autour d’anciens étudiants. Leurs films sont sous licence libre pour en favoriser le partage et disponibles en DVD sur la boutique en ligne du collectif, mais aussi dans certaines librairies et en médiathèques à travers la distribution de Colaco et l’ADAV. Enfin, le collectif mène des actions de formation à destination de différents publics.
En savoir + :
Le Cinéma Voyageur
Les films de Synaps
Isabelle Boulord, Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, remarque que les cinéastes ici présents parlent d’endroits assez différents. Les Scotcheuses sont militantes. Olivier Bosson vient de l’art contemporain participatif et n’utilise pas le même registre lexical. Quant au collectif Comet, on se demande s’il ne s’agit pas seulement d’une mutualisation de moyens. Comment l’argent est-il réparti ? Ses membres ont-ils des sujets ou un axe artistique en commun ?
Maxime Martinot répond qu’ils tentaient en effet de mutualiser au maximum les aides reçues, mais il s’agissait moins d’argent que de matériel et de compétences. Benjamin Hameury ajoute que la question d’une ligne artistique commune s’est posée, mais elle ne peut pas répondre à la grande diversité formelle des projets dont les techniques de tournage vont du 16mm à la miniDV. Il n’y a pas de réelle logique esthétique commune, pas de style commun. Ce qui, in fine, fait objet commun, c’est le geste de faire des films et la volonté de constituer une « troupe », ce qui existe assez peu au cinéma.
Gabriel Bortzmeyer questionne Olivier Bosson sur le processus d’écriture des scénarios de ses films : s’agit-il d’un processus d’écriture collective ?
Olivier Bosson répond que l’un des enjeux de la dimension participative de ses films est la responsabilité d’exprimer d’autres points de vue que les siens, précisément les points de vue de ceux qui sont représentés dans ses projets. Concernant l’écriture, il est rare d’avoir du temps. Or il en faut pour travailler avec les gens. Les dialogues de l’extrait de 200 % sont, par exemple, le résultat d’un atelier philo d’une semaine animé avec les enfants qui jouent dans le film. Il précise par ailleurs qu’il ménage toujours une phase où il discute avec des personnes qu’il rencontre, sans but précis si ce n’est de se renseigner « à la sauvage ». Dans un second temps, il se consacre à la documentation.
Les Scotcheuses évoquent, dans la lignée du travail collectif et participatif décrit par Olivier Bosson, les « ateliers urbains » du Centre vidéo de Bruxelles. Les Ateliers Urbains sont une collection de travaux, entamée en 2010 et réalisée avec des habitants de Bruxelles, sous forme de films, d’expositions, de journaux, avec pour ambition de développer une forme d’éducation permanente. Les intervenants animent un atelier par semaine pendant 6 mois.
Maxime Martinot clôt la table ronde en expliquant qu’une fois par an, des rencontres regroupant les collectifs sont organisées. La dernière a eu lieu à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant les expulsions. L’Abominable, l’association Mire de Nantes, le Polygone étoilé de Marseille y ont participé. Cela donne au réseau une ampleur assez nouvelle.
La salle de cinéma indépendante art et essai à l’heure de la métropole #2.
En partenariat avec l’ACRIF, l’AFCAE, le GNCR et le SCARE.
Matinée animée par Juliette Boutin, déléguée générale du GRAC (Groupement régional d’actions cinématographiques).
LES ENJEUX DE L’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE MÉTROPOLITAIN
Conférence par Victor Courgeon, diplômé de la FEMIS, auteur d’un mémoire intitulé Les cinémas publics de Seine-Saint-Denis : quel avenir au sein du Grand Paris ?

Confrontés à la concurrence toujours plus vive des multiplexes sur les titres porteurs, comment les cinémas art et essai de la périphérie peuvent-ils affirmer une singularité éditoriale tout en maintenant une diversité cinématographique et une fréquentation suffisante ?
Cette présentation est le fruit d’un mémoire de recherche effectué par Victor Courgeon sous la direction d’Olivier Alexandre dans le cadre de son cursus en exploitation à La Fémis. Il y envisage la question de la volonté politique des collectivités territoriales dans un nouveau contexte économique et urbain, ainsi que celle de la régulation cinématographique dans la perspective de l’avènement du Grand Paris qui attise les convoitises d’aménageurs et de promoteurs privés.
Les périphéries tendent à redevenir des territoires de reconquête pour les circuits. Dès lors, quelle est la nature de l’influence des opérateurs immobiliers et commerciaux dans la construction de nouvelles salles ?
Quelle part d’initiative et quels moyens de contrôle ont encore des acteurs publics et parapublics métropolitains au pouvoir politique incertain ? Cette question de la régulation s’inscrit dans le contexte plus large du réaménagement des centres-villes et de la modernisation des équipements publics.
Avant d’entrer dans le détail de sa présentation, Victor Courgeon propose quelques rappels historiques territoriaux : la Seine-Saint-Denis recouvre d’anciennes banlieues communistes. Associée à l’immigration, au chômage, à la politique de la ville, elle est devenue un symbole de différentes crises urbaines. Mais son image tend à changer depuis quelques années, notamment en raison de l’avènement du Grand Paris.
Aujourd’hui ce territoire regroupe 30 cinémas dont 24 publics (41 écrans) et 6 privés appartenant à des circuits, tous des multiplexes (73 écrans). Le tissu de salles publiques est très dense mais hétérogène en termes de taille, de statuts, de résultats et de connexion avec des réseaux territoriaux ou professionnels.
La notion de cinéma public est « indigène », c’est-à-dire que ce sont ses propres acteurs qui s’auto-caractérisent ainsi. Elle recouvre en fait plusieurs cas de figure en Seine-Saint-Denis : des salles en régie directe, des salles associatives conventionnées, une salle en délégation de service public.
C’est aussi une catégorie d’action politique, qui tend à être acceptée par tous les acteurs, ce qui n’a pas toujours été le cas. C’est pourquoi de nombreuses lois sont venues réguler l’intervention et la subvention publiques, en premier lieu la loi Sueur de 1992, puis en 2002 la loi relative à la démocratie de proximité et en 2004, celle relative aux libertés et responsabilités locales : les collectivités peuvent attribuer des subventions aux exploitants régulièrement identifiés auprès du CNC qui réalisent moins de 7500 entrées hebdomadaires ou qui font l’objet d’un classement Art et Essai. L’aide ne doit pas excéder 30% du chiffre d’affaires de la salle de cinéma ou des travaux. ». Plus récemment, des textes concernant la décentralisation ont affirmé le caractère non obligatoire et partagé de la compétence « culture » des collectivités, en particulier la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) en 2015 dont l’article 104 stipule que ces compétences sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. Toutes les collectivités territoriales peuvent intervenir dans le domaine culturel.
Depuis environ une décennie, la métropolisation est au cœur des enjeux territoriaux, comme des enjeux de l’exploitation publique et privée. En dévoilant les 85 finalistes du dernier appel à projets, Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris n’a-t-il pas dit, à destination des « gens du gouvernement », « qu’ils prennent bien conscience que le fait métropolitain est irréversible » ?[1]
I – La métropolisation. Quelles menaces et quelles opportunités pour les cinémas publics ?
Rapide retour sur la création du Grand Paris
La société du Grand Paris, créée en 2010, est en charge du réseau de transport « Grand Paris Express ». En 2014, la loi MAP-TAM crée la Métropole du Grand Paris, sous forme d’EPCI, qui voit le jour le 1er janvier 2016. Cette création est confirmée par la loi NOTRe en 2015. Pour beaucoup, le Grand Paris n’existe pour l’instant que par son réseau de transports. Et l’accessibilité est un enjeu majeur pour les salles de cinéma : c’est sur le tracé du Grand Paris Express que sont nés la majorité des appels à projets urbains, incluant parfois des salles de cinéma.
1/ Un nouveau réseau de transport
Le Grand Paris Express verra le jour à l’horizon 2030. La Seine-Saint-Denis sera également impactée par l’extension des lignes de métro 11 et 14 et par la création des lignes 15, 16 et 17 prévues pour les Jeux Olympiques de 2024 (une garantie – partielle – de leur livraison dans les temps). Cette nouvelle toile donne naissance à de nouveaux pôles d’attractivité et à de nouvelles gares, qui vont contribuer à modifier les flux et à déplacer les zones d’habitation et d’activité. Dans le rapport « Grand Paris Express et lieux culturels », l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) a présenté quelques-unes des perspectives offertes aux cinémas par le nouveau réseau : élargir les publics et faciliter l’accès des scolaires aux dispositifs nationaux d’éducation à l’image, faciliter l’accès en transports en commun, surtout pour les grands multiplexes, faciliter la mise en place de festivals et d’actions concertées[2].
Mais ce GPE est bien loin d’être une opportunité pour tous… Luigi Magri, alors directeur du cinéma Jacques Tati à Tremblay-en-France, résumait ainsi l’action modificatrice du tracé du Grand Paris Express : « le Grand Paris enclave autant qu’il désenclave ». Une binarisation des salles publiques du département a en effet tendance à s’exercer, hypothèse validée par le nouveau découpage territorial.
2/ Un nouveau découpage territorial
La Métropole est découpée en 12 Établissements Publics Territoriaux (EPT). Un nouvel échelon a donc été créé, entre communes et départements. Il peut prendre la place d’anciennes communautés de communes. Ces nouvelles entités administratives peuvent accorder des aides économiques aux salles de cinéma ou intervenir indirectement par le PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) qui concerne aussi l’aménagement cinématographique. Pour les cinémas publics, c’est parfois une nouvelle autorité de tutelle comme dans le cas d’Est Ensemble, l’un des 4 EPT de la Seine-Saint-Denis.
3/ Les appels à projets
Le Grand Paris est une gigantesque opération urbaine organisée autour de l’idée de rentabilité. La MGP a lancé des appels à projets qui participent au développement économique des territoires. De nombreux quartiers et centres commerciaux sont en cours de rénovation ou le seront en participant à ce processus. Dans l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », qui comptait 51 sites dans son premier volet, on trouve des cinémas au cœur de ces nouveaux ensembles urbains à construire. Robert Laborie, directeur de développement de CGR, a confirmé que la région parisienne est « l’un des rares endroits où il y a encore du potentiel », c’est-à-dire des opportunités d’implantation cinématographique[3]. C’est visiblement une opinion partagée par de nombreux groupes, et ce retour des circuits est flagrant chez UGC, que ce soit du côté des ouvertures ou des agrandissements
Le 16 octobre, les finalistes du second volet « Inventons la Métropole du Grand Paris » ont été annoncés. Sur 30 sites, 11 se situent en Seine-Saint-Denis. La remise de l’offre concrète se fera en mars 2019. On ne sait pas encore si des cinémas sont intégrés dans certains projets retenus mais, dans la première liste, il y en avait quelques-uns : des projets d’Etoile Cinémas en Seine-Saint-Denis, mais également du groupe UGC comme à Villiers-sur-Marne.
Dans cette logique d’appel à projets, on est en droit de se demander qui décide vraiment. D’un côté, les collectivités mettent à disposition des terrains pour leur réhabilitation et fixent un semblant de cahier des charges. De l’autre, le contenu de ces projets, le montage financier et le choix des partenaires privés ou publics associés aux complexes immobiliers sont laissés aux mains des promoteurs. De là, un certain pouvoir de définition et d’aménagement du territoire. La décision finale revient toutefois aux autorités publiques qui désignent les projets lauréats et surtout façonnent les plans urbains et délivrent les permis de construire indispensables à la mise en construction.
Pourquoi le cinéma apparaît-il dans cette dynamique urbaine ? D’abord parce que beaucoup d’indicateurs économiques de ce secteur sont positifs en termes d’entrées, d’équipements et de pratiques culturelles : l’activité est sécurisante, rentable. C’est un produit d’appel sans pareil pour les investisseurs. Ensuite les promoteurs, eux-mêmes de grands groupes, se tournent assez naturellement vers les circuits qui sont de même taille. Ceux-ci sont prêts à payer un loyer conséquent et le nombre d’écrans permet aux promoteurs d’augmenter également les loyers des commerces adjacents.
Reste à savoir comment les acteurs publics peuvent exister dans ce processus de prise de décision. Les paroles des acteurs de l’exploitation n’ont pas toutes la même portée auprès des aménageurs, comme s’en inquiète le sociologue Emmanuel Wallon : « il faut toutefois craindre que les politiques métropolitaines […] ne sauront relever les défis d’un développement culturel équilibré tant que les défenseurs des petites structures et des équipes indépendantes se trouveront sous-représentés parmi les experts convoqués pour les conseiller. »[4]

II – Quelle place / légitimité pour l’intervention publique ?
Quelle place peut-il exister pour une salle publique dans un ensemble commercial ? Comment justifier l’installation d’un équipement public quand l’opportunité économique de s’implanter existe pour un opérateur privé ?
Questionner la légitimité de l’exploitation publique en Seine-Saint-Denis, c’est aussi questionner la résilience des cinémas publics existants face aux mutations à venir. Si cette question de légitimité fut autrefois houleuse (comme ce fut le cas autour de la construction du nouveau Méliès à Montreuil), la situation s’est aujourd’hui apaisée. La raison d’être des salles publiques réside dans leurs différences par rapport aux salles commerciales. En ce sens, la carence de l’initiative privée n’est pas forcément quantitative, mais peut être aussi qualitative comme a pu l’expliciter le Conseil de la Concurrence : « La collectivité peut aussi justifier son intervention par le fait que l’offre marchande déjà existante ne correspond pas aux attentes culturelles, éducatives ou sociales des habitants, compte tenu des programmes et des tarifs que les salles existantes proposent »[5]. Le rapport Perrot-Leclerc de 2008 issu de la mission Cinéma et Concurrence va plus loin en estimant que « l’intervention des collectivités territoriales dans le secteur de l’exploitation en salles est légitime, qu’il s’agisse de poursuivre des objectifs d’aménagement du territoire, d’intégration sociale ou de revitalisation urbaine. »[6]
Toutefois des craintes subsistent quant au retour des circuits : à côté des multiplexes installés dans les zones commerciales à la périphérie des villes, qu’en est-il de l’incursion des privés dans les cinémas souvent art et essai des centres-villes ? On pense au groupe Etoile Cinéma, mais ses perspectives de développement restent assez floues et l’expérience malheureuse de l’Etoile Lilas l’a quelque peu décrédibilisé. Pour Corentin Bichet, chef du service de l’exploitation au CNC, « le multiplexe art et essai n’a pas existé depuis vingt ans qu’il est annoncé. » Et on constate que ni les circuits, ni les indépendants privés, ne se sont emparés du concept de miniplexe art-et-essai tant attendu. UGC et CGR ouvrent plutôt de grosses structures en périphérie parisienne.
Il y a donc une véritable chance à saisir du côté des pouvoirs locaux que d’investir les centres-villes avec des équipements art-et-essai correctement dimensionnés. La métropolisation joue sur les appels à projets certes mais requalifie également tous les centres-villes. Le cinéma est un produit d’appel, non seulement commercial, mais plus largement urbain et, à l’échéance de 2020, probablement un produit d’appel politique et électoral. C’est un outil de construction de la ville de demain par son contenu, son activité de diffusion de films, par ses publics, son intégration aisée dans des ensembles mixtes et son mode de gouvernance finalement assez souple qui permet le développement d’exploitations publique ou en lien avec le privé par la délégation de service public ou encore par des partenariats public-privé (qui doivent encore faire leurs preuves).
Conclusion
Dans les années soixante-dix, la municipalisation a sauvé beaucoup de salles de la disparition, mais il faut être aujourd’hui capable – car c’est juridiquement, politiquement et économiquement viable – d’impliquer les municipalités et les autres territoires dans des logiques d’apparition de salles, et non plus seulement dans la sauvegarde de cinémas existants. C’est le rôle des salles et de leurs associations représentantes, en lien avec le monde politique, que de maintenir une veille, d’être pro-actif et force de proposition vis-à-vis des élus pour ne pas rester sur la défensive, mais également participer en amont à la construction du territoire, surtout dans un contexte aussi mouvant que celui du Grand Paris. Et c’est en cela que nous restons attentifs à la situation de Bobigny.
Victor Courgeon propose quelques pistes pour densifier le parc de salles publiques et participer aux dynamiques de territoire. Cette question de l’aménagement urbain est d’autant plus essentielle qu’elle est très souvent mise en avant par les élus.
Davantage qu’un outil de diffusion et de transmission culturelle, le cinéma est un outil de redynamisation territoriale, ce qu’on peut lire dans les propos d’Emmanuel Constant il y a 10 ans, lors du colloque « Pour un cinéma de service public », organisé par Cinémas 93. Il était alors vice-président chargé de la culture du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, et ancien adjoint à la culture de Noisy-le-Grand, et disait : « c’est une question d’aménagement urbain. Et d’aménagement de ville. Je le dis parce qu’à l’aune de l’expérience que nous vivons aujourd’hui à Noisy-le-Grand, avec la réouverture d’un cinéma qui historiquement a existé pendant de nombreuses années, le Bijou, on a, au-delà du projet culturel, la volonté de sortir d’une logique qui consiste à dire que le centre d’une ville c’est un centre commercial. Ça c’est profondément déprimant. Parvenir, dans des villes de banlieue, à recréer un cœur de ville, je crois que c’est un enjeu urbain important, et ça passe par l’implantation de lieux culturels. Le cinéma en est un. »[7]
Il faut donc intégrer les cinémas publics, indépendants et art-et-essai dans les projets de ville, faire de ces salles un élément central du projet de ville (en termes urbanistiques) et du marketing urbain (c’est-à-dire un véritable outil politique et électoral pour les municipalités).
Dans cette optique d’aménagement urbain, la réussite économique de l’entreprise réside quand même beaucoup sur un facteur : le nombre d’écrans. C’est un enjeu de développement et de bonne gestion pour une salle indépendante. Il est aujourd’hui très difficile de faire vivre un mono-écran même public. Le SCARE (Syndicat des Cinémas Art et Essai) encourage d’ailleurs le développement de salles publiques de 3, 4 et 5 écrans dans la plaquette qu’il a éditée en fin d’année dernière à destination des maires de France, afin d’éveiller une conscience politique autour des salles chez les élus, d’en faire des outils de politique urbaine. Car le vrai danger pour les salles publiques n’est pas uniquement l’arrivée de nouveaux acteurs privés, mais aussi une désaffection de la part des autorités de tutelle.
La modernisation des salles joue un rôle essentiel dans ce contexte. C’est un point de vue porté par la CNACi qui a refusé l’ouverture d’un multiplexe à Claye-Souilly et a notamment motivé son refus en considérant que les cinémas de la zone d’aménagement cinématographique avaient engagé des travaux de rénovation subventionnés par le CNC ou les collectivités territoriales.[8] Densifier et moderniser le parc public prévient donc également le retour des groupes privés.
Il faut réfléchir à un nouveau modèle de salle publique. Dans un rapport non publié de Plaine Commune de 2013, il apparaissait déjà que le nouveau modèle de salle publique pourrait s’apparenter à un « multiplexe municipal, aux normes actuelles de confort et d’accueil, dans un quartier résidentiel et commercial, sur un carrefour de transports ».[9] Mais ces évolutions sont difficiles car les villes des périphéries souffrent de l’absence de centres-villes et la continuité urbaine des villes de banlieue est mise à mal par les axes de transport qui les traversent.
La question de la revitalisation des centres urbains fait toutefois aujourd’hui l’objet de débats nationaux au Sénat et au gouvernement qui viennent s’ajouter à la loi Elan, au plan « Action cœur de ville » et au « Permis d’innover ». Il est nécessaire pour les exploitants de se plonger au cœur du processus législatif d’aménagement du territoire pour préparer aux mieux les cinémas de proximité de demain…
Reste une question : comment les autorités publiques peuvent-elles réguler l’aménagement cinématographique quand l’initiative et le contrôle des projets leur échappent et qu’il ne reste que la CDACi ?
LE PROJET DE CINÉMA PUBLIC À BOBIGNY
Présentation par Martine Legrand, vice-présidente chargée de la culture Est Ensemble, et Adrien Brun, directeur de la culture Est Ensemble.

Face aux enjeux de l’aménagement cinématographique et urbain, et en affirmation de sa politique culturelle, l’établissement public territorial Est Ensemble a décidé de porter le projet du complexe de 6 salles qui sera construit dans le cadre de la réalisation du nouveau quartier de centre-ville de Bobigny.
Est Ensemble compte 400 000 habitants et regroupe 9 communes historiquement communistes et représentatives de la « banlieue rouge » (Pantin, Bobigny, Les Lilas, Bagnolet, Bondy, Le Pré-Paint-Gervais, Romainville, Noisy-le-Sec et Montreuil). Cette communauté d’agglomération est devenue, le 1er janvier 2016, un Établissement Public Territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris. En tant que vice-présidente chargée de la culture d’Est Ensemble, Martine Legrand a une approche pragmatique du projet de cinéma public à Bobigny : quel est le rôle d’une métropole ? Qu’apporte-t-elle d’un point de vue politique ? En théorie, un équilibre financier entre l’est et l’ouest de la métropole parisienne. Mais, en tant qu’élue, elle s’interroge sur cet équilibre.
Est Ensemble n’a pas attendu d’être officiellement un EPT pour assurer la gestion des équipements culturels (cinémas, bibliothèques et conservatoires) et lancer leur transformation. Aujourd’hui, 6 salles de cinéma, réparties sur les 9 communes d’Est Ensemble, qui toutes font partie de l’héritage des cinémas municipaux, constituent le plus grand réseau de cinémas publics en France. Pour Est Ensemble, ce réseau représente un investissement financier important mais il répond d’abord à la volonté politique de donner une autre vision du cinéma, en-dehors des circuits commerciaux, avec une vocation éducative et une tarification adaptée aux revenus de la population et permettant à ceux qui sont éloignés des pratiques culturelles de trouver leur place. Le nouveau cinéma de Bobigny s’inscrit dans cette démarche.
Adrien Brun précise les enjeux spécifiques de ce projet de cinéma à Bobigny. Est Ensemble est très proche de Paris et l’image de certaines de ses communes, comme Montreuil et Pantin, s’est améliorée suite à l’arrivée de populations plus aisées. Mais cette tendance ne doit toutefois pas masquer la réalité sociale et démographique du territoire : 40% de la population a moins de 30 ans, le revenu médian de la population y est inférieur d’un tiers par rapport au reste de la région et le taux de chômage deux fois plus élevé. À noter également que 60 % de ses habitants ont un niveau d’étude inférieur au BEP. À Bobigny, ville de 50 000 habitants, ces phénomènes sont plus accentués encore : 70 % de la population habite dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Bobigny est situé au cœur du processus de métropolisation en termes sociaux, économiques et démographiques. Façonné par l’urbanisme sur dalle des années 1970, le centre-ville de Bobigny est marqué par des ruptures d’échelles importantes et formé d’un assemblage d’îlots urbains et de quartiers déconnectés les uns des autres. Ce centre-ville est équipé d’un centre commercial dont la ville est locataire. La construction du cinéma date de la même époque. A l’origine, il s’agissait d’un cinéma privé de 3 salles ouvert par UGC, mais il n’a pas résisté. La ville a décidé de le remplacer en 1987 en l’intégrant d’abord à la MC93, puis en le transférant dans le centre commercial. Depuis 1987, le Magic Cinéma a connu toutes les formes juridiques : associative, municipale, transférée à Est Ensemble.

À l’été 2015, des discussions s’ouvrent sur le devenir de la salle. Un an plus tôt, Bobigny, qui a connu une majorité communiste pendant 80 ans, a basculé au centre-droit avec l’arrivée de l’UDI. Les élus expriment leur souhait de faire disparaître le centre commercial et de créer un nouveau centre-ville « commerçant ». Ce projet n’est pas une opération publique, car le centre commercial appartient à un consortium, et ne relève pas d’une zone d’aménagement concerté. Mais la Ville de Bobigny a joué un rôle d’impulsion et de suivi.
Le projet de centre-ville, tel qu’il a été décidé, implique la destruction du Magic Cinéma. La Ville souhaite la création d’une nouvelle salle et émet le souhait de faire appel à un opérateur privé pour établir une programmation plus ouverte et grand public. Est Ensemble s’y oppose : si la destruction du cinéma est souhaitable (les conditions d’accueil et de travail n’y sont pas satisfaisantes), la responsabilité de la programmation doit rester publique.
Entre 2015 et 2016, trois relocalisations possibles sont à l’étude : dans la future gare du Grand Paris Express (rapidement écartée), dans le nouveau centre commercial ou bien ailleurs, dans l’une des zones d’aménagement concerté de la ville. Les discussions n’avancent pas jusqu’à début 2017 et la désignation d’Altarea Cogedim comme opérateur du projet de démolition – reconstruction d’un nouveau centre commercial incluant des logements, des bureaux, une salle de fitness et un cinéma. Ce dernier est envisagé dans le projet pour créer une destination, faire venir les gens et « faire centre-ville ». Véritable lieu d’attraction, il doit rendre viables les commerces qui sont autour, garantir l’ouverture des restaurants le soir. Pour ce faire, Altarea Cogedim envisage de faire appel à un opérateur privé pour gérer un équipement de 6 salles, avec la possibilité d’un partenariat avec Est Ensemble sur le modèle du cinéma en projet à Carrefour Pleyel à Saint-Denis.
 Cette proposition a posé deux problèmes à Est Ensemble. D’une part, la présence d’un cinéma public à Bobigny est un élément de sa politique culturelle, en particulier pour ce qui touche l’éducation à l’image, l’accueil de rencontres et de débats, la mise en place de conventionnements avec les associations du territoire. Toutes ces actions deviendraient plus compliquées à mener avec un cinéma privé. D’autre part, l’implantation d’un cinéma privé menacerait l’équilibre du réseau de cinémas publics. Est Ensemble a donc décidé de convaincre Altarea Cogedim qu’un autre modèle était possible et proposé d’exploiter la future salle. Après de longues négociations entre mars 2017 et septembre 2018, Altarea Cogedim a non seulement désigné Est Ensemble comme exploitant d’un établissement de 6 salles et 880 fauteuils, mais accepté que l’EPT en devienne propriétaire en achetant la coque vide pour l’aménager. Cette décision a été votée à l’unanimité par les élus d’Est Ensemble en septembre 2018, sur la base d’un budget entre 15 et 20 millions d’euros.
Cette proposition a posé deux problèmes à Est Ensemble. D’une part, la présence d’un cinéma public à Bobigny est un élément de sa politique culturelle, en particulier pour ce qui touche l’éducation à l’image, l’accueil de rencontres et de débats, la mise en place de conventionnements avec les associations du territoire. Toutes ces actions deviendraient plus compliquées à mener avec un cinéma privé. D’autre part, l’implantation d’un cinéma privé menacerait l’équilibre du réseau de cinémas publics. Est Ensemble a donc décidé de convaincre Altarea Cogedim qu’un autre modèle était possible et proposé d’exploiter la future salle. Après de longues négociations entre mars 2017 et septembre 2018, Altarea Cogedim a non seulement désigné Est Ensemble comme exploitant d’un établissement de 6 salles et 880 fauteuils, mais accepté que l’EPT en devienne propriétaire en achetant la coque vide pour l’aménager. Cette décision a été votée à l’unanimité par les élus d’Est Ensemble en septembre 2018, sur la base d’un budget entre 15 et 20 millions d’euros.
Pour Adrien Brun, cette opération reflète les systèmes complexes auxquels se trouvent confrontées les collectivités. Des décisions peuvent échapper à la puissance publique. Il faut donc que les collectivités se positionnent différemment et se forment pour parvenir à négocier. Cela implique d’intégrer aux équipes des collègues rompus à la négociation. « Nous ne nous contentons pas d’avoir une mission de tutelle vis à vis des cinémas publics, nous sommes les cinémas publics. » Selon Adrien Brun, les salles publiques doivent évoluer. Il faut être plus efficient dans leur gestion, introduire davantage de polyvalence dans les équipes afin de dégager plus de temps pour développer des liens avec les habitants, augmenter leur présence sur les territoires. Ces cinémas doivent contribuer à la reconnaissance des droits culturels des habitants et devenir des lieux vivants de débats démocratiques dans nos cités.
Martine Legrand conclut : « le cinéma à Bobigny est un combat qui a un coût mais, quand nous y croyons, nous allons jusqu’au bout. »
Questions
Comment avez-vous réussi à convaincre le promoteur ?
Adrien Brun : Grâce à notre connaissance des territoires. Notre équipe était la mieux placée pour garantir la faisabilité du projet. La visite du Méliès a beaucoup compté pour prouver notre expérience en termes d’exploitation. Il a fallu déconstruire l’image associée aux cinémas publics, en particulier celle du Magic Cinéma qui est situé dans un centre commercial décrépi, sous une dalle, sans possibilité de restauration. Nous avons expliqué qu’à Bobigny nous étions les seuls capables d’exploiter cette future salle. Un opérateur privé aurait été déficitaire et, à terme, aurait assurément fermé.
Comment se profile le futur immédiat de la salle ?
La destruction du centre commercial est prévue en 2019. Il s’agit d’une très grosse opération qui se fera en deux tranches. Une première partie sera détruite puis reconstruite avant la destruction-reconstruction de la seconde partie. Le Magic Cinéma sera détruit lors la première phase, puis reconstruit avec la seconde. L’achèvement de la nouvelle salle est prévu en 2024 ou 2025. Dans l’intervalle, le cinéma développera un projet d’actions itinérantes à Bobigny 4 jours par semaine afin de continuer à proposer des séances scolaires, périscolaires et tous publics. Pour cela il faut identifier les lieux susceptibles d’accueillir des projections, acheter du matériel et former les équipes. Ces expérimentations pourront d’ailleurs bénéficier aux autres cinémas d’Est Ensemble.
Quel est le devenir de l’équipe du Magic Cinéma ?
Actuellement le cinéma compte 15 postes. L’équipe sera conservée, peut-être complétée au niveau de l’accueil et du contrôle en fonction de la configuration des espaces. Il est à noter que les missions de programmation et d’animation vont évoluer avec la mise en place du cinéma itinérant.
L’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE : LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DES CDACI (COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES) ET CNACI (COMMISSION NATIONALE)
Présentation par Eric Busidan, chef de la Mission de la diffusion au CNC et Stéphanie Encinas, avocate spécialiste d’urbanisme et d’aménagement commercial.

I – Origines de la réglementation en vigueur des CDACi et CNACi
Au début des années 1990, l’arrivée des multiplexes qui pouvaient librement s’implanter sur le territoire a poussé les acteurs de l’exploitation cinématographique et les pouvoirs publics à adopter un régime d’autorisation administrative préalable à la délivrance du permis de construire pour la création, l’extension et la réouverture de certains établissements de spectacles cinématographiques (« Loi Raffarin » de juillet 1996). Ce dispositif, adossé à celui de la Loi Royer (1973), a été élaboré sur le modèle de la réglementation applicable aux surfaces commerciales.
Cette procédure, qui visait dans un premier temps les équipements de type « multiplexe », porte aujourd’hui sur la quasi-totalité des établissements (soit toute création de salles dépassant le seuil des 300 places).
Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux objectifs d’intérêt général suivants :
- la diversité de l’offre cinématographique,
- l’aménagement culturel du territoire,
- la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme.
En tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques, elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique que la qualité des services offerts.
II – LA CDACi : rôle et composition
L’autorisation administrative est attribuée ou refusée par une commission départementale d’aménagement cinématographique. Cette commission est présidée par le Préfet de département (qui ne vote pas) et composée de 8 membres, 5 élus et 3 personnalités qualifiées.
Membres élus :
- le maire de la commune d’implantation du projet,
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation,
- le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation,
- le président du conseil général ou son représentant,
- le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.
Personnalités qualifiées :
- une personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, désignée sur proposition du CNC sur la base d’une liste établie de personnalités qualifiées établie par le CNC,
- une personnalité qualifiée en matière de développement durable, désignée sur une liste établie par les services de la préfecture,
- une personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire, désignée sur une liste établie par les services de la préfecture.
III – Les projets soumis à CDACi
Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet :
1/ La création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et de plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
2/ L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
3/ L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
3bis/ L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4/ La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux années consécutives.
L’instruction de dossiers est réalisée par les DRAC en CDACi et par les services du CNC (Mission de la Diffusion) devant la CNACi.
IV – Critères d’appréciation de la CDACi, puis de la CNACi
LA CDACi (et sur recours la CNACi) se prononce au regard des objectifs d’intérêt général vus précédemment sur les deux critères suivants :
1/ L’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a/ Le projet de programmation envisagé et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits ;
b/ La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
c/ La situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
2/ L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a/ L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
b/ La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ;
c/ La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
d/ L’insertion du projet dans son environnement ;
e/ La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.
En savoir + :
Les critères, l’Article L 2012-9 (CNC)
Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique.
Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant fait l’objet d’un contrôle du CNC, transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier.
V – Rôle, composition et fonctionnement de la CNACi
En dehors des autorités désignées par les textes (notamment le Médiateur du cinéma), toute personne justifiant d’un intérêt à agir pour contester la décision délivrée par la CDACi peut saisir la CNACi d’un recours administratif préalable obligatoire.
La CNACi, saisie dans le délai d’un mois suivant la mesure de publication la plus tardive, doit se prononcer dans le délai de 4 mois suivant la saisine.
Elle se prononce sur les mêmes critères que ceux examinés par la CDACi même si le projet peut connaître quelques modifications, notamment sur sa programmation.
La CNACi est composée de 9 membres (3 issus des grands corps, 3 désignées directement ou indirectement par le ministère de la Culture, 1 par le ministère chargé de l’Urbanisme, 2 par les présidents des Assemblées parlementaires).
Seules les décisions de la CNACi sont contestables en justice, devant la Cour administrative d’appel compétente.
VI – Les enjeux récents des CDACi et des CNACi
Ils concernent essentiellement :
> l’aménagement du territoire, la protection des cœurs de ville, notamment pour les villes faisant partie du Plan Action Cœur de Ville mis en place par le gouvernement,
> l’adéquation entre les documents d’urbanisme locaux (PLU, SCOT, SDRIF) et le choix d’implantation du cinéma,
> l’apport du projet à la diversité cinématographique, la prise en compte des engagements de programmation au travers du projet de programmation.
Le déroulement concret des procédures de recours devant la CNACi, puis la cour administrative d’appel, par Stéphanie Encinas
Lorsque l’autorisation administrative est délivrée par la CDACi à un opérateur de multiplexe, la salle impactée par cette nouvelle ouverture doit agir rapidement car les délais de recours sont courts. Pour fonder son intérêt à agir, il lui faut d’abord vérifier si la salle est bien située dans la ZIC (Zone d’Influence Cinématographique) du projet. À défaut, il lui faut contester l’exclusion de cette ZIC. Puis elle doit réunir tous les documents liés au projet et les analyser.
En effet, lorsqu’elle est saisie, la CNACi reprend le dossier du projet, le rapport de la DRAC et mène une seconde instruction au regard des arguments qui auront été apportés. Elle a donc besoin d’arguments concrets et objectifs pour instruire efficacement un dossier.
À ce titre, le rapport de la DRAC se révèle riche en informations. Il importe également de maîtriser l’ensemble des éléments présentés dans le dossier initial qui peut contenir des informations sur les flux de circulation, sur le respect de l’environnement (comme l’imperméabilisation des sols qui peut être un élément sanctionnable en CDACi). Si la future salle s’inscrit dans un projet de ZAC, il faut vérifier si celui-ci est mûr, si la ZAC sera bien autorisée. Il ne faut pas non plus hésiter à consulter le PLU (Plan local d’urbanisme) ou le SCOT (Schéma de cohérence territoriale).
Stéphanie Encinas recommande de faire attention à dépassionner le débat. En face, les opérateurs de multiplexes font systématiquement appel à un conseil qui n’hésitera pas à détricoter toute l’argumentation présentée dans le recours.
Les CNACi et CNACi connaissent des réformes tous les deux ans. Le cabinet Letang Avocats a eu l’opportunité d’y participer en travaillant notamment avec le Sénat sur la loi Elan. Le commerce est un véritable enjeu pour les élus mais, avec le cinéma, on passe du domaine du commerce à celui de l’urbanisme de l’environnement et de la diversité cinématographique, avec toutes les nuances que cela comporte : par exemple, on ne peut pas refuser l’ouverture d’un commerce en périphérie au motif qu’il aurait un impact sur le centre-ville, alors qu’en matière de cinéma, cet argument est valide.
Après un recours infructueux en CNACi, il est possible de déposer un recours en appel au tribunal administratif. Le juge pourra alors apporter un éclairage sur les critères d’appréciation qui permettent l’ouverture d’une salle. Or c’est précisément ce qui manque en matière de cinéma : les commissions ont besoin de cet éclairage du juge pour préciser les critères et tenir compte des évolutions. En matière d’aménagement commercial, les critères d’évaluation ont évolué : constatant que les centres-villes sont aujourd’hui en grande difficulté, les députés et sénateurs ont désormais mis en avant la notion de vacance commerciale.
Question
Les associations nationales représentatives de salles de cinémas peuvent-elles déposer un recours auprès de la CNACi au nom de leur intérêt à agir ?
Eric Busidan évoque le cas récent d’un recours déposé par une association nationale sans que celle-ci ne représente aucune salle au sein de la ZIC en question : la CNACi a admis le recours mais, juridiquement, ce recours n’est pas légitime. Il faut que l’association représente un de ses membres impactés par le projet et que, dans les statuts de l’association, figure expressément la possibilité d’exercer un recours au nom d’un membre. La CNACi a donc dans ce cas admis de façon assez libérale l’intérêt à agir. Seuls la cour administrative en appel et le Conseil d’État pourront trancher définitivement cette question.
Stéphanie Encinas ajoute qu’en matière de commerce, ce type d’action ne tiendrait pas et, si l’on fait un parallèle avec les permis de construire, il faudrait que l’association de salles ait un intérêt directement touché. Stricto sensu, le recours doit être porté par l’exploitant d’une ZIC. Dans ce cas, la commission pourrait alors tenir compte des arguments du groupement national qui viendrait en appui.
Peut-on penser l’aménagement cinématographique du territoire à l’aune d’enjeux nationaux ?
Eric Busidan rappelle que la jurisprudence du Conseil d’État regarde l’intérêt de la personne par rapport à l’objet de la décision : l’implantation d’un cinéma local. L’intérêt à agir n’est pas l’intérêt général de l’industrie, mais il est lié au projet en lui-même.
Selon Stéphanie Encinas on ne peut pas se référer à l’intérêt général en termes d’aménagement cinématographique. L’objet de la demande est une autorisation administrative et c’est le juge administratif qui tranche.
Lorsqu’un porteur de projet dépose un recours devant la cour administrative, peut-il dans le même temps déposer un nouveau projet ?
Eric Busidan répond que c’est possible en effet, à condition que le nouveau projet soit substantiellement différent du premier, par exemple qu’il ait soustrait une ou deux salles. Dans ce cas il est possible qu’à terme le porteur de projet voie ses deux demandes d’autorisation acceptées ! Il faut avoir à l’esprit que la position des juges est assez libérale : 85 % des demandes d’autorisation sont acceptées et les annulations d’autorisation portent uniquement sur des erreurs de procédure. En regard, 50 % des refus sont annulés. Il est en effet plus difficile pour la CNACi de motiver un refus que de justifier une autorisation.
Stéphanie Encinas rappelle que le juge est un technicien du droit qui se réfère aux textes juridiques et à la jurisprudence. Or, comme il y a moins de jurisprudence en matière de cinéma qu’en matière de commerce, le juge, qui n’a pas la connaissance du terrain et ne se rend pas nécessairement compte des enjeux de l’aménagement cinématographique, sera tenté de se référer à la jurisprudence de l’aménagement commercial. Dans ces conditions, non seulement ses décisions pourront sembler incohérentes mais surtout, en commerce, le principe reste l’autorisation, quasi systématique, et le refus l’exception.
LES CDACI ET CNACI EN QUESTION(S)
Table ronde avec Yves Bouveret, délégué général d’Écrans VO, association des cinémas indépendants du Val-d’Oise, Luigi Magri, directeur de l’ACAP et précédemment directeur du cinéma Jacques Tati à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), Tifenn Martinot-Lagarde, cheffe du Service de l’économie culturelle en charge de l’écrit, du cinéma et de l’image animée, DRAC Ile-de-France, Antoine Mesnier, directeur général du Cabinet d’études Vuillaume CinéConseil.
Quels arguments les cinémas indépendants art et essai peuvent-ils faire prévaloir pour endiguer la création de multiplexes dans leur environnement immédiat ? Quels principes de libre concurrence leur sont opposés en l’état actuel de la réglementation ? Les « règles du jeu » actuelles peuvent-elles évoluer et dans quelles directions ?

Comment les cinémas et les associations de salles perçoivent-elles le fonctionnement des commissions et se donnent les moyens de se défendre contre l’implantation de multiplexes ?
Yves Bouveret ouvre le tour de table en proposant quelques termes pour synthétiser les enjeux de cette table ronde : « urgence », « secret », « empirique », « régulation », « contre », « fragile », « stratégie ».
Dès les années 90, dans le Val d’Oise, les élus ont voté à l’unanimité contre l’implantation d’un multiplexe à Pierrelaye. Les opérateurs ont alors choisi d’installer leurs équipements à la limite territoriale du Val-d’Oise, dans les départements limitrophes. On comprend que certains aient pu être échaudés.
Yves Bouveret déplore que les projets d’équipements soient déjà verrouillés en amont, empêchant toute négociation préalable. De plus les cinémas impactés par le nouveau projet n’ont pas accès aux dossiers déposés auprès de la CDACi, ni au rapport de la DRAC. Les seules informations disponibles sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour que la CDACi refuse l’autorisation sont le nombre de fauteuils et d’écrans. On a tendance à faire de plus en plus l’impasse sur les CDACi car nos arguments pèsent peu auprès de commissions composées majoritairement d’élus locaux.
Il s’agit donc de se donner les moyens d’exercer un contre-pouvoir politique. Afin de pouvoir agir en défense, Écrans VO a changé ses statuts, adhéré à l’AFCAE puis au GNCR. Dans certains cas, Écrans VO a été amenée à agir car les salles municipales impactées n’étaient pas défendues par leurs élus en commission. Récemment, certains membres d’Écrans VO n’ont pu assister à des assemblées générales organisées en vue de s’opposer à des projets car ceux-ci étaient localisés dans les communes pour lesquelles ils travaillent.
Luigi Magri, quand il était directeur du cinéma Jacques Tati à Tremblay-en-France, est intervenu dans le cadre de 4 CNACi. Selon lui, quand on a connaissance des projets, il est souvent déjà trop tard. La question majeure est donc de savoir comment s’informer en amont. Il serait souhaitable que tous les acteurs concernés soient mis au courant en même temps.
Concrètement, quand on a connaissance d’un projet de multiplexe, on essaye de s’organiser. On se dit qu’en CDACi, l’autorisation va être accordée dans la majorité des cas, alors on construit un argumentaire pour la CNACi, sans connaître les critères qui vont influer sur l’obtention ou non d’une autorisation. Il serait d’ailleurs judicieux que les réseaux de salles proposent des formations à ce sujet.
On tente d’abord de mobiliser la ville, qui ne soutient pas toujours le modèle de cinéma public. Ensuite il faut très bien connaître sa salle, vérifier chaque élément pour avoir tout en tête et être le plus objectif possible : le public touché, les données sociologiques, la programmation, le pourcentage de films recommandés AFCAE et GNCR, recherche, répertoire et jeune public, le nombre de séances et de spectateurs pour ces films… Au-delà de sa salle, il faut identifier les autres établissements touchés (et prendre contact avec eux), les seuils et engagements de programmation… Et éventuellement prendre un avocat, très utile pour éviter des oublis, notamment en manière d’urbanisme ! Car, même si on n’a pas le temps de tout présenter en commission, il faut tout maîtriser : les problématiques de centre-ville, les travaux effectués dans les salles avec l’aide sélective du CNC et le soutien de la Région… Au final, une audition en CDACi comme en CNACi dure 5 minutes. Il faut donc avoir une approche très pragmatique et être armé pour répondre à toutes les questions.
Luigi Magri a également sollicité les collègues de la ZIC, l’association départementale [Cinémas 93], le SCARE, le GNCR, l’ACRIF, l’AFCAE et la médiatrice. Le collectif qui existe en Seine-Saint-Denis pour défendre les salles publiques est assez rare et repose sur des exigences qu’il faut savoir porter.
Le rôle de la DRAC
Tifenn Martinot-Lagarde indique que, depuis qu’elle est en poste à la DRAC Ile-de-France, elle a suivi 50 projets passés en CDACi. Dans son service, c’est Eymeric de Lastens, conseiller cinéma et audiovisuel, qui instruit les dossiers .
Tifenn Martinot-Lagarde détaille ensuite le circuit de décision pour chaque projet déposé en CDACi.
La préfecture du département informe en premier lieu la DRAC du dépôt d’un dossier (il arrive parfois que la DRAC ait connaissance du projet en amont mais ce n’est pas systématique). Une fois que la préfecture a vérifié la complétude du dossier, la CDACi peut se tenir dans un délai de deux mois incluant l’instruction du dossier. La préfecture nomme les membres de la commission et détermine la date de tenue de CDACi. Lors de la commission, présidée par le préfet ou son représentant, le rapport de la DRAC est présenté. Si un recours est ensuite déposé, c’est devant la CNACi avec instruction du CNC.
Le rapport de DRAC est constitué de trois parties et reprend les critères de la réglementation :
1/ Présentation du projet du demandeur.
2/ Effets potentiels sur la diversité dans la ZIC (quantitatif et qualitatif), sur l’accès des salles aux films : la DRAC contacte les services du médiateur pour vérifier les demandes de médiation. Elle consulte aussi les questionnaires art et essai pour vérifier les difficultés de programmation éventuelles. Elle évalue également l’apport du projet à l’offre présente dans la ZIC et l’équilibre entre les offres généraliste et art et essai.
3/ Analyse des effets du projet sur l’aménagement culturel (analyse de l’implantation, qualité de l’équipement, efforts de modernisation…), l’urbanisme et l’environnement (la Direction départementale des territoires et le service architecture de la DRAC sont sollicités pour apporter des éléments d’analyse).
Selon le projet, les salles proches ou impactées peuvent être contactées afin que leurs avis soient recueillis. Cela n’a rien de systématique. Quand les salles entendent parler de projets, elles ne doivent pas hésiter à contacter la DRAC.
Focus sur les 50 projets présentés en Ile-de-France entre 2011 et 2018
Rq : le projet de cinéma à Bobigny qui passera en CDACi fin novembre n’a pas pu être pris en compte.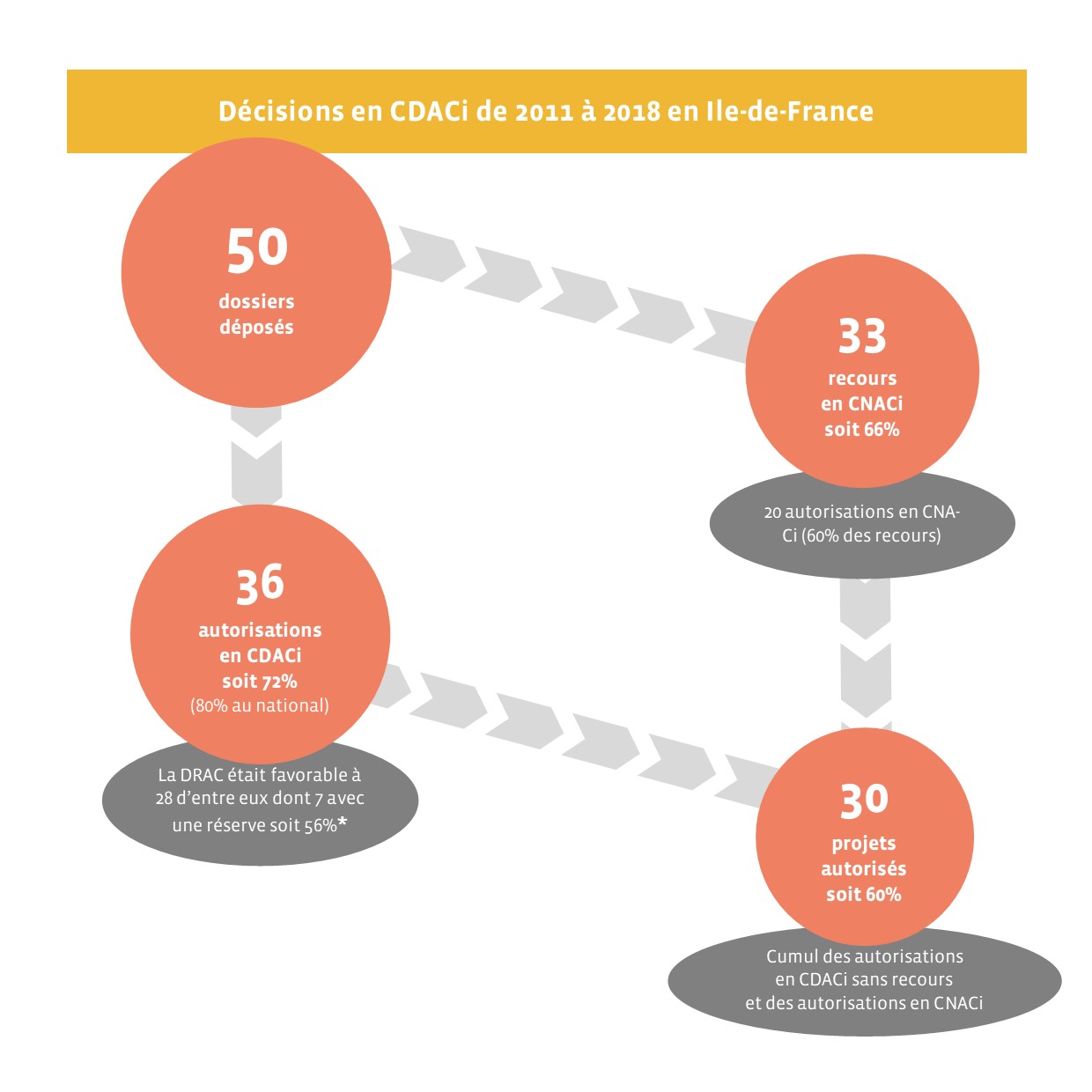
Tifenn Martinot-Lagarde constate un virage très net en 2015 : l’écart s’est creusé entre les avis formulés par la DRAC et les décisions en CDACi. Celles-ci ont vu leur taux d’autorisation augmenter, suivant de moins en moins les avis de la DRAC. Pour expliquer cette tendance, il faut rappeler le contexte déjà évoqué des dernières élections municipales, de la loi NOTRe et de la construction du Grand Paris. Du fait de la part importante des élus dans les commissions, le contexte urbain et la question des emplois deviennent prépondérants et les questions de cinéma sont moins examinées. D’autant plus que les rapports de la DRAC sont techniques et les élus ne mesurent pas toujours les enjeux en termes cinématographiques.
Par ailleurs, entre 2011 et 2018, on observe une augmentation du nombre d’écrans des établissements et une diminution de la capacité des salles, en particulier pour les extensions.

Enfin, Tifenn Martinot-Lagarde déplore un certain nombre de difficultés :
- Les projets simultanés dans la même zone : comme il n’est pas possible de favoriser un projet par rapport à l’autre, les deux peuvent obtenir un avis favorable de la part de la DRAC.
- Les projets redéposés avec une réduction du nombre d’écrans et qui, de ce fait, parviennent souvent à être autorisés. 6 dossiers ont été déposés à Claye-Souilly (77) avec un passage de 14 à 8 écrans, 3 à Bretigny-sur-Orge et à Massy (91).
- Le dépôt simultané de plusieurs dossiers : l’instruction devient difficile car le service de la DRAC ne dispose que d’un seul instructeur et les délais restent identiques.
Antoine Mesnier, directeur du cabinet d’études Vuillaume, fait part des évolutions qui ont eu lieu depuis 1996 (date de la mise en œuvre d’une réglementation) :
- Les opérateurs doivent aujourd’hui beaucoup plus détailler leurs projets de programmation. En particulier, il leur faut veiller plus précisément à la circulation des films et à leur accès.
- L’aménagement urbain est davantage pris en considération : il faut décrire en quoi le projet est conforme au PLU (plan local d’urbanisme) ou au SCOT (schéma de cohérence territoriale), même si la CDACi n’est pas associée à une demande de permis de construire, contrairement à la CDAC commerce.
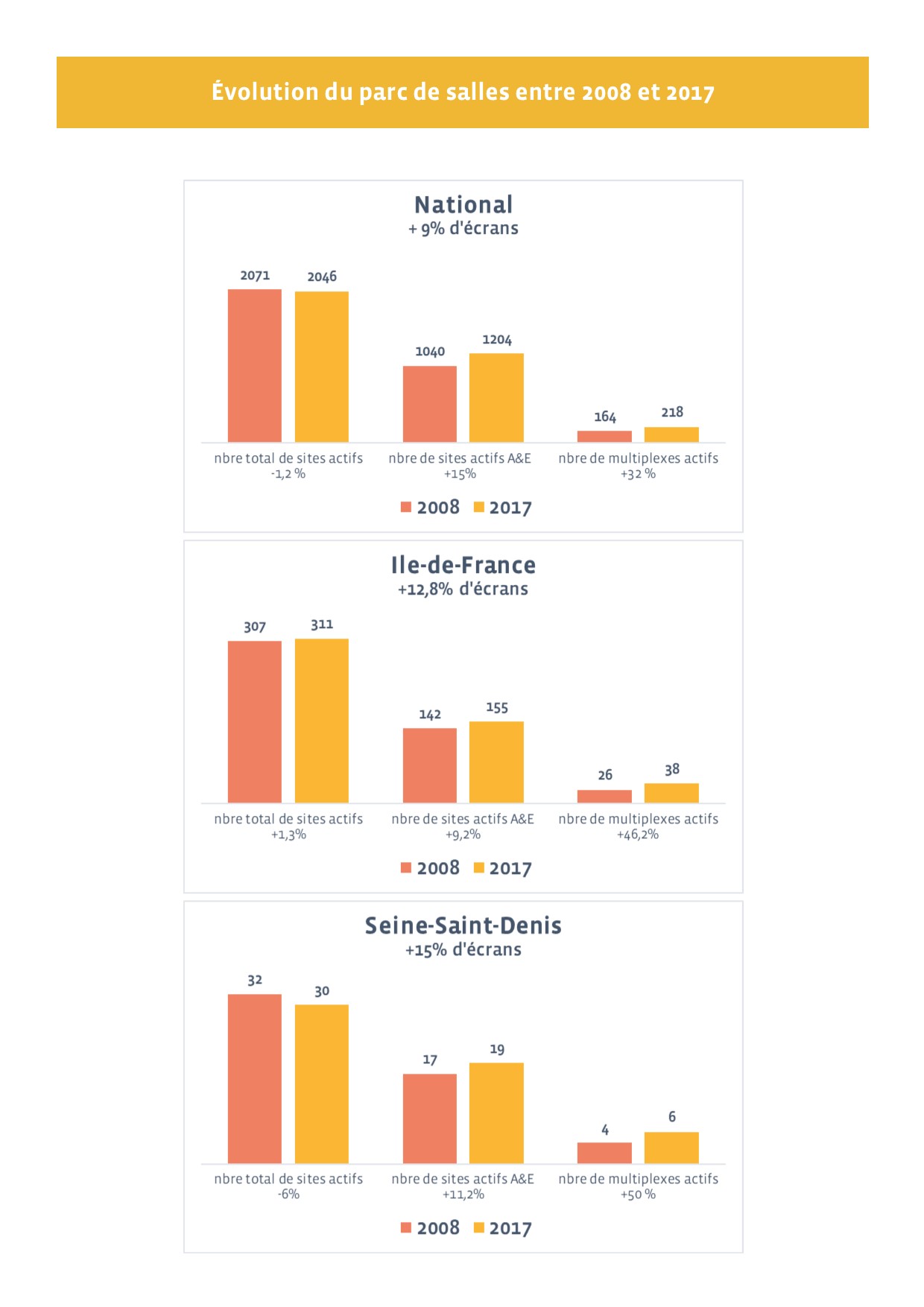 Tifenn Martinot-Lagarde revient sur la ZIC, précisant qu’il faut tenir compte de la localisation et du pouvoir d’attractivité des établissements existants dans la zone. C’est le porteur de projet qui définit les contours de la ZIC, mais la DRAC peut la redéfinir, sachant que les membres de la commission sont déterminés en fonction de la ZIC. Modifier les contours d’une ZIC peut donc influer sur la composition de la commission. Il faut alors avertir la préfecture suffisamment en amont pour que cela soit pris en compte. Tifenn Martinot Lagarde mentionne deux difficultés. Quand la DRAC constate qu’il existe un multiplexe en limite extérieure de la zone, elle ne sait pas s’il faut l’intégrer ou pas. Par ailleurs, il faut pouvoir tenir compte des équipements de la même enseigne présents dans la zone.
Tifenn Martinot-Lagarde revient sur la ZIC, précisant qu’il faut tenir compte de la localisation et du pouvoir d’attractivité des établissements existants dans la zone. C’est le porteur de projet qui définit les contours de la ZIC, mais la DRAC peut la redéfinir, sachant que les membres de la commission sont déterminés en fonction de la ZIC. Modifier les contours d’une ZIC peut donc influer sur la composition de la commission. Il faut alors avertir la préfecture suffisamment en amont pour que cela soit pris en compte. Tifenn Martinot Lagarde mentionne deux difficultés. Quand la DRAC constate qu’il existe un multiplexe en limite extérieure de la zone, elle ne sait pas s’il faut l’intégrer ou pas. Par ailleurs, il faut pouvoir tenir compte des équipements de la même enseigne présents dans la zone.
Les engagements de programmation
Luigi Magri considère qu’un établissement doit être en mesure d’estimer la perte de fréquentation qui découlera de la création du nouveau cinéma. Il se demande en revanche s’il faut évoquer les engagements de programmation en CDACi sachant qu’il s’agit d’un point très technique. Or il paraît important de pointer certaines incohérences : l’engagement de programmation qui figurait dans le dossier du projet de Méga CGR à Claye-Souilly (77) était absurde et inutile. Luigi Magri recommande de solliciter le médiateur pour la CNACi. Lui-même a réussi à convaincre le médiateur de demander une audition en CNACi en l’informant des montants des investissements publics réalisés au cinéma Jacques Tati pour des travaux de rénovation. Dans le cas du projet de Claye-Souilly, trois cinémas de la ZIC avaient entrepris ou projetaient des travaux soutenus par les pouvoirs publics.
Tifenn Martinot-Lagarde précise que la DRAC regarde la répartition de l’offre et des entrées, mais qu’il n’est pas possible de mettre en avant les situations de concurrence, ni la densité d’équipement des territoires dans ses rapports pour les CDACi.
Eric Busidan ajoute qu’il est possible de mesurer l’impact d’une ouverture de salle sur la fréquentation des cinémas de la ZIC, mais qu’il ne peut pas s’agir d’un critère déterminant pour refuser un projet. Il est en revanche plus complexe de mesurer l’impact en termes d’accès aux films sur les cinémas d’une zone. C’est d’ailleurs pour cette raison que les engagements de programmation ont été créés.
Yves Bouveret expose les chiffres d’une étude réalisée avec les cinémas d’Ecran VO : 700 films sortent par an. Un cinéma art et essai comme celui de Pessac (5 salles) en programme 350, un multiplexe 100 à 150. Même un mono-écran art et essai programme une plus grande diversité de films qu’un multiplexe. Mais la part des films porteurs dans la fréquentation de ces cinémas est cruciale : un cinéma comme l’Utopia Saint-Ouen-l’Aumône ou Les Toiles à Saint-Gratien passe 200 films par an, mais les 10 premiers en termes de fréquentation représentent 20 à 30% de son chiffre d’affaire et de ses entrées, ce qui est énorme. C’est la raison pour laquelle les engagements locaux de programmation et de non-programmation sont si importants. Yves Bouveret cite comme exemple l’engagement de programmation entre Etoile Cinémas et le Figuier blanc à Argenteuil (accord de non programmation des dispositifs scolaires d’éducation à l’image, établissement de seuils…) qui vise à définir qui fait quoi dans la zone. Mais il relève que ces engagements locaux sont souvent en contradiction avec les accords nationaux où les grands groupes s’engagent à programmer au moins 10% de films art et essai, alors que sur le terrain on leur demande l’inverse !
Quelle évolution de la réglementation ?
Antoine Mesnier constate qu’on parle aujourd’hui de réformer les CDACi. Mais dans quel sens ? Plusieurs exploitants ont abordé le sujet lors du dernier congrès des exploitants de la Fédération nationale des cinémas français en présentant des exemples précis. A chaque fois la position était défensive, la logique restrictive, pour avoir moins d’autorisations. Or, si on veut restreindre ou relocaliser les ouvertures de cinéma, il faut réfléchir en particulier à la question des centres-villes : de plus en plus de décisions sont influencées par cette priorité dans l’aménagement urbain, alors qu’elle n’est pas spécifiquement mentionnée parmi les critères. Des critères dont on peut donc noter la souplesse d’interprétation.
Au sujet de la revitalisation des centres-villes et du programme « Action cœur de ville » qui a été annoncé en mars 2018, Tifenn Martinot Lagarde note qu’aucune des 222 villes moyennes retenues n’est située en Seine-Saint-Denis. Ce dispositif a en effet été pensé comme complémentaire des actions de la Politique de la ville.
Pour Yves Bouveret, il faut prendre le temps de la concertation, faire de la pédagogie. Il se demande s’il ne faudrait pas transformer les CDAC en commissions régionales avec davantage de temps pour instruire les dossiers ?
Sur ce point, Antoine Mesnier se montre plus prudent. Comme le recommande le rapport Lagauche, il ne faut pas réunir trop de monde autour de la table et revoir à la baisse la composition des commissions. Une commission de 15 ou 17 membres peine à prendre des décisions pertinentes. Déjà certains membres ne viennent pas car ils ne se sentent pas concernés, d’autres suivent passivement l’avis général. Cette tendance pourrait s’accroître si les commissions deviennent régionales. En revanche, si les services de l’état et les exploitants manquent de temps, il faut redébattre des délais d’instruction qui avaient été réduits de 4 à 2 mois dans un souci d’accélération des procédures sous Nicolas Sarkozy puis François Hollande.
Tifenn Martinot-Lagarde constate que, si l’on fait évoluer la représentativité des élus dans les commissions, ceux-ci resteront majoritaires et il faudra bien les informer, les sensibiliser à l’importance de la pluralité des acteurs et au travail effectué par les salles art et essai pour maintenir une diversité de l’offre. Les salles ont un rôle à jouer dans ce domaine vis à vis de leurs élus. Tifenn Martinot-Lagarde milite également pour un renforcement des moyens de la DRAC : le rapport Lagauche préconisait des études 5 ou 10 ans après l’implantation d’un multiplexe pour analyser l’évolution de l’offre et des entrées des cinémas de la zone. Mais la DRAC n’est pas outillée pour le faire.
Pour Antoine Mesnier, il serait également pertinent d’ouvrir une discussion sur les seuils : actuellement une demande doit être faite en CDACi pour tout établissement de plus de 300 fauteuils et 2 écrans. Du coup on constate beaucoup de projets à 299 fauteuils ! De façon générale, la tendance est à l’augmentation du nombre d’écrans et à la réduction de la taille moyenne des salles. Dans les petites agglomérations, c’est un point qui crée des tensions concurrentielles très fortes. Il faut se rappeler d’où vient la réglementation : elle a été conçue pour limiter l’essor des circuits dont les établissements atteignaient 12 à 20 écrans parfois. Les textes sont réadaptés car, aujourd’hui, on voit bien que les indépendants peuvent être dynamiques.
Yves Bouveret s’interroge sur la nature essentiellement quantitative des études de marché, avec principalement deux cabinets pour les mener. Il constate qu’il existe également des zones grises dans l’aménagement cinématographique art et essai et que, pour envisager de véritables lieux structurants sur les territoires qui en ont besoin, il faut se donner les moyens de projeter des miniplexes art et essai à taille humaine. Et Yves Bouveret de décliner les termes qui traduisent à son sens les enjeux à venir : « temps », « transparence », « négociation », « concertation », « modernisation », « sur mesure ».
Luigi Magri rappelle enfin que ce sont parfois les circuits qui ont impulsé la mixité des lieux. Ces pistes sont aujourd’hui privilégiées en territoire rural par les élus pour imaginer des lieux qui accueilleraient outre le cinéma, une médiathèque, un bureau de poste… dans le cadre d’établissements publics de coopération intercommunale. Dans quelle mesure cette forme de volontarisme pour créer des lieux de vie dynamiques en prise avec les multiples acteurs de la société civile locale peut-elle à l’avenir être prise en compte, compte tenu de tout ce que qui s’est dit au cours de cette matinée ? Enfin, il estime qu’il faudrait reconsidérer les critères à l’aune de ce qui se profile en termes de diffusion (avec l’évolution de la chronologie des médias), d’usages, de pratiques. Le nouveau cinéma de Bobigny verra le jour en 2024 ou 2025 : qu’est-ce que sera le monde de l’exploitation à ce moment-là ?
Contact
Ressources
Partenaires
La Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France, la DRAC – Île-de-France, l’ACRIF, l’AFCAE, le GNCR, les Enfants de Cinéma, le SCARE, le Fil des images.





